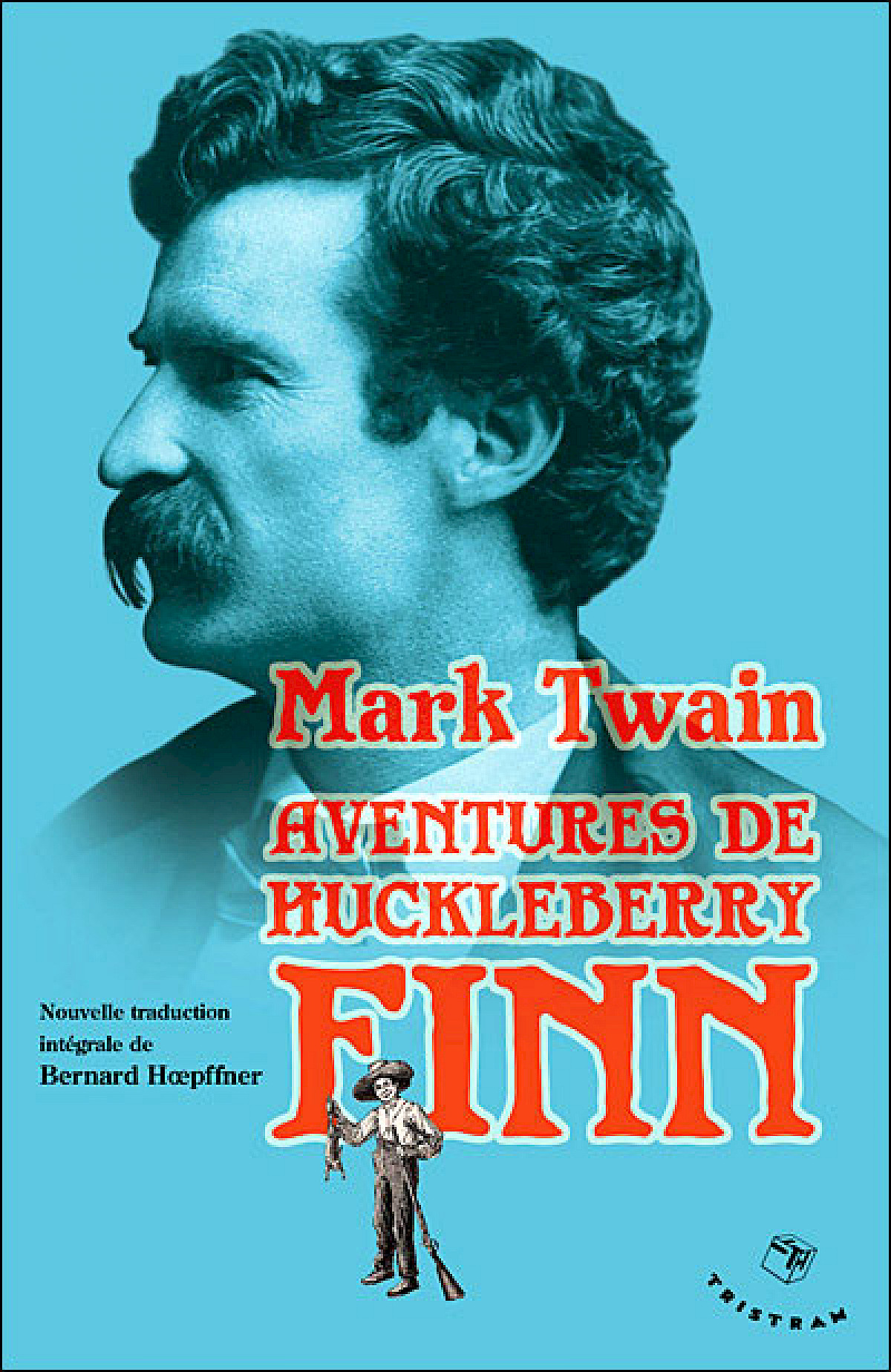
Au seuil d’un chef-d’œuvre estampillé par des générations de critiques, de lecteurs, on hésite, on rechigne. La sensation d’aller à une soirée mondaine, smokings et sourires forcés. Mais. A la vérité, passé le sas de mise en atmosphère, l’Or de l’Art nous précipite, le plus souvent, dans d’ineffables voluptés, de l’esprit et du cœur. Le champagne plutôt que l’amidon. Et le Graal de notre humanité s’y croise et recroise, il n’est qu’à s’en saisir.
Cet article a paru en 2008 dans la revue
IndicationsPas facile de se lancer dans la critique d’un tel livre. Quand l’auteur, Mark Twain (1835-1910), dans la notice, d’entrée, vous… menace : « Quiconque tente de trouver une motivation à ce récit sera poursuivi ; quiconque tente d’y trouver une morale sera banni ; quiconque tente d’y trouver une intrigue sera fusillé. »
Pas facile de se lancer dans la critique. Quand vous découvrez que l’œuvre que vous tenez entre les mains a été classée 5e meilleur livre de tous les temps (par le Time, en 2007).
Pas facile de se lancer. Quand il s’agit d’écrire une analyse d’actualité sur un livre paru en… 1884 !
Pas facile. Quand vous songez à toutes les versions animées ou cinématographiques qui ont bercé votre enfance.
Pas facile. Non.
L’intrigue ? Mais je ne peux pas en parler ! La suite des aventures, disons. Tout le monde la connaît, ou presque. Du moins, dans les grandes lignes. Un jeune garçon, Huckleberry Finn, dans l’Amérique profonde des années 1820/1830, a perdu sa mère et quasi son père, un vagabond alcoolique que la plupart croient mort et qui ne s’est jamais beaucoup soucié de son fils. Il vit auprès d’une vieille dame, la veuve Douglas, qui veut le siviliser (sic). Mais il s’ennuie ferme, ayant vécu trop longtemps à la diable, en dehors de toute société. La veuve lui parle-t-elle de Moïse, il ne s’y intéresse plus quand il apprend qu’il est décédé « il y a longtemps », « pasque je me fiche pas mal des morts ». La sœur de la veuve, Miss Watson, qui est toujours dans ses pattes, lui parle-t-elle du paradis et de l’enfer, il comprend, à la lumière de ses descriptions, que le bon endroit ne l’attire guère : « Elle m’a dit que les gens là-bas y faisaient rien d’autre toute la journée qu’à se promener avec une harpe en chantant, éternellement et à jamais. J’en ai pas vraiment pensé du bien. » Pour se désennuyer, il n’a que son ami Tom Sawyer qui invente mille et un contes pour les garnements du coin. Ainsi imagine-t-il de les rassembler en un gang de bandits de grand chemin. Puis il est question d’une lampe magique, etc. Jeux d’enfants. Avec l’ombre du Quichotte planant aux alentours. Mais Huck n’est pas Tom. Quand ce dernier se réfugie dans les chimères, son camarade n’y croit plus et démissionne de la bande. Il refuse tout autant le monde aseptisé des adultes que celui des enfants, qu’il a déjà quitté. Il se morfond dans l’ennui, aspire à mourir. Alors, quand son père réapparaît et le maltraite pour lui soutirer de l’argent, c’est la goutte d’eau. Qui l’entraîne vers le Mississipi. Huck largue les amarres, simule sa noyade et se lance dans l’Aventure, la Vraie, la Grande.
La suite ? Une descente du grand fleuve, une traversée du pays donc, qui enchevêtre les rencontres désopilantes ou angoissantes, et les péripéties échevelées. Règlement de comptes entre naufrageurs à bord d’un vapeur échoué, vendetta entre familles aristocratiques qui rappelle celle des Capulet et des Montaigu (Roméo et Juliette y compris !), charlatans fuyant le goudron et les plumes, trains de flottage et vaisseaux se croisant dans le brouillard (mise en abyme de l’implacabilité de la vie ?), etc.
Le tout de nuit, car les deux fuyards, dorment le jour et naviguent dans les ténèbres, ce qui nous vaut une descente hallucinée, aux allures de fantasmagorie, le radeau filant, comme un train, à travers l’Amérique, ses falaises, ses villages et ses villes, ses forêts…
Le tout en compagnie d’un esclave noir évadé, Jim, détail… qui n’a rien d’un détail dans cette Amérique-là, à cette époque-là (Twain écrit quelques années après la Guerre de Sécession). D’autant que notre héros ne se contente pas de voyager avec Jim. Il apprend à l’estimer, à l’aimer, sinon à vivre en fonction de lui.
Quand on replonge dans l’ouvrage, on est surpris. Dès les premières lignes. C’est qu’on retrouve une interpellation du lecteur qui rappelle celle d’un autre monstre de la première vague du roman américain, le Moby Dick de Melville : « Vous savez rien de moi si vous avez pas lu un livre qui s’appelle Les aventures de Tom Saywer, mais ça mange pas de pain. Ce livre, c’est Mr Mark Twain qui l’a fait, et il a dit la vérité vraie, en grande partie. Certaines choses, il les a exagérées, mais en grande partie il a dit la vérité. » Dans les deux cas, un héros-narrateur confère au texte une saveur d’authenticité… tout en dénonçant l’artifice littéraire, en introduisant la distance, le doute. Et l’on se dit alors que le Nouveau Roman n’a pas tout inventé, qu’il n’y a pas eu une ère du roman classique suivie de l’irruption soudaine du soupçon et de la modernité. Non, non. Ceux-ci se retrouvent à toutes les époques. Chez Cervantès, Diderot, Wilkie Collins, Gide…
Dans la foulée, nous avons droit à un rappel enjoué de la conclusion du roman précédent (Tom Sawyer), qui a des allures de séquence d’intro d’une saison 2 de grande série TL américaine.
Il y a aussi, revitalisé par la traduction de Bernard Hoepffner, le langage parlé, dont Twain s’avère le pionnier. L’écriture spontanée naît ici, épousant l’expression d’un garnement en rupture de ban. Huck, comme l’on dit familièrement, c’est déjà le minot des banlieues, des écouteurs sur les oreilles, plus un enfant mais pas encore un adulte.
Sauf que notre Huck, il ne fuit pas dans les paradis artificiels ou la déglingue, il choisit le grand large. La nature sauvage, le fleuve, la forêt. Car Twain est le père spirituel de la road story (du Sur la route de Kerouac au plus récent Sous le règne de Bone de Russel Banks), une variante typiquement américaine du bildungsroman (roman de construction) des Allemands.
Une morale ? On n’oserait pas. Quoique. Car, à suivre notre Huck, on observe que la maturation, l’émancipation, la réalisation se font à partir de refus clairs et nets. L’infantilisme du rêve ou le panurgisme du citoyen policé, formaté. La voie qui nous est proposée est celle d’une confrontation avec le réel, le concret, l’expérience, la différence. Le héros avance même un idéal : « Tirer le maximum de ce qu’il y a comme ça se présente, que je dis – c’est ma devise. » Une philosophie qui n’a rien d’égoïste : (…) ce qu’on veut, par-dessus tout, sur un radeau (ndla : mais que symbolise ce radeau ?), c’est que tout le monde soit content ». Qu’importent les idées, les volontés des uns et des autres « tant qu’on a la paix dans la famille ». Evidemment, parler d’ode à la liberté ou d’éveil de la conscience, notamment de la pensée antiraciste qui mènera un jour à l’élection d’un Obama, cela, l’auteur lui-même s’en courroucerait, donc…
Au bout du compte, la motivation (sic !) de l’auteur ne se limite pas à nous raconter des aventures, il combine les registres, distillant des salves d’humour (du bon enfant au corrosif, voire au pamphlétaire), de terreur ou de poésie, mais incitant aussi à la réflexion, à l’émotion. La spontanéité, revigorante, se conjugue avec un art consommé du deuxième degré, de la métaphore et du sens. Et, face à cette littérature tripale, je songe à ce qui a pu la générer, je tente de visualiser l’Amérique d’alors et je vois un fusil et une bible, cocktail détonnant.
Quant au rapport avec l’actualité éditoriale ? Eh bien. La démarche, initiée par la direction d’Indications, s’inscrit dans une approche résolument… moderne. Il s’agit de reconnaître la valeur créative de la traduction, qui rapproche un texte d’une partition, en l’inscrivant dans une dynamique perpétuelle, de nouvelles interprétations, quand elles sont de talent, régénérant une œuvre en décapant les scories d’époque pour nous rendre toute la percussion de l’essence, l’âme au fond. Le travail de Hoepffner est de cette eau et nous invite à relire un formidable texte de Jean-Michel Déprats1 , qui démontrait lumineusement combien la traduction s’avère une chance pour les grandes œuvres du passé, elle qui s’affranchit sans vergogne d’archaïsmes (de forme ou de fond) qui ne sont plus entendus, du sacro-saint respect qui, dans la langue d’origine, fige, fossilise, muséïse. Quand l’Art appelle la vie et la jubilation.