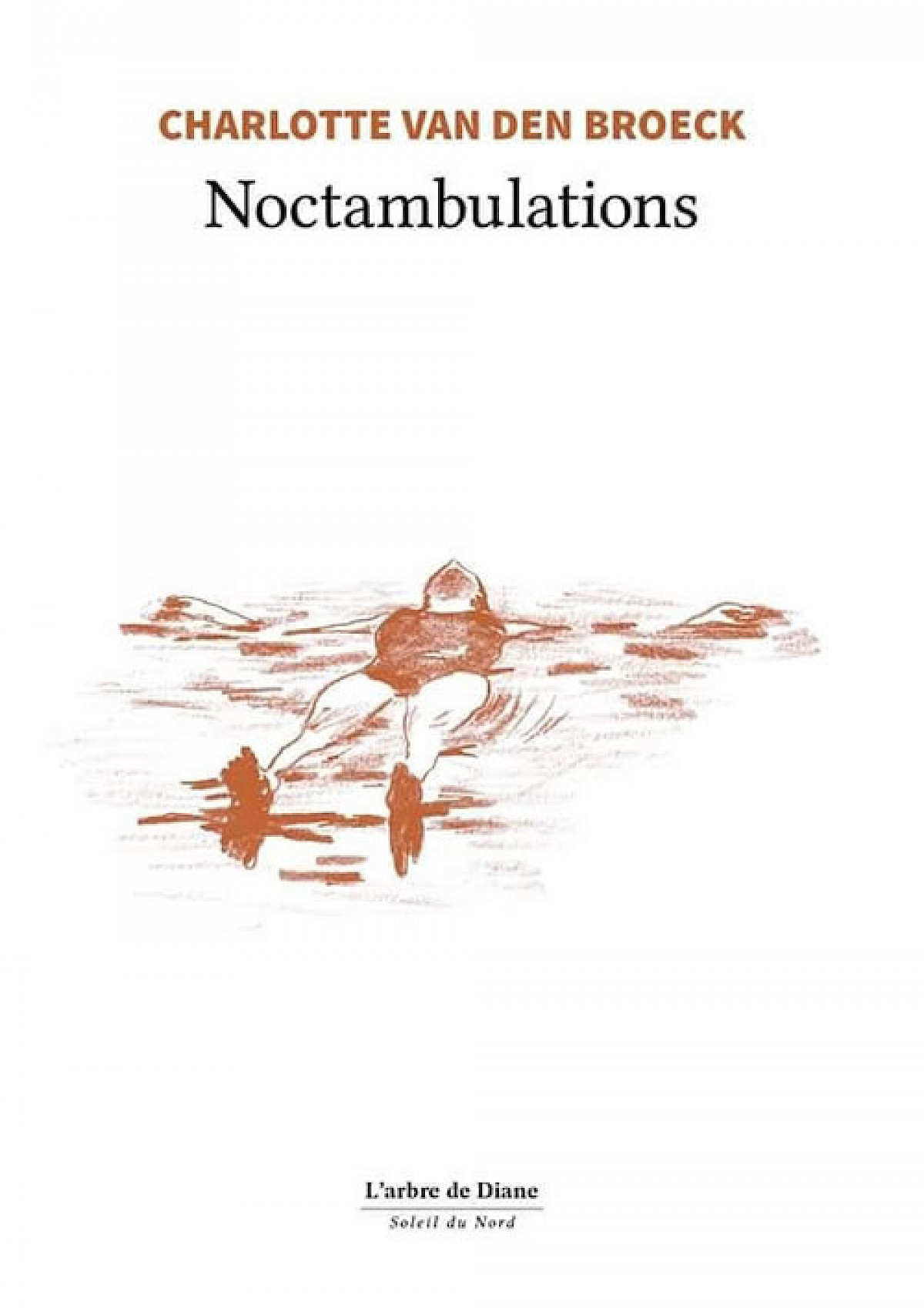
Dans Noctambulations , Charlotte Van den Broeck nous dévoile un amarrage amoureux, de son ancrage heureux à sa lente dérive, en ce qu’il marque le corps et l’appelle à se reconstruire. Ondulante, cette reconstruction corporelle présente l’originalité de ne pas être chronologique : tout en nous abandonnant, nous trions, conquis ·es , les vagues rencontrées.
Noctambulations , néologisme que nous pourrions définir comme une errance nocturne, traversée par le courant. Il est aussi celui de la seconde partie du recueil, la précédente se voulant plus cadenassée. Premièrement, nous parcourons une relation amoureuse à rebours, en huit temps, Huit, ∞, dépliée non pas en huitains finis mais en huit tableaux, ramassés chacun en douze vers compacts, encadrés, de part et d’autre, par deux balises symboliques, celles des derniers moustiques et des premiers baisers. L’enroulement et la désintégration du corps (qui, d’une unicité dressée s’enroule, s’abandonne et se noie) sont étudiés physiologiquement, la progressive focalisation externe empêchant les aigreurs actuelles de gâter ce qui a eu lieu (« ils ressemblent tant à des inconnus que je n’approche pas pour leur dire qu’ils se souviennent mal »). Deuxièmement, nous déambulons à différentes phases d’un lien amoureux, portés par un ressac émotionnel qui éloigne contrainte métrique ou thématique unique.
De cette observation minutieuse du corps, une position attire la méfiance : celle de l’allongement, associée à l’amour, au chagrin, à la régénérescence corporelle et à la mort. Cette position d’abandon ne peut guère être adoptée sur le long terme par celui qui veut être voyageur et ne pas rester tributaire de son corps. Sur la couverture, elle est toutefois épousée sur l’eau, ce qui prendra tout son sens à la lecture de l’ultime poème du recueil.
Est révélé, par ailleurs, un docile cercle1 , qu’implique toute rupture (« la date rejoint la date ») : il rétracte le corps, à la merci de ce carcan sans brisure – brisure qui l’obsède. Plutôt que de subir éternellement la même blessure, le corps narrant veut incarner un élément du scénario, le soir de la rupture, être le trou dans le mur qui a été ouvert, pour palpiter, devenir une forme pour la blessure. Le recouvrement artificiel de cette anomalie le terrifie : il s’agit plutôt de la brandir, de l’incarner, comme manière de se rebeller face à la vaine et cruelle répétition. Prendre corps pour dévier un des cercles qui, comme les autres, abrutit par essence. En effet, engagée, Charlotte Van den Broeck s’oppose à toute emprise cyclique, assénant que « tout mouvement est d’abord résistance, pousse en sens inverse ». La révolte individuelle semble inconfortable, paradoxale (le pouvoir d’achat étant « consolateur ») mais salutaire contre la consommation cyclique qui nous « domestique ». Prendre corps sous l’impulsion toutefois d’un cercle plus vaste, celui des astres, l’ère du Verseau (qui titre, en anglais, un des poèmes du recueil) étant globalement associée à un éveil de la conscience, à la rébellion, l’irrésolution (garantissant ici la plasticité corporelle) et l’électricité régénérante.
Parce que cette rébellion ne se fait pas sans avoir fait peau neuve. Le dépliement sénestrogyre2 de la relation amoureuse, dans la première partie du recueil, amorce une mise à zéro de ce corps organique et fluctuant, sujet à des émotions météorologiques. Autour du tuteur dorsal, le corps s’achemine vers le haut, jusqu’à « dévier dans quelqu’un d’autre ». La verticalité natale s’arrondit jusqu’à se recroqueviller. De la rupture amoureuse s’ensuit le périlleux désenroulement du corps aux contours chancelants (« je suis à l’étroit ici – dans le point liquide que mon corps hésitant forme par mégarde »), pétrissable par les faits (« tu verras un cri sous tes yeux – sismographe du trouble qui friselle ton corps – de l’obscurité du matin »), parcouru de rehaussements dermiques (« le halètement bleu » poussant sous la peau), d’abaissements internes (« je tombe en moi à travers moi »), ontologiques et régressifs (« à travers ta peau, le gravier (…) avant l’aube, je deviendrai abîme, une crevasse (…) je suis un endroit qui n’est pas là »). Cette perméabilité du corps se matérialise organiquement par cette « plante parasite » qui « s’enroule dans la gorge », lorsque formuler son ressenti face à une parole décisive s’avère impossible, ou par les nombreuses étamines 3 qui couvrent ses côtes. Avant de parvenir à faire peau neuve, divers procédés temporaires sont écartés (celui de nommer identiquement des êtres semblables pour les superposer et ainsi perpétuer une relation qui n’est plus) ou expérimentés bien qu’étant inefficaces. Par exemple, le bonheur constitue un baume organique enrobant mais cette écorce corporelle étouffe la voix, empêtrée dans une pierreuse allitération. Si recouvrement il y a, il est viscéral (les organes sont placés dans un « sac amniotique », lorsque une ondée de chagrin traverse le corps) et linguistique (« des mots de passe » protégeant subtilement « ce que nous chérissons »).
Vient alors l’épluchage. Le « tissu fatigué » de la mélancolie est ôté, non sans s’être lové dans le ventre et la gorge des lecteur·rice·s. La guérison entraîne le processus de mue, le dépouillement du corps, à commencer par les doigts, comme « extrémité[s] usée[s] de [s]oi-même », « effilochures de la peau ». La « chair des murs » de l’habitation et du corps se renouvellent ; comme le fil des événements, le « réseau sanguin [est] rembobiné ».
Alors que le corps narrant se meut, se distord et se reconstruit, l’Autre n’est pas décrit et est même convié à sauter hors de la page. Peaux passée et neuve se côtoient et cette juxtaposition de deux états, figée durablement dans le papier puisqu’une « couture s’étend entre artère et récit », forme le cœur de l’ouvrage. Sans cesse, nous sommes bercés par des sensations contrastées, douces-amères, procurant un léger mal de mer. Comme dans un rêve, nous nous prenons à aborder librement nos propres souvenirs sous un nouvel angle, délié de toute logique chronologique.
Cet assemblage central amène une transformation de la beauté passée en amère nature morte (« toi enfermée dans le goût du comment lui se rappelle ta bouche sans gerçures ni promesses ni rouge à lèvres, orange sanguine ») réifiant sa propre personne, l’associant à une denrée consommable et donc périssable. La peau neuve signe le retour d’un corps narrant actif, attisant ses sens par lui-même et ne sollicitant pas uniquement ceux des autres – un corps qui, revitalisé, peut « lécher le pollen sur les doigts ». Figure de renouveau, le pollen constitue une offrande de la nature lorsque le corps, après avoir dévié de son tuteur dorsal par amour, se rapproche à nouveau de son état organique originel.
Le recueil n’offre par ailleurs pas de dialogues, s’attelant tout entier à prendre corps et à réveiller le nôtre. Du rappel du coup de feu le soir de la rupture (les mots prononcés étant concentrés dans cet éclat déshumanisé) jaillissent des sensations et empreintes corporelles mémorisées viscéralement. Habilement, Charlotte Van den Broeck pointe de subtiles et paradoxales réactions humaines que nous découvrons aussi détenir, ce cantonnement au modelage corporel universalisant son vécu. Le microcosme mutique de deux êtres se décontextualise ensuite encore davantage lorsqu’on ne parle plus de coup de feu à Gand mais d’une explosion de météorite au-dessus de l’Europe que le « nous » ne perçoit pas. Imperturbable, cette étude minutieuse d’interactions passées gagne alors en profondeur et témoigne de la tendre sensibilité de Charlotte Van den Broeck, à même de déceler la pluie de fines conséquences – « les étoiles sourdes, muettes et interchangeables », « les paroles entre deux bouches qui ne desserrent pas » – qu’induisent certains phénomènes sonores, tels que l’annonce d’une rupture ou l’explosion d’une météorite.
Cet élargissement de perspective touche également au domaine physique et philosophique (« les faits sont toujours rattrapés par les structures »). À nouveau, l’intéressant rapport qu’entretient le corps narrant avec ces dernières, essentiellement spatio-temporelles, est évolutif et peut être réagencé logiquement : la structure externe est d’abord coupable de notre domination ou de notre dépendance (« l’emprise – est possible depuis que la figuration du temps se porte au poignet »), nécessaire toujours, pour s’ancrer et vivre à la surface, survivre (« et ça ressemble beaucoup à de la survie : – vouloir donner à tout une heure et un territoire – aux hommes une physique compréhensible »), pas suffisante toutefois (si une carte pose une « peau de papier sur Paris », elle ne donne pas de direction au corps), enfin, elle devient passive lorsque le corps narrant se la réapproprie (« les quatre angles de mon regard »), transformant les distances parcourues en espaces traversés. Enfin, le corps narrant la dépasse par l’errance (dans le but de « recréer une ville » éloignée du temps de tous – déterminé par le « faux jaune de l’éclairage urbain » – et du temps à soi, formés par les souvenirs) ou par l’ajout d’un paramètre subjectif à son endroit (association de couleurs aux jours de la semaine dans Coupure ), ce qui vient briser la neutralité colorimétrique du cercle hebdomadaire imposé.
L’omniprésence cyclique s’étire jusqu’au dernier poème qui symbolise pleinement le corps et l’intimité retrouvée en ce que la narratrice s’exprime et, plus encore, s’adresse à elle-même à la seconde personne du singulier. Les sensations du corps ont été fouillées, le mutisme dépassé et la construction de maquettes de bateau, annoncée dans Bleu , se concrétise. Voué à contrer le déluge à venir (de nature inconnue mais d’existence pragmatiquement certaine), ce moyen de transport fluvial s’érige dans un idéal de robustesse et de durabilité. Le corps délié a encore une fois besoin d’une structure externe ; toutefois, celle-ci a vu le jour sur base d’une idée personnelle, ce qui fait toute la différence. Noyée au cours du recueil, la charpentière a su « se servir de la peau comme tente » puis, doucement, remplace cet abri introspectif par un moyen de dévier, de fluctuer, de s’abandonner autrement qu’en vivant une relation amoureuse. Le ⋅ a lecteur ⋅ rice sort alors également de sa peau et embarque sur le bateau, tout juste sorti des beaux flots houleux de la mélancolie, prêt·e à sécher à bord.