Albert-André Lheureux
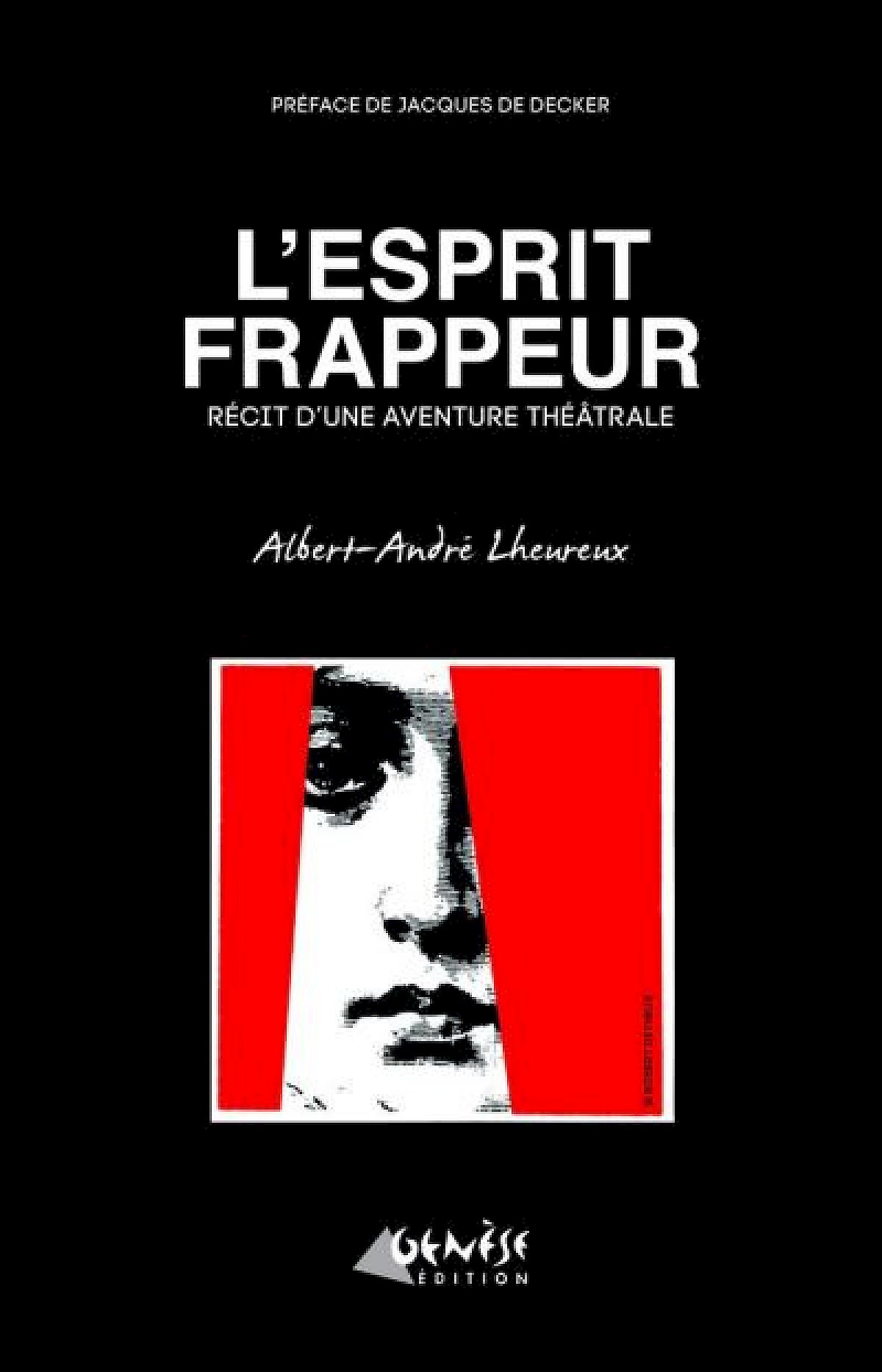
Metteur en scène de théâtre et d’opéra, Albert-André Lheureux a consacré sa vie aux arts vivants. Dès l’âge de dix-huit ans, il fondait le Théâtre de l’ Esprit frappeur . Une vie débordante qu’il a tenté de faire tenir dans un livre, l’Esprit frappeur . R écit d’une aventure théâtrale . L’occasion de l’interroger sur la mise en scène, la direction d’acteur, le théâtre, le cinéma, la poésie et, surtout, la magie.
Comptant parmi les figures de proue du Jeune Théâtre, mouvement lancé en Belgique dans les années 1970 et visant à renouveler la place du théâtre dans la société tout en décloisonnant le schéma classique texte d’auteur/comédiens/public, Albert-André Lheureux a également dirigé Forest National, le Botanique et le Résidence Palace. La Maison Béjart1 , basée à Bruxelles, le mettra d’ailleurs à l’honneur le 17 janvier dans le cadre d’une rencontre littéraire autour de son livre et de l’influence de Maurice Béjart sur son travail.
Dans l’Esprit frappeur , il est question du potentiel de magie que recèle un acteur. Comment un metteur en scène parvient-il à le révéler ?
En transformant l’acteur en totem et en conférant à tous ses actes une portée totémique . Le metteur en scène doit révéler l’acteur en faisant preuve de perfectionnisme tout en ne cherchant pas à tout contrôler. Le metteur en scène doit se comporter avec les acteurs comme l’auteur avec lui : en trouvant un subtil équilibre entre limitation et ouverture, fidélité et transformation, appropriation et non-appropriation. Une pièce de théâtre n’est pas une addition d’éléments isolés mais bien une fusion supérieure de ceux-ci. Cette approche permet d’éviter deux écueils récurrents : l’anarchie et la désincarnation. Soit les acteurs sont livrés à eux-mêmes, face au vide, forcés d’être plus créateurs et constructeurs qu’interprètes (risque de chaos), soit ils sont châtrés artistiquement et enfermés dans un rôle immuable. Dans un cas, l’excès de liberté mène à la perte d’ unité du spectacle, dans l’autre, le manque de liberté prive celui-ci de toute âme , ravalant les acteurs au rang de simples marionnettes.
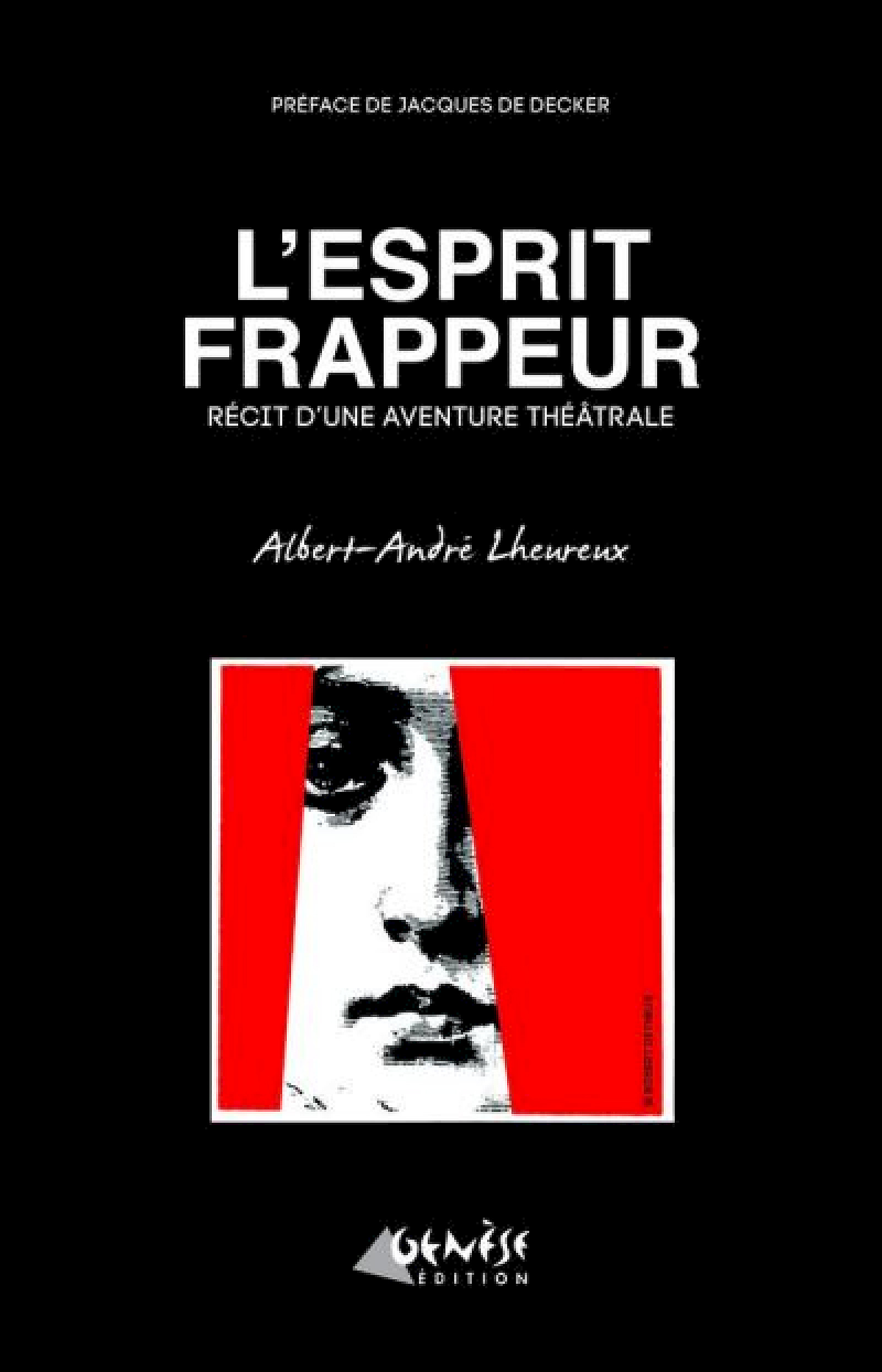
S’agissant de la magie de l’acteur elle-même, elle prend trois formes : par rapport à lui-même (dépassement de soi), par rapport au public (sentiment de fascination et de transcendance grâce à la transcendance de l’acteur), par rapport au metteur en scène et à l’œuvre.
C’est seulement par ce travail rigoureux et exigeant qu’on parvient à entrer dans l’acteur, tout en lui permettant d’entrer en lui-même pour y exploiter ses potentialités. Par ce travail de cheminement intérieur et d’improvisation — plus que d’improvisation, il s’agit de joie de dire, de joie d’être, de force ,d’identification, et de création —, il atteint le stade de l’incarnation et devient, pour finir, un mythe aux yeux du public, un totem . À savoir un être chargé de tout l’agglomérat de forces qui constitue le personnage, qui aborde sa performance comme un exercice de vie et de mort. À l’image du Funambule de Jean Genet. Chaque spectacle doit être vécu par lui et par le public comme une première et une dernière fois. L’acteur doit vivre la représentation comme s’il allait mourir, vivre l’instant présent comme s’il n’y avait ni passé ni futur.
Quels sont les autres critères d’un bon spectacle ?
Il doit transformer la fiction en réalité ! En imprimant si puissamment l’âme du spectateur que ce dernier emporte une part du spectacle dans sa vie après-coup. Un spectacle qui ne soit pas que spectaculaire mais dont on se souvient des instants (un cri, un geste…). Moi, je ne me souviens que des instants. « L’éphémère est éternel », disait Michel Seuphor. Mieux vaut un spectacle raté avec trois moments inoubliables, qui agissent sur l’âme, qu’un spectacle réussi dans l’ensemble mais qui n’agirait pas sur celle-ci.
L’important est d’amener l’art à se dépasser lui-même, à atteindre une vérité poétique et magique .
Il faut donc des moments sublimes dignes d’un rituel, d’une messe. Pas au sens religieux – j’abhorre la religion et son institutionnalisation en système aliénant – mais au sens de moment sacré et transcendant, dont l’effet est de nous élever/spiritualiser.

Le but du théâtre n’est pas de faire un prêche, mais d’offrir une parabole au public. De lui faire éprouver une expérience métaphorique et non un discours s’adressant à l’intellect. Alors, le public entre dans la parabole et dans l’histoire, finit par être convaincu de ce qu’il a vu, mais sans qu’on ne lui explique pourquoi il doit croire à ce qu’on lui dit. Paradoxalement, un spectacle peut tout à fait être bon et provoquer de mauvaises réactions, dirigées directement contre lui. Les Paravents de Genet s’était ainsi attiré les foudres du public (jets de pétards et d’œufs sur la scène) car il lui tendait un miroir de sa réalité quotidienne, insupportable à regarder. Ces réactions négatives, visant à interrompre ou à détruire le spectacle, en démontraient pourtant toute la réussite : faire percevoir la fiction comme une réalité plus forte que le réel.
Peut-on considérer le metteur en scène comme le traducteur scénique de l’œuvre d’un auteur-dramaturge ?
Oui ! Il ne s’agit pas d’un traducteur-imitateur mais bien d’un traducteur-créateur. Aussi, un auteur qui met en scène son propre texte se montre généralement incapable de lui donner du volume , parce qu’il n’accorde aucune place au devenir de son œuvre. Il aspire seulement à une reproduction exacte de sa vision personnelle (didascalies…), forcément limitée, à une traduction littérale de son œuvre textuelle en œuvre scénique. Le metteur en scène, lui, cherche à donner du volume au texte, à l’inscrire dans la réalité en trois dimensions. Un metteur en scène ne doit pas uniquement faire dire à l’œuvre ce que l’auteur a voulu exprimer, mais ce qu’elle signifie intrinsèquement, et ce qu’elle LUI dit. L’enjeu de dés-appropriation s’avère parfois très difficile car l’auteur doit se mettre en retrait et regarder un tiers s’approprier une part intime de lui-même, accepter d’autres co-auteurs .
D’autres auteurs ne prennent aucune part à la phase de mise en scène et découvrent leur texte une fois joué, ainsi que les potentialités qui y couvaient, actualisées par le regard du metteur en scène et par le corps des acteurs. Rien de plus beau pour un auteur que de prendre connaissance d’une richesse qu’il ignorait, que d’être révélé à lui-même. L’auteur ne se cantonne alors plus au rôle de vérificateur (de conformité entre le texte et la représentation scénique), mais devient une sorte de spectateur , jouissant du plaisir de découverte et de sublimation. Il jouit de nouer une relation pure et libre à sa propre oeuvre.
Ce principe, le monopole de la propriété et du contrôle, s’applique d’ailleurs à la vie en général : la pire manière d’obtenir ce qu’on veut est parfois de trop le vouloir et de le cadenasser. À trop penser au résultat final, on perd de vue les moyens y conduisant. Il faut apprendre à improviser et à négocier avec le réel.
Ce problème est typique de l’intellectualisme en théâtre, obnubilé par l’hyper-contrôle, intellectuel et pratique, dont l’ hyper-rationalisme aboutit à l’irrationalité (marquée par la redondance, le téléphoné, l’absence d’art).
Le théâtre semble entretenir un lien très étroit avec la notion de vide. Le propre du théâtre n’est-il pas de sublimer le vide en le faisant oublier ?
Oui, cette caractéristique s’avère essentielle. L’acteur doit combler le vide scénique en faisant oublier l’absence (de décor, de réel ) par sa seule présence.
À l’heure actuelle cependant, on observe une inversion du rapport entre le théâtre et le vide à l’aune duquel ce dernier est vu davantage comme une privation (un phénomène dépassant le théâtre et l’art pour toucher au rapport entre l’homme moderne et le monde) que comme un élément à part entière.
En cherchant absolument à combler le vide, on rompt sa relation essentielle avec le théâtre . On remplace du vide réel et utile par du vide virtuel et inutile (écrans, projections).
Autrement dit, une double tendance se profile : dématérialisation de l’environnement scénique et volonté de vider le vide .