Entretien fleuve avec Veronika Mabardi (I)

Accoudé sur Les Cerfs (2014), Peau de louve (2019) et Sauvage est celui qui se sauve (2022), ce premier volet d’entretien se déploie autour de trois axes : le langage, les frontières et la déconstruction.
Pour commencer, rappelons brièvement le fil que déroule Les Cerfs. Il s’accroche à Blanche, une petite fille qui a perdu sa mère et qui ne parle pas. Elle est recueillie par Annie, qui habite contre la forêt et qui pose des mots sur tout. Avec cette forêt et Ian, le compagnon d’Annie, Blanche entre en contact. Dans cet ouvrage ainsi que dans Peau de louve et Sauvage, il y a une représentation du langage assez similaire, c’est quelque chose qu’on évite et qui évite ce qui est à dire :
« Blanche aime les choses qui poussent, les arbres, les animaux, tout ce qui vit et qui ne parle pas, comme elle. » (« Les Cerfs » , p.11)
« Ce qui m’intéresse, depuis le début, c’est ce qui échappe au langage. Le vide entre les mots trace un chemin. » (« Sauvage » , p.94)
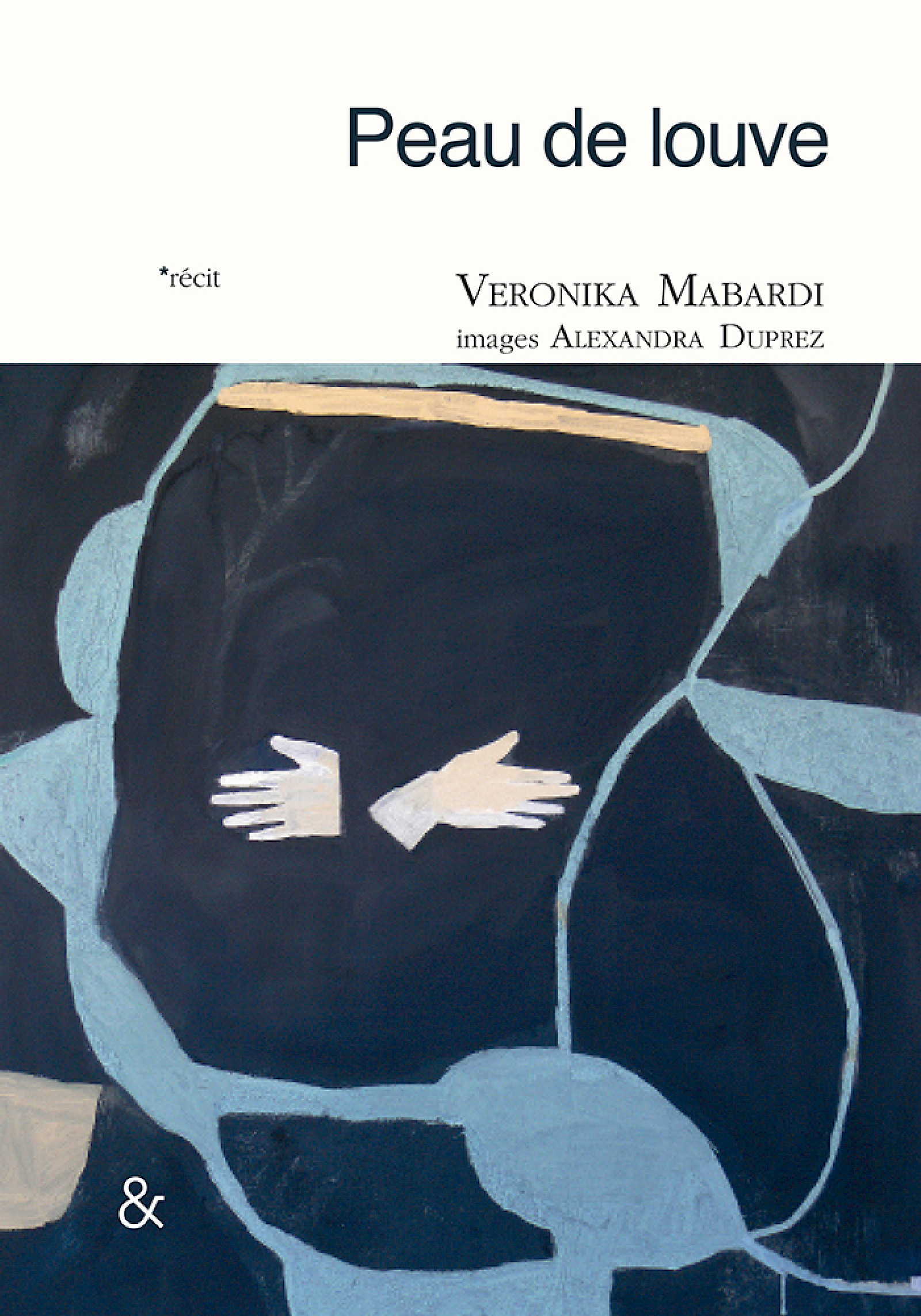
Il est donc très pertinent que le dessin s’immisce dans ces trois ouvrages, comme si c’était une concrétisation du fait que quelque chose nous échappe. C’était très réconfortant pour le lecteur parce que c’est angoissant de se dire que ce qui nous relie normalement (le langage) nous échappe, et là il y avait quelque chose pour nous raccrocher. Comment fais-tu pour appréhender ce langage-là que tu dépeins dans toutes ses contradictions ?
Ce n’est pas quelque chose que je fais en surplomb, je ne réfléchis pas du tout au statut du langage. J’aime énormément lire des gens qui réfléchissent sur ça. Au moment où j’écris, il n’y pas de langage chez moi. C’est vraiment plus un mouvement et puis, en me relisant, je perçois le sens de ce que j’écris, donc c’est en deux étapes. Je commence à pouvoir mettre des mots dessus après trois tentatives où je raconte la même chose. Mon gros problème, mon problème d’adulte, d’écriture, est le même que celui de Blanche dans Les Cerfs : dès qu’on dit une chose, forcément on ne dit pas toutes les autres. Une chose n’existe pas séparée de toutes les autres. C’est comme d’identifier quelqu’un en lui-même et de dire quelle est sa personnalité sans tenir compte de tous les miroirs que les autres lui renvoient et de ce qu’elle ou il est à l’intérieur des autres aussi, qui est aussi elle ou lui. Quand j’étais petite, je faisais beaucoup de danse et c’est bizarre que j’écrive car là on ne peut dire qu’une chose à la fois et on ne peut parler que dans une langue à la fois. Or j’ai été élevée bilingue et donc je sais que les choses peuvent se dire de deux manières et déjà signifier deux choses différentes. Dès le moment où je réfléchis à l’écriture, je ne sais plus écrire car je mens quoi que je dise et donc je me suis beaucoup battue avec ça, jusqu’au moment où je me suis donné le droit d’aller dans une petite fille qui, elle, n’a pas toutes ces censures et toutes ces injonctions à nommer. Nous sommes dans une époque où nommer est très important, j’en suis absolument consciente sauf que, pour ce que je veux nommer, les mots, ça ne va pas. Il y a une phrase qui, pour moi, est le centre des Cerfs, je m’en suis rendu compte en travaillant avec la traductrice polonaise : « Un jour, je ferai un chemin, une phrase assez belle, avec des trous, pour que tu puisses t’asseoir avec moi ».
« Un jour, Blanche prendra les bruits. Elle fera une phrase. Elle fera une phrase avec le monde entier dedans, comme le chemin entre les hautes herbes, le jardin, la prairie, la forêt, le ciel, toute fine, pas droite du tout, qui n’arrête jamais, on ne pourra la retenir, elle changera tout le temps, on sera dedans, on avancera avec elle, en même temps, on oubliera où elle a commencé et ne saura pas où elle finit, on sera avec elle, à l’intérieur. Elle fera une phrase pour être en même temps jusqu’au ciel. Une phrase pour le renard. »
L’idée est reprise dans Sauvage, je n’ai pas fait exprès. C’est la chose sur laquelle j’ai travaillé pendant dix ans. Le fait que cette petite fille dise ça, j’ai pu petit à petit me l’approprier comme adulte et me dire, non je ne suis pas niaise si je dis ça, puis je me suis retrouvé face à Wittgenstein1 qui dirait que ça vient de lui-même, qu’on ne le comprendra pas, je n’ai pas de problème à ne pas tout comprendre. J’étais vraiment intéressée par son idée d’abord que le langage est un système de relations et que donc ce n’est pas le réel, ce n’est qu’un système. J’aimais énormément aussi le fait qu’il dise que ce dont on ne peut pas parler, on ne peut pas en parler. C’est une tautologie mais les tautologies sont parfois bien utiles, plutôt que les métaphores. Je trouve que les métaphores sont dangereuses et les tautologies peuvent mettre les doigts sur les choses. Dire que je ne peux pas en parler et que, donc, je n’en parle pas, ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler du tout, je peux parler d’autre chose et je peux chanter, je peux danser. J’aimais bien l’idée d’écrire des mots qui donnent une place pour qu’on sente qu’il y a quelque chose qu’on ne peut pas dire mais qui est là.
D’ailleurs, tu concrétises parfois ces sensations qu’on ne nomme pas mais qui sont là, comme le fait d’appréhender des choses par un autre sens. Il y a cette idée qu’on entend les mots par les yeux ( Les Cerfs ), qu’on boit un visage ( Sauvage ) ou quand Blanche entend le brame du cerf, elle se met les mains sur la bouche ( Les Cerfs ). C’est drôle, ce langage qui s’exprime par d’autres sens, cela m’a beaucoup touchée, tout comme le fait que ce soit une petite fille.
Je trouve que c’est intéressant de pouvoir retourner à cet état d’enfance où la métaphore n’existe pas, où tout est réel. Si je dis que je me sens brouillardeuse, ce n’est pas une métaphore, c’est vrai que mes cellules sont brouillardeuses. Si on commence à dire « je suis dans le brouillard » et à penser que c’est une métaphore, on se déporte, on n’est plus dans la réalité de la sensation. La petite fille donne plein de permissions. On ne s’autorise pas à penser certaines choses car ce ne serait pas adulte et intelligent. En plus, je n’ai pas du tout fait d’études universitaires : je suis avec ce bagage de diplôme d’humanité, faut pas que je la ramène, j’ai vécu avec ça très longtemps.

La métaphore, c’est le pas de côté, la figure de style qui regarde le langage et là il n’y a pas du tout cette contemplation du langage.
La langue dit des tas de choses en elle-même. À un moment, elle ne dit qu’elle-même. Comment fait-on pour épuiser le langage et pouvoir se taire après sans que le silence soit une chape de béton ?
Blanche perçoit très vite qu’il y a des limites au langage. Quand quelqu’un lui parle, elle est directement perturbée par le fait qu’elle comprend d’autres choses que les mots. Il y a tout ce côté au-delà du langage, ce qu’on perd parfois en étant adulte en s’en tenant au sens stricto sensu.
C’est le problème d’Annie ( Les Cerfs ). Elle est dans le langage. Elle a beau abandonner les livres, elle ne peut pas abandonner le langage, elle ne peut pas percevoir qu’il se passe mille choses. Comme elle a mis le mot « amour » sur sa relation avec Ian, elle ne voit plus la relation qu’elle a avec lui et toutes les possibilités de cette relation, car elle est dans une relation livresque, quelque chose de phrasé. Quand Blanche commence une autre relation avec Ian, ça doit être super troublant pour l’adulte. Que se passe-t-il entre les deux ?
Et on se sent troublés aussi. Ce que je trouve incroyable, c’est que Blanche influe directement sur le langage d’Annie puisqu’avant elle dit qu’elle parlait droit et qu’elle commence maintenant à parler mélangé. Je trouve qu’il y a un rapport avec la danse, la danse du langage, qu’on ne doit pas toujours réfléchir à si ce qu’on dit fait sens.
Il y a la question de la thèse-antithèse-synthèse, de tout ce qu’on a appris à l’école, de comment développer une idée du début à la fin, comme si la pensée était droite, pyramidale, avec des hiérarchies de pensées. Je trouve qu’il y a des parallèles à faire entre le monde patriarcal et la manière dont on utilise la langue pour penser, c’est-à-dire que si on ne peut pas penser à ça et ça, et aussi ça et ça, et faire des sauts et revenir et faire toute une danse horizontale, on va se retrouver dans un truc « il y a d’abord ça, puis ça et donc ça ». Et non.
Tu dis d’ailleurs :
« Le père et le frère se passent la phrase, ils l’emberlificotent autour de ce qu’ils ne disent pas. »
J’adore cette absence à laquelle on accorde de la place mais qu’on ne nomme pas.
Oui, c’est puissant le langage. Je me souviens d’une sensation physique d’être embobinée par la parole de quelqu’un, comme si les phrases s’enroulaient autour de moi et venaient me serrer la gorge et m’empêchaient de parler et même de penser. Le langage a vraiment beaucoup de pouvoir, peut-être pas celui qu’on croit, seulement de dire ce qui est.
On pourrait presque faire un livre théorique sur la vision du langage des trois récits ! Il y a de petites phrases très réflexives, l’air de rien, parmi toutes les sensations que Blanche ressent. Le langage apparaît dans son foisonnement, dans sa cruauté aussi, parce qu’une phrase « peut abîmer les choses », leur enlever une magie…
Il y a des gens qui ont voulu décortiquer la relation entre Blanche et Ian et qui l’ont salie avec des mots. Je pense qu’un enfant peut vivre le désir dans son corps et qu’un adulte peut en être conscient et respecter ce désir quand même. Je voulais vraiment qu’on perçoive cette relation, entre cette petite fille et cet homme adulte, qui résonnent l’un dans l’autre, et que ce soit juste, et que, pour une fois, un homme protège un enfant et n’abuse pas de cette chose qui est belle.
Et Ian apprend beaucoup de cette relation aussi. J’ai remarqué qu’il y avait souvent une tension entre deux personnages dans ces trois livres et qu’ici Blanche réussit à le faire évoluer, à lui réapprendre à se relier aux autres. Il y a toujours une personne bloquée. Ian, ici, est écrasé par les attentes d’Annie.
Oui, il est complètement coincé, incapable de parler.
Blanche arrive avec toute sa pureté. Cette tension dramatique entre deux personnages me faisait penser à l’influence du théâtre. Il y avait à chaque fois deux protagonistes, un qui vient aider l’autre puis, en miroir, reçoit l’aide de l’autre.
C’est vrai qu’il y a cette idée que sans l’autre, il ne se passe rien. Je pense qu’il y a quelque chose dans Blanche. Elle est extralucide, comme les enfants peuvent l’être, et elle n’a aucune envie de sauver Ian. Elle vit juste complètement ce que son corps lui dit et c’est ça qui fait que Ian peut bouger. Annie a cette envie de l’aider, de le sauver mais c’est justement ça qui le coince. A posteriori , je fais le lien avec Sauvage car il y a cette question de vouloir sauver l’autre dans toute cette affaire d’adoption. Ce sont des thèmes sous-jacents auxquels je ne pense pas du tout consciemment sur le moment. Il s’agit de lâcher des choses que je ne sais pas que je dirais et donc je trouve que les personnages – ou même, dans Sauvage , mon frère – sont des détournements. Pendant que je m’occupe d’eux, je ne m’occupe pas de ce que j’écris et donc quelque chose peut émerger qui n’est pas de l’ordre du récit construit mais d’une surprise.
On retrouve aussi cette relation dans Peau de louve avec Muriel, à la fin, et l’enfant qui l’aide et reprend ensuite la peau de louve de cette dernière, pour l’utiliser à son tour. Il y a cette transmission aussi, cette aide de personne en personne.
Oui et c’est drôle parce que plein de gens me disent « oh la métaphore de la forêt » mais, pour moi, tout est réel. C’est crédible, c’est possible qu’elle trouve cette peau, c’est possible qu’elle la mette, c’est même possible qu’elle mange les animaux. Pour moi c’est important que ce ne soit pas du fantasme, de l’imaginaire dans le sens de « ça ne se peut pas mais on peut y rêver » : non, ça se peut.
Il y a beaucoup de récits excellents qui parlent de transformation, comme Le lièvre d’Amérique de Mireille Gagné. La connivence entre humains et animaux, ici, ce n’est pas pour la métaphore : c’est beaucoup plus original.
C’est vraiment de l’ordre du pouvoir de l’animal. Quel est le pouvoir du loup ? C’est l’étendue. Le loup peut nous apprendre ça, c’est très concret. Le rat peut nous apprendre à regarder les détails et à disparaître, à se fondre dans le paysage. On est un peu comme des enfants, à vouloir des aigles, des loups et des panthères mais, en fait, une mésange, ça le fait.
Cela me fait penser à cette frontière entre le dehors et le dedans, qu’il faut venir dépasser. Tu attires l’attention sur le fait qu’on qualifie – encore une fois, on pose un mot – les bêtes de « dangereuses » alors que finalement c’est nous qui sommes dangereux pour elles.
Statistiquement, c’est nous qui sommes dangereux pour elles mais, si on se retrouve face à face avec un coyote… Mais pourquoi serait-on familiers, pourquoi les animaux seraient des nounours ? On est élevés dans une sorte de « tout va bien » mais, non, tout ne va pas bien. Il y a des conflits.
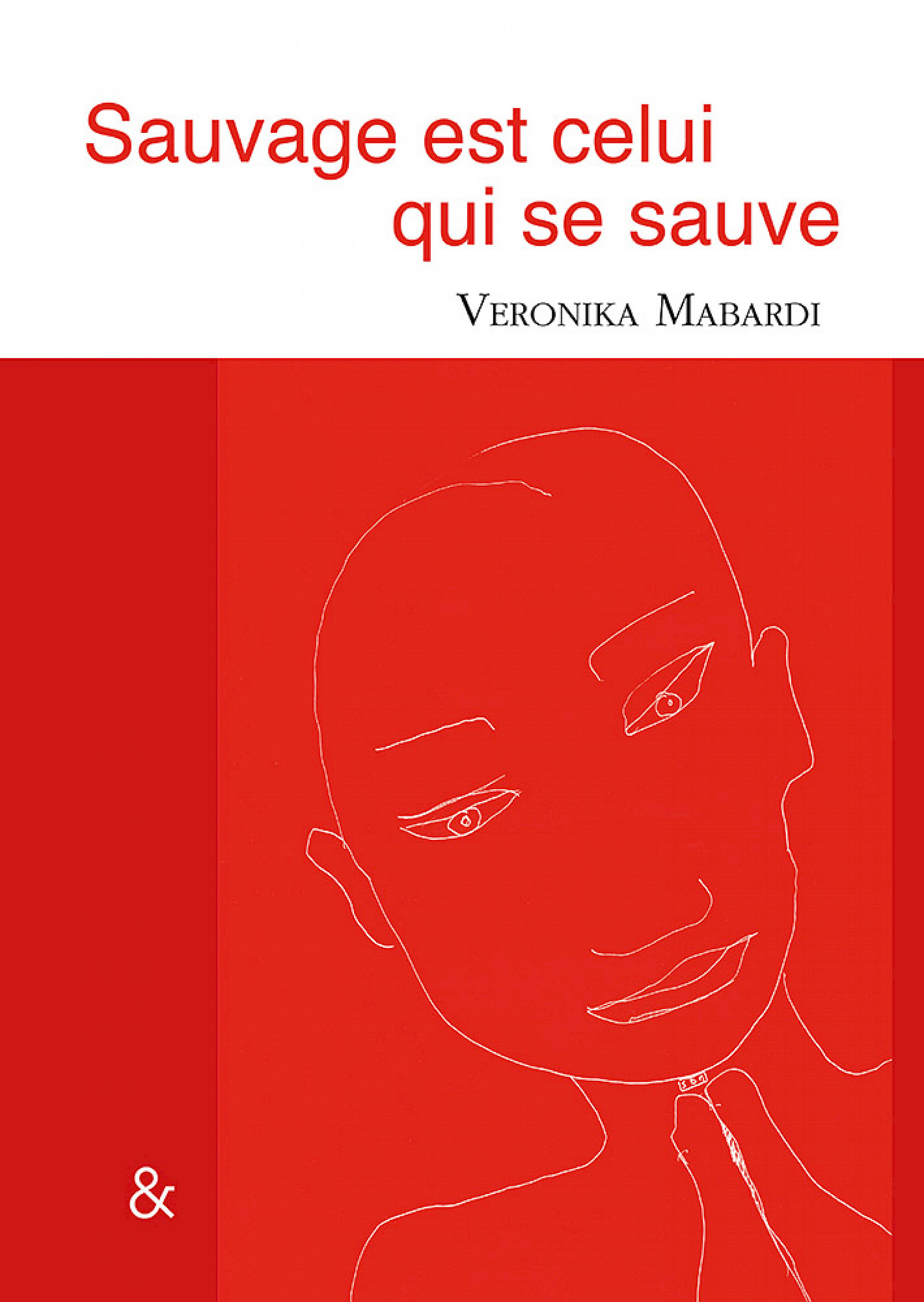
C’était la prise de conscience des conflits et, en même temps, la prise de conscience qu’on fait partie d’un tout. Dans Sauvage, il y avait cette idée aussi d’arrêter de dire d’être du bon côté de la catastrophe alors que, finalement, tout le monde est dedans3 . Il y a quelque chose d’inclusif, que ce soit entre les animaux et les hommes, entre ceux qui souffrent et les autres.
Oui, on vit la même histoire et il y en a qui en souffrent plus que d’autres. Il y en a qui souffrent dans leur imaginaire. Sauvage m’a vraiment appris ça en fait. Quelqu’un m’a dit : « La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle ». La douleur de mon frère, elle n’était pas optionnelle. C’est le trauma physique. Après, à moi de choisir, et de comprendre ce qui est optionnel et de le laisser tomber pour pouvoir passer à l’action.
Il n’y a pas que nous qui percevons des émotions : les lieux aussi s’en imprègnent (une chambre peut être « au bord des larmes » dans Sauvage ). On retrouve la notion de frontière, cette perméabilité du dedans et du dehors, la prolongation de l’un dans l’autre.
Les émotions sont partout et on sent qu’on peut traverser des endroits chargés. J’ai vu le travail d’une photographe polonaise, qui était allée dans un endroit où il y avait eu un génocide, faire des photos et cartographier le territoire. Le lieu se souvient.
Il y a aussi ce détricotage de frontières qui est intéressant, entre Annie et le cheval. Leurs crinières se mêlent.
Ça c’est génial car je l’ai vécu. J’ai une amie que j’ai beaucoup vue travailler avec des chevaux. C’est la description littérale du travail de Nathalie et de ce cheval dans une prairie. C’est comme ça que je travaille. J’ai de petits bouts de textes un peu partout et, à un moment, je n’ai même pas besoin de les relire, ça passe dans Annie. Le souvenir de Nathalie – Nathalie qui fait le pain, etc. – est passé dans Annie. Ce n’est pas pour ça que Nathalie est Annie. J’étais émerveillée de la voir avec ce cheval, puis émerveillée de la voir avec ses mains et ses cheveux et la farine et puis, quand j’ai inventé Annie, elle est venue, comme une actrice qui viendrait jouer ce rôle-là. En fait, je n’invente pas grand-chose. Les choses s’articulent un peu bizarrement mais je ne les invente pas, je transcris parfois mes rêves :
« Il s’est tourné vers l’horizon, et sa figure, on aurait dit un arbre. Un petit tronc sans branches, une petite souche au visage radieux. J’ai cherché des racines, il n’y en avait pas. C’étaient des pieds. » ( Sauvage )
Ce changement de frontières va dans tous les sens, avec cette idée de joindre le haut et le bas chez Blanche qui voulait faire communiquer la forêt et le ciel. Il y a quelque chose de très satisfaisant quand on ferme le livre : on a l’impression que le haut,le bas, les côtés, sont rassemblés.
C’est un volume ? Oh, c’est chouette.

Enfin, si tu devais vivre dans un de tes livres, ce serait dans lequel ?
Il y a un livre que je n’ai pas écrit et que je pense que je n’écrirai pas et c’est pour ça que ça me ramène à l’endroit où je voudrais vivre même si je ne pourrais pas. J’ai fait plusieurs voyages au Mali et j’ai des amis vraiment très chers là-bas et, une année, j’avais dit « j’aimerais vraiment pouvoir me poser un peu et écrire ». Avec mon amie algérienne Hajar, on s’est posées dans une maison en bordure de Bamako, en bord de brousse et on a vécu là pendant une semaine pour écrire. Je voulais écrire sur le Mali. Il y avait le gardien qui vivait là avec sa famille, il y avait ses neveux, c’était plein d’enfants, une vingtaine, plein de monde, la vieille dame... Et on a vécu avec ces enfants, dans cette maison. Et c’était le début de quelque chose pour l’écriture, c’était le début de quelque chose pour regarder en face ce que c’est que d’être une Blanche dans cette magnifique maison en bord de brousse. C’était bizarre, mais ça me permettait de regarder en face un truc de Karen Blixen, « j’avais une ferme en Afrique ». Parfois on riait car on se disait que c’était tellement cliché. Il a fallu affronter les clichés que je portais en moi, qui sont des clichés coloniaux mais qui se traduisent sous forme de désirs. Le cliché colonial, on peut le déconstruire intellectuellement mais le désir qui naît de ce cliché colonial, il est encore réel, il faut le dégommer. Là, il y a vraiment un travail à faire et, pour moi, ça ne pouvait se faire que là-bas. Je n’ai pas écrit une ligne et je n’écrirai pas une ligne parce que ce n’est pas ça que je fais quand je suis là-bas, là-bas, je suis avec les gens, je parle, je suis avec les enfants. J’écris pour eux. On a dessiné ensemble. Il y avait un petit garçon qui s’appelait Kalifa, il avait neuf ans et, au Mali, quand il y a des invités, l’hospitalité est la première valeur. C’est même dans la culture, il y a un mot pour dire cela, « diatiguiya ». L’hôte est sacré. Ça me renvoie à mes taches aveugles, il y a du travail. Et puis, il y a un enfant en général qui est désigné pour prendre soin de l’hôte. C’était Kalifa qui s’était auto-désigné. On a fait deux séjours là-bas. Le premier séjour, il nous a apprivoisées.
C’est génial que ce soit un enfant qui prenne ce rôle-là.
Oui, en général, c’est un garçon, parfois l’aîné. Lui, il était très sérieux, il voulait être écrivain. Il était tout le temps avec nous, il prenait soin de nous, il était merveilleux. Il allait à l’école puis il courait nous voir. Il était génial. Il m’a vraiment appris quelque chose de ce que c’était de « prendre soin ». J’ai été super heureuse et puis, je me suis dit « ah tu as été super heureuse car tu as fait ta Karen Blixen avec ta copine », ça ne pouvait pas durer. Aussi, on travaille concrètement sur des tables rondes, sur Toni Morrison et c’était passionnant. Je me suis dit « qu’est-ce qui m’a rendu si heureuse là ? ». Je pense que c’est le rapport de sororité avec mon amie et le rapport d’amitié avec ce petit garçon et le fait d’avoir vécu là. Je ne dirais peut-être pas que je voudrais vivre là et ce n'est pas un de mes livres mais c’est en tous cas un moment où l’écriture a été en jeu, où il y a eu un livre qui a commencé à se construire, où je me suis dit sur place « je ne vais pas écrire le livre, je vais le vivre ».
On retrouve aussi cette relation aux enfants dans Sauvage, le fait qu’on est plus à l’aise avec un enfant parfois… Il n’y a pas de frontière entre lui et les ombres, il reste perméable.
L’enfant ne triche pas. Quand Kalifa est venu nous dire au revoir, il pleurait, il pleurait, il pleurait et j’avais envie de lui dire « arrête » mais, en fait, c’est moi qui me défilais et il m’a dit « de toutes façons, tu vas oublier mon nom ». C’était en 2016. Régulièrement, je me dis « non, je n’ai pas oublié son nom et, un jour, j’y retournerai ». Les conditions de l’attachement, c’est qu’on va souffrir à la séparation. C’était ça la leçon de ce voyage, c’est ce livre-là que j’écrirais si je n’étais pas farcie et pétrie de fictions coloniales..
C’est lié à la question de légitimité.
Oui, je préférerais retourner revoir Kalifa et écrire un livre avec lui plutôt que d’écrire sur lui. Par rapport à ce travail de déconstruction des clichés coloniaux, c’est vraiment au Mali que je l’ai compris. J’ai commencé à y voyager en 2003. Je pensais que déconstruire, c’était s’asseoir à sa table, lire des philosophes et réfléchir mais, en fait, je me suis rendu compte que si on n’est pas devenus un peu fous ou qu’on n’a pas complètement craqué, qu’on n’a pas passé une semaine au lit avec de la fièvre, rien n’est déconstruit parce que c’est dans l’inconscient que ça doit se faire. C’est hyper lent et quand on tient des discours de déconstruction alors que ce n’est pas déconstruit dans l’inconscient, il y a une sorte de malaise qui s’installe. Ça devient du puritanisme parce qu’à l’intérieur, ce n’est pas ok. À chaque fois, je crois que j’y suis, puis je retourne là-bas et, après deux jours, je me dis « tais-toi ».
Dans Sauvage, tous ces pas de côté autour du discours sur l’adoption, ça nous renvoie aussi à nous, lecteurs, qui avons cette impression de nous déconstruire en lisant.
Selon moi, lorsqu’on traverse une phase de surplus émotionnel, c’est le moment où les choses se déconstruisent pour s’agencer autrement, c’est un moment où il faut s’arrêter, juste respirer, être en lien. Ça devient chronique quand on essaye de glisser ces sensations sous le tapis. Je parle de ces mots que l’on entend de plus en plus : « je vais craquer ». « Mais, craque ! Vas-y, craque, tu te relèveras et, entre-temps, tu auras laissé deux-trois neurones périmer et tu en auras d’autres ».
Dans Sauvage, il est dit qu’il n’y a pas de lieu pour s’arrêter et réfléchir aux mots que les autres font porter sur nous pour nous qualifier. Cette notion d’arrêt par rapport aux choses qui pèsent sur nous, justement celles plus négatives, permet de nous arrêter aussi nous-mêmes et de faire le point.
Et c’était le but des blancs, de laisser de grands trous, c’est pour qu’on puisse faire une pause, laisser remonter les résonances. Le mieux, c’est quand même les copines. Et c’est dans le livre aussi. Il y a plein de femmes à qui je peux téléphoner et dire « waw, j’ai repéré un truc », « je suis en colère sur un truc et je ne comprends pas pourquoi ». La thérapie, c’est une chance mais les amies, avec qui on construit du sens, c’est autre chose. L’histoire de la culpabilité, c’est intéressant. C’est un peu en filigrane dans le livre. Si on se sent coupable, c’est qu’on a l’impression d’avoir fait une faute, mais une faute par rapport à quel idéal ? Et là j’ai eu des conversations intéressantes, par rapport à l’échec ou la réussite de l’adoption. « Je suis coupable, je n’ai pas réussi l’adoption de mon enfant ». « Et donc tu voulais réussir l’adoption de ton enfant, tu voulais réussir quoi, le sauver ? » Ça part mal cette relation sur cette base-là.
Il y a à nouveau ce rapport de force dans l’adoption où on se place en tant que sauveur.
Oui et ça devient du colonialisme charitable. Le retour de mon frère, dans le livre, où il se fâche en disant « tu ne peux pas dire ça et juger les parents », il est très juste aussi car c’est reconnaitre que les parents ne sont pas des super-héros et qu’ils ont essayé. Après, je trouve ça cher payé parce que lui a dû tenir ce sentiment de gratitude toute sa vie et n’a pas pu en parler. Le coût est cher pour un enfant qui n’a pas fait de choix mais je comprends aussi qu’il dise « tu ne touches pas à ça, j’ai une relation avec eux, elle est peut-être foireuse, mais elle existe et, pour moi, elle est importante donc tu vas pas la salir ». Et ça, j’ai mis du temps à le comprendre.
Et il y a ça aussi, tu le dis, par rapport à la ligne de partage qu’on pourrait faire entre des enfants adoptés et non adoptés dans une famille alors que, dans ta famille, cette ligne-là ne prévalait pas. C’est à cause du fait qu’on place des étiquettes sur tout, sinon on ne les verrait pas, ces lignes inconscientes qu’on trace entre les choses.
N’est-ce pas dangereux pour le concept de famille ? Ce concept fait quand même partie de cette affaire de « patrie-famille-dieu ». Si, tout à coup, une famille, ce n’est plus des liens du sang, alors comment se passe l’héritage ? J’ai lu un livre vraiment intéressant de Marie Lemeland dans lequel elle interroge sa condition de bâtarde. Elle a appris très tard qu’elle n’était pas la fille biologique de son père mais elle a été élevée par lui. Cela ramène toujours à cela : il faut maintenir la famille comme une institution, mais qui dit ça ? Dans le cas de mon frère, ce n’était pas un enfant tout lisse et une page blanche qui arrivait, c’était un enfant qui avait plus d’expérience de vie que nous tous.
C’est intéressant ces marques sur le corps qui sont décrites, ces trois années inconnues dans « les replis de peau » de ton frère. Cette acception qu’un corps porte des marques du fait qu’il ne nous dit pas tout.
Je trouve très belle la pensée « puisqu’on ne sait pas, on peut inventer » et l’identité, ce n’est pas figé, on peut la créer, mais si l'idée de se réinventer fonctionne, ça marche pour une petite fille qui a grandi et qui est toujours en lien avec son lieu de naissance, avec tous ses points de repère. Par contre, dire à quelqu’un qui est en perte complète de repères, et de qui on sent bien qu’il y a quelque chose qui ne s’accroche pas, qu'il peut tout inventer, c’est violent. C’est comme dire « saute, vole » mais il n’a pas d’ailes.

Un autre discours que tu déconstruis c’est celui autour de l’école. Tu dis dans les interviews que tu as plutôt appris dans les compagnies théâtrales que tu as suivies et, dans Les Cerf, à la friterie, Ian dit de Blanche :
« Son école, c’est le ruisseau. Elle veut un petit paquet, mayonnaise à côté. »
L’école est aussi une institution hyper verticale avec la réussite tout en haut.
Et l’exclusion des gens qui ne correspondent pas. Je me souviens d’avoir donné cours à une classe de théâtre où il y avait énormément d’échecs dans toute la classe à Noël et donc on s’est dit « bon ok, on ne fera pas de théâtre ou alors du théâtre qui aidera à ce que vous réussissiez tous à Pâques et on veut que vous réussissiez tous à Pâques ». Je donnais cours de déclamation en flamand. Les gens qui étaient pétés en flamand devaient travailler un poème en flamand, pareil en anglais, etc. Le mercredi après-midi, on avait tout le groupe en interannée, on faisait un jeu de questions pour un champion » où les plus âgés interrogeaient les plus jeunes. Le groupe s’est soudé. À Pâques, le nombre d’échecs s’était réduit à quatre, et il y a des parents qui nous l’ont reproché. « Ma fille, elle avait très bien partout, maintenant, elle n’a plus que satisfaisant », mais elle avait réussi. Grâce à elle – elle fait partie de la classe – il n’y a plus que quatre échecs. Certains élèves disaient « on a notre scolarité, on doit quand même réussir » et d’autres disaient « mais non il faut qu’on réussisse tous ». Et c’était un des débats intéressants.
Entretien réalisé avec Véronika Mabardi le 10 décembre 2022 chez Côté Gourmand à Schaerbeek.