Penser à respirer
Tristesse calcaire ou le délitement d’un corps
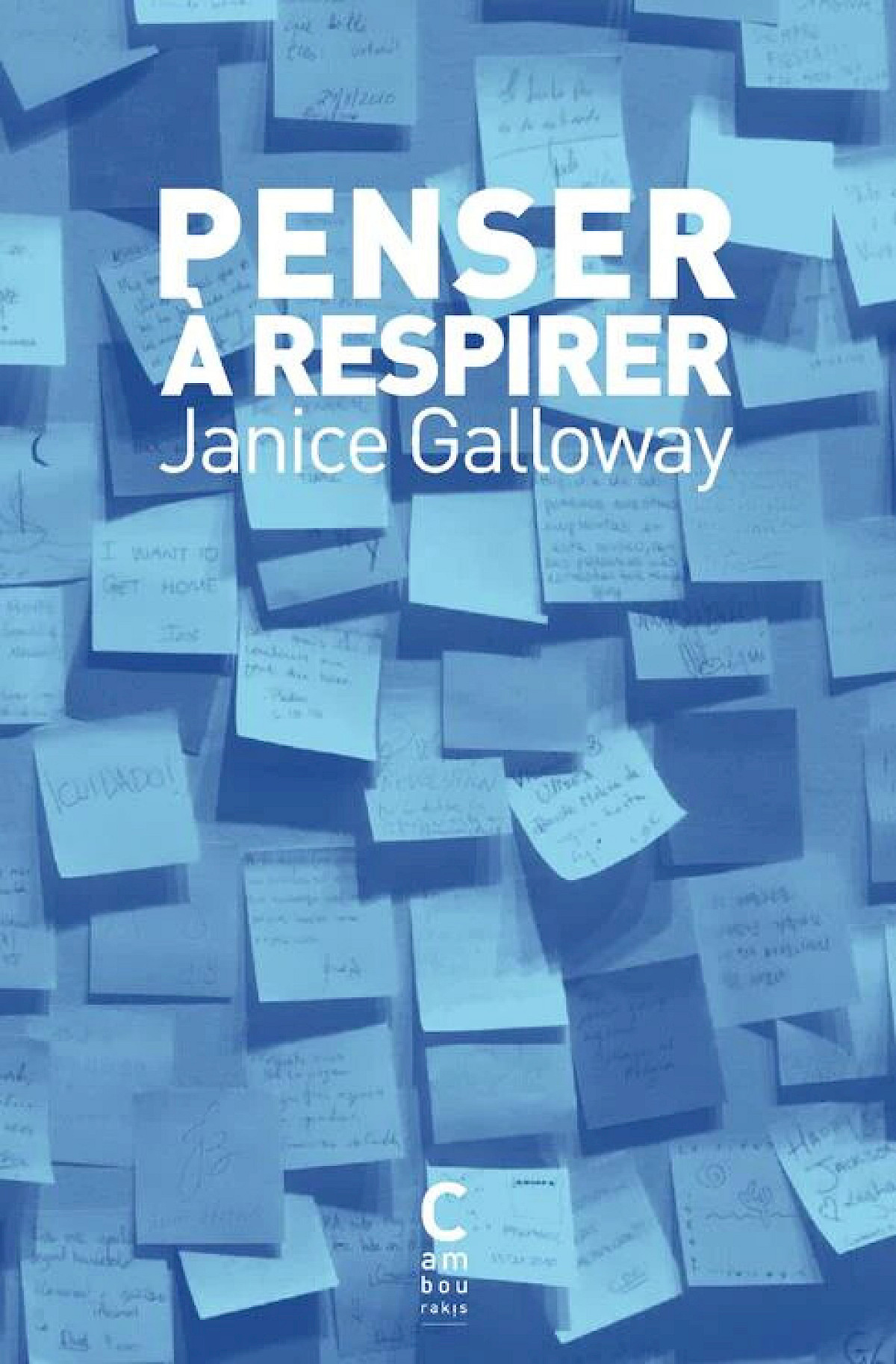
Tout à la fois journal d'un deuil, d'une chute, d'une errance et d'une reconstruction, Penser à respirer, premier roman de l'autrice écossaise Janice Galloway publié en 1989, est réédité cette année en poche par les éditions Cambourakis.
Je m'observe depuis le coin de la pièce assise dans le fauteuil, au pied de l'escalier. Dehors, une petite lune blanche apparaît au-dessus de la palissade.
Ainsi commence le récit d'une douleur. Cette douleur, c'est celle de Joy, infligée par la perte de la personne qu'elle aime/aimait, amplifiée par l'impossibilité de faire son deuil, par l'illégitimité de leur relation que la situation lui renvoie, par l'obligation de lui survivre, d'y survivre.
Bien qu'elle ne soit pas directement nommée par la narratrice, la douleur ressentie se raconte malgré tout en passant par d'autres chemins que celui des mots, tous reliés à un corps qui se fait de moins en présence au fil des pages. Le nom de la narratrice, Joy , n'apparaît d'ailleurs lui aussi qu'une seule et unique fois au milieu du récit. Comme tant d'autres choses dans le livre qui ne trouveront pas de mots pour les envelopper, pour les dire, la douleur est bel et bien là, contenue et exprimée dans chacun des gestes qui font le quotidien de celle qui écrit jour après jour dans son journal. Journal d'un deuil tout autant que témoignage d'une disparition - la sienne - donnée à lire aux lecteur·ices. Parce que quelque chose est arrivé, et alors la présence a été rendue impossible. C'est à partir de cette situation que débute l'histoire.
Je lève les yeux vers le plafond, vers l'étage, puis je regarde de nouveau mes mains. Il faut que je me concentre : un doigt à la fois, je relâche la pression, je retrouve mon équilibre dans le fauteuil pour compenser l'inclinaison, je m'adapte, je redistribue les parties de moi-même. Mes mains sont vraiment pénibles : trop de petits morceaux distincts. Les muscles de mes cuisses se tendent à mesure que mes pieds prennent appui sur le sol. Mon estomac se noue pour supporter mon poids quand j'aurai quitté le fauteuil, chancelante mais debout. J'ai mal aux genoux. Je bouge, ignorant le tapis qui cherche à s'insinuer à travers mes semelles.
Le récit est celui d'une dépression qui s'installe et grossit toujours plus au fil des pages. Racontée à la première personne, cette voix n'en est presque pas une, n'en est pas toujours une. C'est un je qui dit les gestes nécessaires à la survie, qui raconte méthodiquement les tentatives pour garder la tête hors de l'eau. Pour résister à la noyade, à la sienne mais aussi à celle de Michael, son amant, qui se raconte par à-coups au fil des pages, à la manière de flashbacks intercalés en travers des jours couleurs lame de rasoir que vit Joy au moment où elle écrit. La douleur éprouvée se fait ainsi entendre dans l'écart silencieux glissé entre les mots rassemblés par l'autrice du journal, mais aussi dans le délitement progressif du corps de la narratrice que ses gestes et actions nous donnent à voir. Contenant vide, vidé, évidé au fil des pages. Il n'y a plus ni dedans ni dehors, il n'y a plus qu'une espèce de nulle part, il n'y a plus que l'impossibilité d'une présence.
Des rituels
Qu'est-ce que je vais faire, pendant que je tiens le coup, Mariane ? Qu'est ce que je vais faire ?
Cette phrase prononcée à l'intention de celle qui apparaît comme l'une de ses seules amies revient à de nombreuses reprises dans le livre. Prononcée encore et encore, la formule se fait motif ou ritournelle, revient sans arrêt pour nous rappeler la perte de mouvement qui infiltre chaque fibre de son existence.
The Trick Is to Keep Breathing1 , le titre anglais de l'ouvrage nous donne un indice de l'épreuve à surmonter que sa traduction française nous permet d'oublier : la disparition ou le trop plein de sensations demande à cet endroit une prise de contrôle sur le quotidien. De penser, de réfléchir chaque chose, chaque action parce que la vivre simplement n'est là encore plus de l'ordre du possible. L'important est de trouver le moyen de remplir le temps, méthodiquement . Penser à respirer , parmi tant d'autres choses, se donne alors comme une astuce ou un moyen de continuer à (sur)vivre pendant que le temps passe et que l'anesthésie opère.
Ce soir, de nombreuses possibilités s'offrent à moi :
trois feuilletons à l'eau de rose / quatre séries comiques / quatre jeux télévisés / une série à succès/ deux films catastrophe / un western / deux débats / un documentaire animalier / deux documentaires de société / six journaux télévisés plus ou moins longs / trois retransmissions sportives / une enquête sur le paranormal / une émission religieuse
L'expérience paranormale, c'est à onze heures et demie. En attendant qu'il fasse nuit, je m'efforce de sortir de ma propre peau pour gagner le coin de la pièce.
Regarder la télévision fait partie des quelques activités possibles à Joy pour remplir les minutes et attendre de tenir le coup . Des activités, Mariane lui en avait proposé toute une liste comme écouter la radio, prendre un bain, écouter des disques, lire, se promener, recevoir du monde, etc. Parmi toutes celles-ci, un grand nombre n'est pas réalisable, ou alors difficilement. Pas en l'état. Même si Joy répète tout au long du récit n'être dans aucun état. Dans celles que Joy réussit malgré tout à faire, il y a la récurrence maniaque de l'horoscope, le découpage de magazines mais aussi l'ensemble des rituels réalisés dans la maison et vis-à-vis de son corps.
Coudre et sortir dîner. Une juxtaposition délicate. Avant, je cousais beaucoup. Cela m'occupait, Dans la journée, j'allais à l'école et le soir, je coupais du tissu. Je coupais le tissu à l'aide de patrons puis j'assemblais les morceaux. Les piqûres d'aiguilles me durcissaient le bout des doigts et laissaient de petites égratignures, à côté des bleus que je me faisais en poussant les meubles, des brûlures du four et des marques sur mes ongles, à force de tout récurer. Des blessures domestiques. Je cousais à table, de mon retour du travail à l'heure que j'estimais être celle du coucher. Pendant les pauses, selon l'horloge, je préparais à manger, une soupe en boîte, un sandwich. De la nourriture fonctionnelle. Un soir, j'étais si concentrée sur un ourlet que j'ai oublié. Quand j'ai regardé ma montre, l'heure du dîner était largement dépassée. La faim ne m'avait pas interrompue. J'ai passé un long moment à réfléchir.
À la suite de cette réflexion, Joy décidera qu'elle n'a pas besoin de manger. Elle n'a pas besoin de manger comme elle n'a parfois plus besoin de dormir, comme son corps n'a plus « besoin » d'avoir ses règles. La présence s'estompe et pendant un long moment, tout est de moins en moins. Parmi les rituels qui remplissent ses journées, il y a ceux qui concernent la maison, son rapport à son corps, son rapport à l'alcool et à la nourriture. Tout est obstinément sous contrôle. Tenir le coup, tenir sa maison. Faire en sorte que rien ne transparaisse, que rien ne se voit, que tout continue d'aller.
Vendredi matin 10h23. J'ai un tas de choses à faire avant qu'elle n'arrive mais la routine est bien rodée, je n'ai donc pas besoin de réfléchir. Mon corps fonctionne sans moi, mû par les automatismes. Mes mains prennent le chiffon et essuient les robinets avant de rincer la tasse vide. Je commence à nettoyer la maison.
Laver la maison ou se laver, nettoyer une à une chaque partie de sa peau, gratter, couper, tailler, enduire ou se préparer se donnent comme autant de micro gestes emportant toute l'attention de la narratrice avec eux, et la nôtre avec, du même coup. Dans cette obstination à remplir le temps, chaque petit détail devient un événement en soi occupant tout l'espace disponible, une étape à ne pas négliger.
Pour déboucher une bouteille neuve, il faut prendre son temps. Elle me coûte presque toute ma paie du samedi. Toutes ces heures pénibles dans la fumée et l'argent des autres, pour rentrer à la maison puant les pièces et la nicotine. Je prends mon temps pour rompre l'opercule. Je sens craquer la cire qui cède sous mes doigts. Je tords le métal. Il est si fin qu'on sentirait presque la fibre du verre au travers. Le papier rose est joli. Le gin s'écoule avec le bruit d'un animal lapant du lait.
Cette plongée dans les détails d'un quotidien à vif, dont le témoignage ne s'extrait que très peu, s'ouvre malgré tout sur d'autres récits. Les événements vécus et racontés deviennent des occasions pour convoquer d'autres souvenirs faisant écho aux premiers. À partir d'un coup de téléphone reçu, Joy notera dans son journal les différents appels qui ont eu un impact sur le cours des choses. Chaque détail amène avec lui son flots d'épisodes passés : le présent raconte tout au long de la journée la douleur d'un vide qui frôle la sensation de trop-plein. Vider, nettoyer, supprimer, enlever, se donnent alors comme autant de manières de matérialiser ce qui s'éprouve au dedans sans dire l'émotion en tant que telle. Les mots de Joy disent les gestes qui font ses journées, et ces gestes nous racontent à leur tour ce que veut dire tristesse .
Tristesse calcaire
Le temps passe et vient le moment où le corps, les dents, le sang et le verre deviennent débris au sol. Comme une plongée vers des profondeurs sans surface, Joy s'immerge sans pouvoir remonter, malgré ses efforts pour tenir le coup. Malgré le fait de faire des efforts. La perte de consistance devient matérielle, physique, littérale.
du sang. Il y a du sang sur l'oreiller. Trois tâches brunâtres ourlées de rose. On dirait des bactéries sur un plat blanc. Je devrais aller chez le dentiste avant que cela n'empire. Mes dents sont en train de se déchausser. <<<[...] Ce n'est qu'en allant dans la salle de bains pour me laver que je remarque une trace le long de mon bras, une ligne rose sur le blanc immaculé de ma peau. Pas du sang. Juste une trace, droite et lisse. Une autre descend en pointillé de l'intérieur du coude au poignet. Une rangée nette de trois morceaux de verre pointus scintille sur le rebord de la fenêtre. Pas moyen de me rappeler quel jour nous sommes.
Je n'ai pas l'impression d'être là. Je ne suis pas vraiment réveillée. Je suis coincée dans une torpeur qui ne changera pas. Ni aujourd'hui, ni demain. C'est ainsi que sont les choses, désormais. De l'autre côté de la colline, les voitures roulent et les magasins ferment. Il faut que je supporte tout ça. Le temps passe par petits bouts, les choses changent sans raison.
Peu à peu, se raconte le délitement, l'effritement d'un corps vidé de sa présence. Tristesse calcaire ou corps poreux, des morceaux se laissent de ci de là sur le sol, dans les fauteuils ou à l'hopital. C'est à partir de là et de là seulement que sa rémission commencera. Récit d'une grande précision sur le deuil, la perte et la dépression, Penser à respirer est un récit à la fois dur et d'une grande sincérité. Justement parce qu'il raconte certains gestes réalisés quand les mots, la pensée, le désir ou l'envie désertent le cours du jour et de la nuit.