Sillages
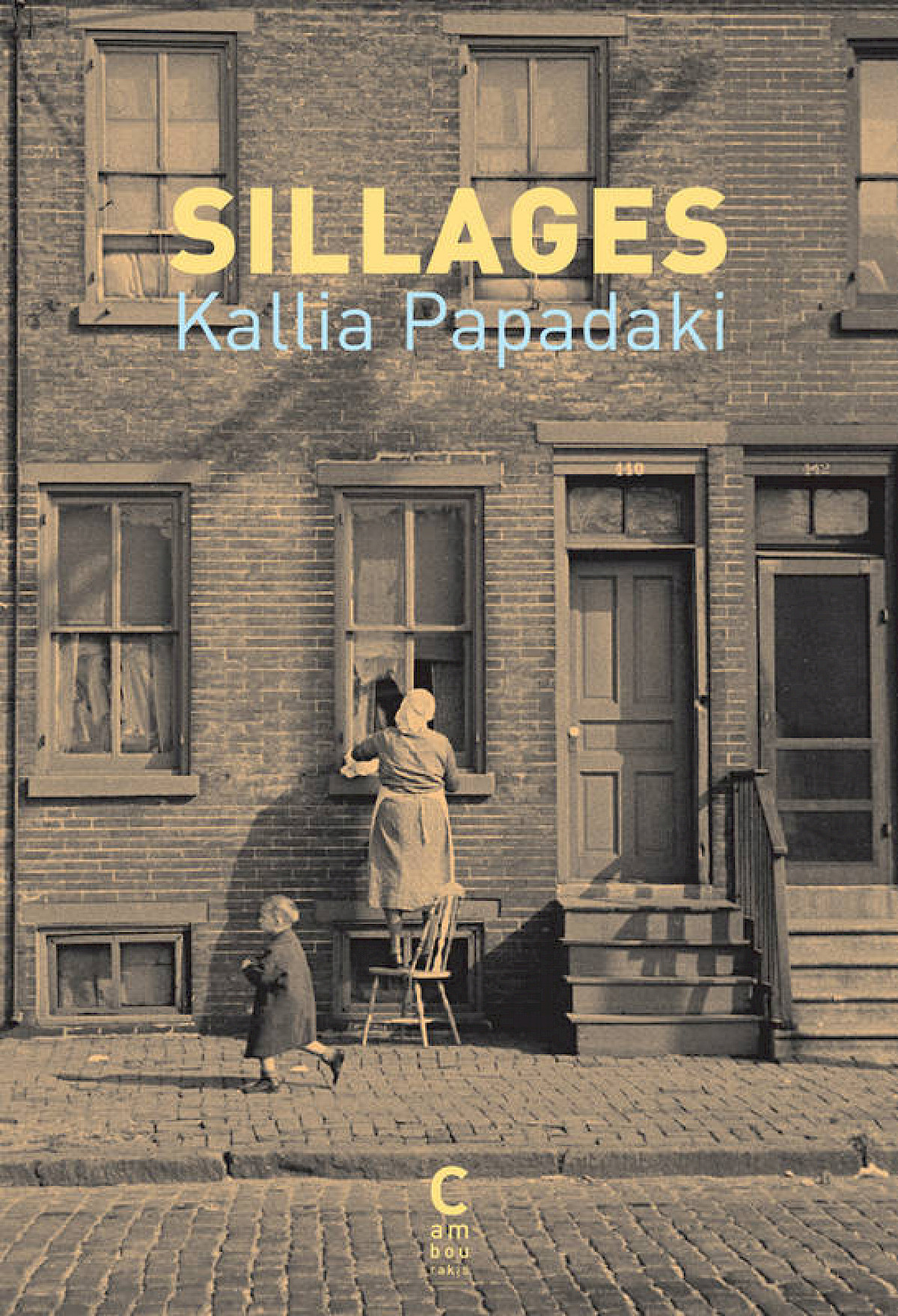
Sillages esquisse le parcours des immigrés aux États-Unis tout au long du XXe siècle, d’espoirs en échecs, de rêves en souffrances. Ce premier roman, fort et poétique, révèle une nouvelle plume de la littérature grecque moderne.
Juste après la Première Guerre mondiale, Andonis Kambanis, originaire d’une île du Dodécanèse, débarque à Camden, New Jersey. Cette ville américaine est alors en plein développement économique, grâce aux industries prospères, et de nombreux immigrés européens affluent dans l’espoir de s’y enrichir. Mais la chance tourne aussi vite que la croissance économique s’inverse, et les petites gens des États-Unis vont connaître de sombres périodes. De petit boulot en petit boulot, ouvrier, homme de main ou petit commerçant, Andonis maintient sa tête hors de l’eau, sans jamais cependant parvenir à s’extraire de la vase que constitue sa condition d’immigré grec de première génération. Soixante ans plus tard, son fils Basil se débat lui aussi avec des difficultés financières et familiales, et ce lourd héritage impacte également la troisième génération, à savoir Lito, fille adoptive de Basil, et Minnie, jeune orpheline recueillie par la famille.
À l’aide de multiples ellipses et analepses, les chapitres pairs relatent le parcours d’Andonis au départ des années 20, tandis que les impairs sont consacrés aux difficultés quotidiennes de Basil et de sa famille dans les années 80. Ce n’est que dans le dix-neuvième et avant-dernier chapitre que l’histoire du père rattrape l’époque du fils.
De nombreuses références historiques et culturelles concernant principalement les États-Unis et la Grèce sont disséminées dans le texte, sans plus de précisions, comme si le lecteur était censé toutes les connaître. Pour pouvoir les comprendre, il est souvent nécessaire d’aller consulter les notes explicatives consignées à la fin du livre, or ces aller-retours réguliers entre texte et dernières pages rompent le fil de la lecture. Il faut cependant reconnaître que ces anecdotes ancrent efficacement le récit dans les différentes époques.

Sillages est le premier roman de Kallia Papadaki et lui a valu le prix Clepsidra du meilleur jeune auteur de fiction ainsi que le Prix de littérature 2017 de l’Union européenne. L’auteure, grecque de naissance, a étudié aux États-Unis avant de revenir s’installer en Grèce. Ce n’est donc pas surprenant qu’elle s’intéresse aux gréco-américains. Kallia Papadaki n’est pas qu’écrivaine : diplômée de l’école de cinéma Stavrakos, elle exerce comme scénariste professionnelle. Cela se ressent dans son écriture, souvent qualifiée de très cinématographique.
En effet, ce roman est très visuel, mais fait également appel à l’ouïe, à l’odorat et au goût. Chaque scène est posée à l’aide de nombreux détails ainsi que d’images originales et poétiques.
« Basil Kambanis s’arrête un instant à l’entrée de la cuisine, son bras droit appuyé à l’encadrement de la porte soutenant le poids de son corps, comme s’il n’était pas sûr de devoir franchir la ligne imaginaire qui les sépare depuis l’avant-veille, Susanne lui tourne le dos, elle se tient voûtée, le cou dans la continuité de ses bras qui s’agitent en permanence, à croire qu’ils ont été conçus pour le mouvement perpétuel, depuis que le monde est monde, se secourant l’un l’autre, de peur que ne s’altère ce qui les unit, et tandis que Basil pense à son prochain pas – en avant ou en arrière ? –, testant les points de la ligne de démarcation, une belle assiette en porcelaine glisse des mains de Susanne et se brise avec fracas dans l’évier (…). »
L’inconvénient de ces riches descriptions est la longueur abusive des phrases, dans lesquelles les virgules volent la vedette aux points. Les longues phrases ne me gênent habituellement pas, mais chacune devient ici un paragraphe à elle toute seule et leur lecture m’essouffle mentalement. La construction du roman est également fort dense. Il y a beaucoup de personnages secondaires, trop même, qui dispersent l’attention du lecteur. Certains semblent ne servir que d’excuse pour amener quelqu’un d’autre, à l’image de Minnie, personnage d’introduction qui ne fait par la suite que quelques figurations – petite pensée à Jean Dujardin dans Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Ce foisonnement de personnages empêche de faire proprement connaissance avec eux, d’autant plus qu’ils ne sont pas toujours directement nommés. Le malheureux résultat est qu’on voudrait s’attacher à eux sans y arriver.
Le lecteur contemple d’en haut, de loin, le parcours de ces générations successives d’immigrés. Chacun d’eux est entraîné dans le chemin creusé par ses parents et grands-parents et le poursuit bon gré mal gré, tout en essayant, en vain, de laisser une trace de son propre passage. C’est l’idée même du titre de la traduction française, « Sillages ». L’intitulé original, « Dendrites », évoque quant à lui les arborescences de la généalogie. Les personnages de ce roman ne sont que d’insignifiants maillons d’une immense chaîne humaine, chacun n’important finalement qu’en tant que partie d’un tout, déterminé par ses ascendances, et non comme pièce détachée poursuivant une destinée personnelle.
Pourtant, ces êtres ont leurs rêves (américains) de réussite, d’appartenance et de sens. Ils les poursuivent avec acharnement, sans trop s’apitoyer sur leur sort, et ce malgré les échecs systématiques qu’ils essuient. Leur fierté et leur détermination sont impressionnantes et émouvantes dans cette vie faite de secondes, troisièmes voire énièmes chances, où les espoirs déçus semblent la seule issue possible.
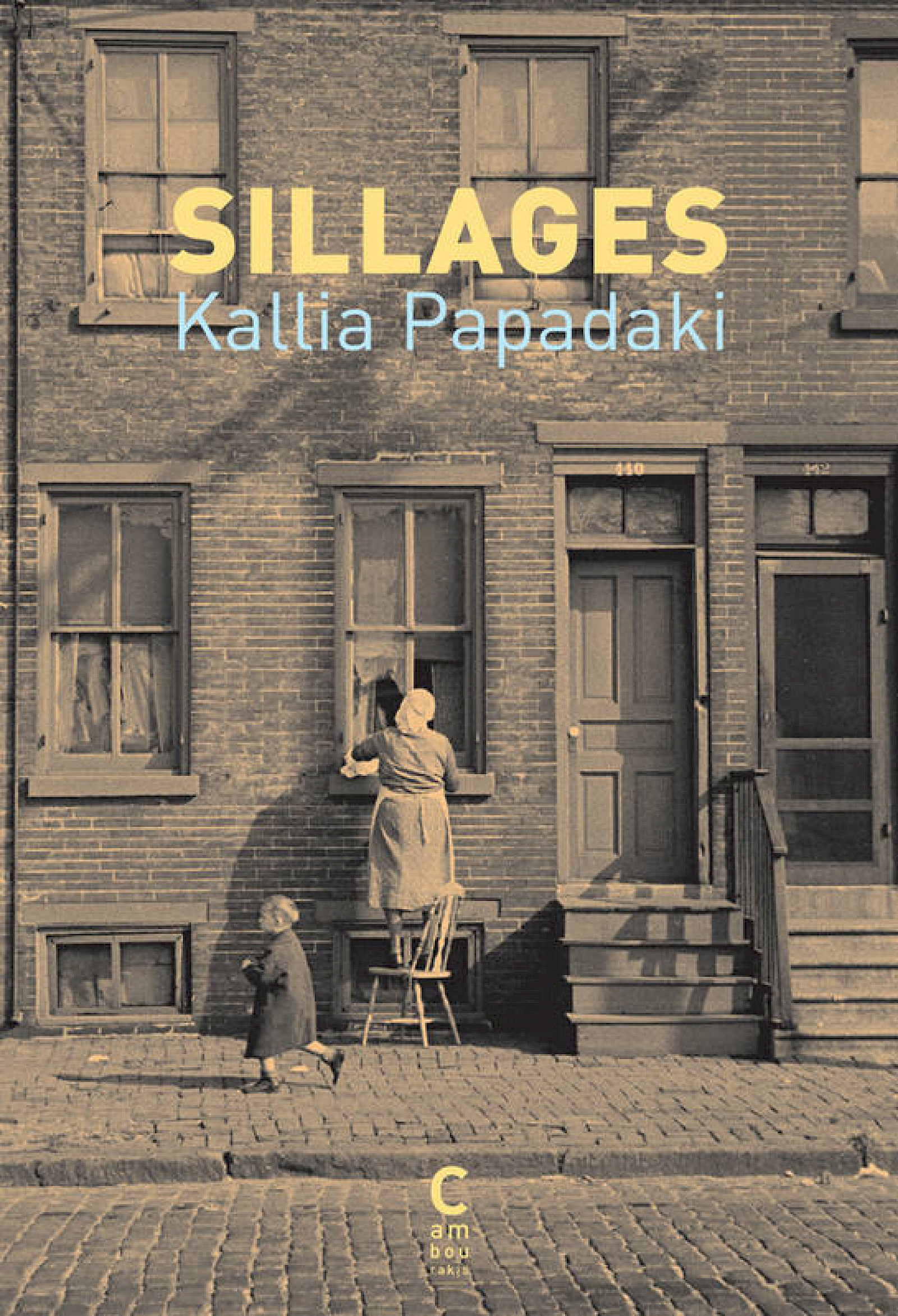
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce roman ne dépeint pas que des immigrés grecs mais aussi des Italiens, Irlandais… Toutes les communautés se côtoient sans essayer de se mélanger : chacune vit dans son quartier – les germanophones à Cramer Hill, les Juifs à Marlton et Parkside –, assiste aux services de son église, développe une solidarité interne et rivalités et méfiance envers les autres communautés. Au-dessus de tous ces immigrés de première génération plane la menace du Ku Klux Klan et des WASP eugénistes, ces descendants des pères fondateurs des États-Unis, premiers immigrés européens qui ont fixé la norme des trois adjectifs et stigmatisent tous ceux qui ne sont pas « White », « Anglo-Saxon » et « Protestant ». Une norme bien ancrée dans les mentalités, d’où les difficultés d’intégration encore rencontrées de nos jours par les Afro-Américains, les immigrés venant d’Asie ou encore d’Amérique latine, mais à laquelle ont plus ou moins su s’adapter les immigrés européens de deuxième et troisième générations.
Le vrai point fort de ce roman est sa poésie. Outre les citations de Walt Whitman et Nick Virgilio – deux poètes ayant vécu à Camden – à chaque début de chapitre, ainsi que les délicates images qui épicent les descriptions, une magnifique métaphore déroule son fil tout au long du récit. Kallia Papadaki voit dans les flocons de neige l’illustration parfaite de l’éphémérité de la beauté humaine. C’est pourquoi cette neige vient ponctuer les tournants du récit. Andonis, trois ans seulement après son arrivée aux États-Unis, manque de peu de périr sous cette blancheur glacée. L’histoire aurait pu s’arrêter là, presque avant d’avoir commencé. C’est aussi sous les flocons qu’elle se termine : « (…) la neige va bientôt tout recouvrir, les remords, les souffrances, les rues, les erreurs (…) ». La neige, blanche comme cette page vierge sur laquelle les immigrés doivent écrire leur histoire. Ou la neige souillée, comme les problèmes et la vie misérable dont Basil aimerait se débarrasser d’un coup de pied, mais qu’il traîne malgré lui comme le rocher de Sisyphe, entachant l’intérieur de sa maison et de son existence et se condamnant à un perpétuel recommencement.
Dans ce roman, on contemple depuis le ciel ces flocons humains tomber sur la terre du rêve américain. Ils se mêlent pour ne plus former qu’une couche d’apparence homogène et indivisible, jusqu’à ce qu’ils fondent inéluctablement et que leur beauté unique s’efface sans laisser d’autres traces que de vagues sillages.