La nuit Berlin de Claire Olirencia Deville
La quête inachevée et inachevable d’une jeune femme
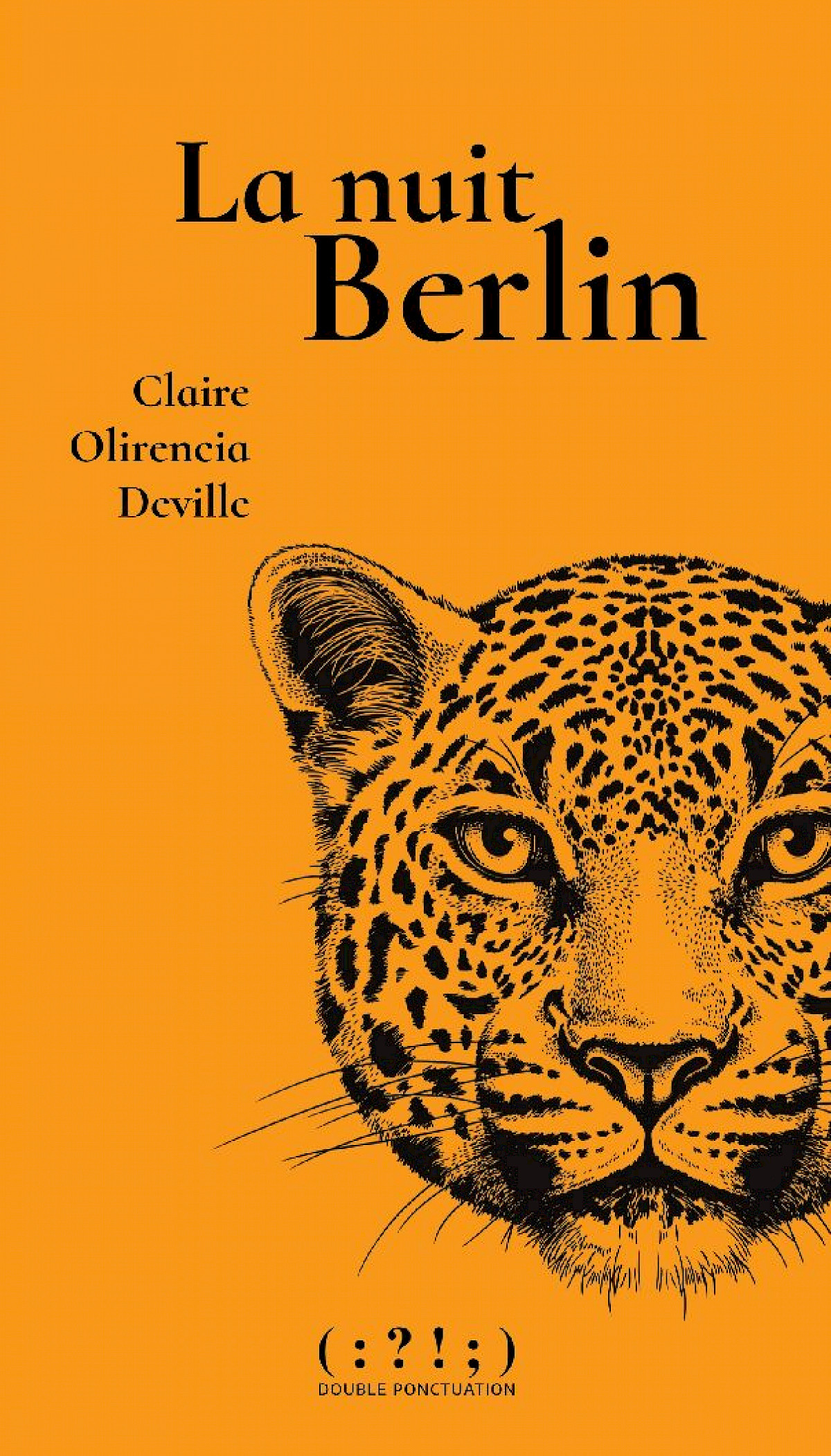
Dans La nuit Berlin, paru aux éditions Double ponctuation, l’auteure belge Claire Olirencia Deville interroge le brouhaha intérieur d’une jeune danseuse berlinoise, Nina. Les sens en éveil, le lecteur suit le parcours de cette jeune femme qui, au début des années 2000, chemine à travers les rues de Berlin et ses sillons intérieurs. Au-dedans et au-dehors d’elles-mêmes…
L’atmosphère d’abord écrasante, « entre les carreaux brisés, les murs de brique défoncés et les graffitis » qui composent l’« esthétique désaffectée quotidienne » de Nina, devient rapidement étouffante lorsqu’elle et son amie Kai se rendent danser au Clärchens Ballhaus. L’histoire promise semble commencer : Nina, perdue dans la salle, tente de retrouver Kai, « le sens de l’univers ». S’ouvre alors un monde « d’agression auditive et visuelle » qui emporte la protagoniste dans une transe dont elle parvient difficilement à se détacher. Les sons et les images évoqués nous invitent à entrer dans le délire berlinois et nous finissons, nous aussi, par nous perdre dans la foule. Ce malaise intérieur que nous connaissons bien se matérialise devant nous. Nina forme l’essence même de l’angoisse ressentie face à la perte.
S’ensuit un déchaînement d’odeurs, de bruits et de caresses non désirées. Les repères deviennent flous tandis que l’écriture nous décentre de la réalité perçue – d’ailleurs, Claire O. Deville insiste sur la « multiplicité des perspectives » tout au long de son roman. Nous évacuons dès lors le réel par le rêve, et inversement, le rêve par le réel. S’offre alors à nous un jeu d’indétermination, comme si l’auteure s’amusait à nous faire passer d’un espace-temps à un autre.
Au cours de cette nuit, nous comprenons le besoin de Nina de retrouver Kai. Nous comprenons les questions qu’elle pose aux personnes autour d’elle : « où est-on ? », « qu’est-ce qui se passe ? », « qu’est-ce qu’on fait ici ? ». Où est-on ? Où est-elle ? Emportée sur une île de la Spree sans savoir ni comment ni pourquoi, Nina tente de comprendre ce qui lui arrive. « Tu es là, mais tu n’es pas là », lui dit un personnage. Nous prenons alors conscience de la réelle quête dont il est question. Pour Nina, retrouver Kai constitue sa petite quête. Une petite quête, certes manifeste, mais qui anime une autre quête, sous-jacente, et pourtant bien plus grande… D’ailleurs, Claire O. Deville fait répondre cette prise de conscience par la forme de son écriture.
En effet, la force de son style est, non seulement, de poser des questions textuelles, lisibles et repérables par le lecteur :
« Si j’avais su. Mais qui savait ? » « A-t-on moins mal dans le noir ? »
; mais aussi de ces questions sourdes que l’on n’ose pas prononcer à voix haute, même à l’écrit :
« Le monde a glissé sous mes pieds au moment précis où je prétendais trouver du sens à ma vie. »
« Mais rien n’a de sens, tu sais. Tout ça n’est pas grave. Ne t’inquiète pas. Tu verras bientôt, très bientôt. »
Si rien n’a de sens, quelle quête guide notre existence ? N’est-ce réellement pas grave ? Ne devons-nous pas nous inquiéter ? Que verrons-nous ? Pouvons-nous trouver un repos à ce malaise intérieur, à cette « ombre noire », cette « présence malveillante » ?
Parfois, l’auteure fusionne plusieurs questions en une seule, haletante :
« Liberté liberté liberté quand a-t-on senti ce sentiment de liberté pour la dernière fois à quel âge dans quel endroit est-ce qu’on peut le revivre parfois comme trop d’air qui rentre dans la poitrine ? »
Les pages transpirent alors, tout comme les lecteurs que nous sommes.
Mais puisque tout est entre-deux dans l’écriture de Claire O. Deville, cet incessant questionnement est balancé par de nombreuses affirmations qui tentent d’amener le regard vers une aube, un possible : « Je crois que j’irai mieux bientôt. »
L’auteure referme alors sa première partie. Soulagés, nous relâchons les épaules, et entamons la deuxième qui se déroule quelques années plus tard. Mais une inquiétude, plus douce, nous reprend quelques pages plus loin :
« Avant je me droguais la nuit pour danser plus, et je croyais que ça irait. »
« J’avais cru m’en délivrer, cru que danser droguée jusqu’au bout des nuits jusqu’au bout de toutes mes vies serait une échappatoire suffisante. Cru ensuite que le comprendre allait tout régler. Comment ça c’est pas assez. »
L’aube promise est-elle atteignable ? Croire, c’est penser que quelque chose est réel, véritable, ou du moins possible. Croire, c’est accepter l’illusion tout comme son contraire. Lorsque sa fille, Mia, se trouve loin d’elle, Nina retrouve la compagnie de ces anciens souvenirs et questionnements comme s’ils n’attendaient que cet instant d’absence pour ressurgir. Quel est le sens de son existence ? Que doit-elle faire du temps qui s’offre à elle lorsqu’elle se retrouve seule ? Face à ce vide et cette absence, elle angoisse, encore. Alors, elle reporte cette angoisse sur d’autres qu’elle, et a « presque envie de demander aux gens s’ils n’ont pas faim ou envie de faire pipi, histoire de ne pas être trop dépaysée ».
Claire O. Deville fait ainsi de la perte de Kai dans la foule la quête évidente de Nina. Mais au lecteur de lire entre les lignes puisque la quête qu’entame Nina, sous-jacente et pourtant majeure, est identitaire. Elle se perd, se construit, et se perd à nouveau.
L’écriture de Claire O. Deville devient dès lors celle de l’écho. Un écho entre les mots et les phrases, un écho entre les premiers et derniers paragraphes : de « Nous avions pourtant l’impression de révolutionner le monde, ce qui n’était pas totalement faux puisque nous changions le nôtre. » en page 11 à « J’ai senti dans cette douceur la conviction qu’on pouvait juste changer le monde, en commençant par le nôtre […] » à la page 143. Nina passe d’une impression à une conviction, ce qui permet d’espérer atteindre l’aube.
Mais le doute est constant, « tout est faux, tout est vrai », et l’inachèvement dynamique : « jour après jour j’ai réalisé que j’avais été dépossédée de mon corps, par allez au choix : le patriarcat, une éducation globale à tendances toxiques, et de manière générale les injonctions racistes, sexistes, grossophobes, queerphobes et validistes de la société, rien que ça. Je vous rassure quand on les identifie, ça ne va pas mieux. »
Un écho entre une petite quête et une plus grande, existentielle, pourtant inachevée et inachevable : « Tous les jours me pesaient, et tous les jours me pèsent encore de cet écrasement de nos vies, de nos envies, de la formidable machine à exploitation de nos corps. »
La recherche identitaire est, en effet, permanente, puisque le gain d’une partie d’identité ne vient jamais combler la perte d’une autre : « Cela tourne perpétuellement dans ma tête […] »
La quête de Nina est alors inachevée, car elle ne cesse d’osciller entre construction et perdition, et inachevable, car il y a la nécessité à ce que son identité lui échappe. Il lui faut ce vide pour continuer à sillonner les rues à la recherche de l’aube.
Alors, « Tu sais, maman. Un papillon ce n’est qu’un ver avec des ailes ». Peut-être que ces quelques mots résument à eux seuls la quête dont il est question. Peut-être « Que je ne m’étais pas trompée, que je ne m’étais pas trompée quand j’avais compris dès le début que nous pourrions construire quelque chose de différent, qui ressemblerait si fort à un rêve. Tout a changé. Les papillons, ce ne sont que des vers avec des ailes ». Claire O. Deville ouvre ainsi une voie à emprunter pour lutter contre notre détachement et « notre résignation à la tristesse du monde ». La vie, ce n’est qu’une oscillation entre une aube et un crépuscule, à chacun de nous de cheminer d’un bout à l’autre.