Les Corps sensibles de Patrick Delperdange
la dédramatisation de l’atroce banalité
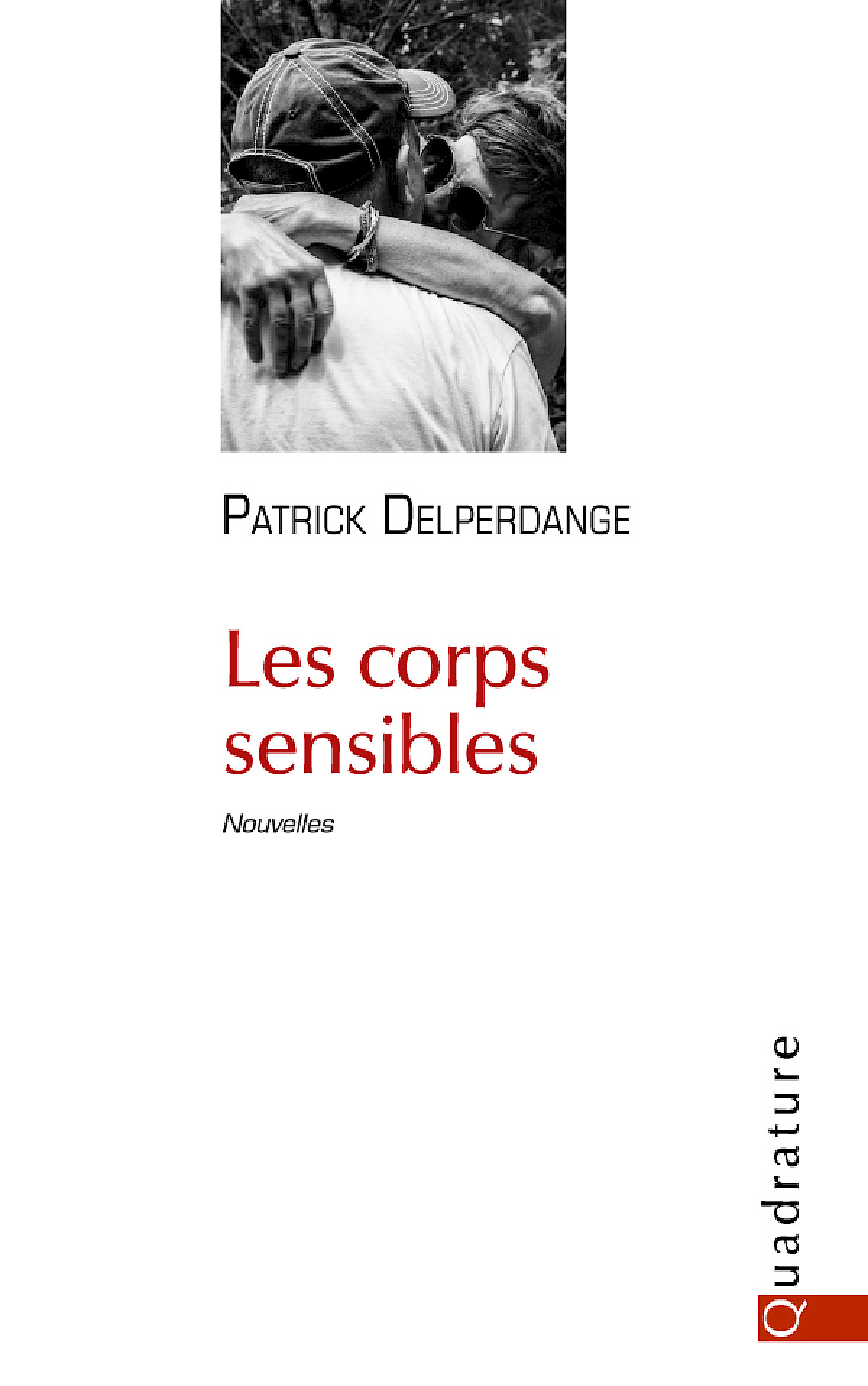
Avec Les Corps sensibles, Patrick Delperdange propose de parler des corps humains, de leur passé et et de leur présent, mais surtout de l’esprit qui s’y incarne. Entre peinture de mœurs et nostalgie, le recueil − récemment récompensé du Prix Renaissance de la Nouvelle 2024 − aura malheureusement vite fait de nous énerver.
Au sortir de ma lecture, le sentiment est trouble. Ce recueil m’a touché, mais pas de façon positive. C’est plutôt un sentiment d’exaspération, de dégout, de colère. Ces nouvelles sont frustrantes parce qu’elles ne sont que le portrait de mœurs qu’il s’agirait davantage de mettre à mal. Et on ne sait pas – mais on l’espère, on le suppose – que l’auteur est critique de son époque en écrivant ainsi. Pourtant, une pensée subsiste : n’y aurait-il pas eu moyen de proposer autre chose ?
Patrick Delperdange emploie un style fluide et efficace, essentiellement visuel. Il parvient à rendre vivantes les scènes qu’il dépeint grâce à des mots choisis avec économie. Une simplicité qui, hélas, peut parfois manquer de relief et que j’aurais aimé voir dépasser afin de caractériser davantage les différentes narrations du recueil, celles-ci demeurant relativement homogènes.
« Les pas perdus de la cigogne », première nouvelle du recueil, nous présente avec retenue l’itinéraire de Céleste, chercheuse et enseignante congolaise venue à Bruxelles pour rencontrer les responsables du musée de Tervuren, ainsi qu’un vieil homme dans une maison de repos. Le texte se démarque par son travail sur le non-dit, une ouverture à l’interprétation qui infuse le recueil. Malheureusement, cette qualité se découvre à double tranchant par la suite lorsque des tropes fatigants et des travers narratifs s’invitent de façon douteuse. Faut-il y voir un jeu littéraire ou les simples biais de l’auteur ? Quoi qu’il en soit, le résultat se révèle pour moi déplaisant.
De fait, dès la deuxième nouvelle « Trouble-fête », mon appréciation s'est détériorée. Englué dans une ambiance de nostalgie poisseuse, le texte présente d’anciens élèves qui se retrouvent à une soirée organisée par leur école secondaire. Ils y rigolent du passé, critiquent leurs camarades de l'époque ayant mieux réussi leur vie, et s’inquiètent de l’absence d’un des leurs. Ils ont entre quarante-sept et quarante-huit ans. L’alcool coule. Et le personnage de Ranier finit par agresser une adolescente de seize ans sur la piste de danse.
La fille de Marini essayait de se dégager de l'étreinte de Ranier, en le repoussant des deux mains.
« Arrêtez ça tout de suite, dit-elle.
— C'est comme ça qu'on danse les slows, dit Ranier d'un air faussement innocent.
— Il m'a mis les mains aux fesses, déclara la fille en se tournant vers son père.
— On a toujours fait comme ça, dit Ranier. Vous êtes bien prudes, vous les jeunes. »
Il la laissa s'en aller, après quoi il revint près des autres avec un large sourire, comme si tout cela n'avait été qu'une simple plaisanterie.
La nouvelle pourrait vouloir condamner l’évènement, mais personne n’est outré, et la soirée continue son cours. L’histoire dédramatise. Ce n’était qu’une « simple plaisanterie ». Et le problème, c’est que le recueil cumule ce genre de procédés, où les actions ne portent pas à conséquence, où le mal n’est qu’une banalité à observer. Le texte montre, mais rien n’est mis en place pour dénoncer. Aussi, sans une remise en question des actions des personnages, le seul sentiment qu’on a au sortir de la lecture, c’est que le recueil, à cause de son détachement, de son manque de prise de position, essaye de nous faire croire que tout ça, au fond, n’est que banal et nullement dramatique.
J’ai espéré que ça s’arrange, me disant que le reste des nouvelles viendraient contrebalancer mon ressenti, m’attendant à ce que les échos entre les différentes histoires du recueil parviennent à tisser un regard critique et multiple sur notre société. J’ai espéré en vain. Autre exemple : dans « Une dernière nuit au bord du précipice », un mari froid se prend la tête avec sa femme Hélène, dépeinte comme « émotionnelle ». Il veut aller boire un verre, elle est fâchée – on ne saura jamais pourquoi –, elle lance ses chaussures par la fenêtre pour l’en empêcher, il y va quand même ; quand il revient à l’hôtel, Hélène lui saute dans les bras pour lui faire l’amour, avant de partir pleurer dans la salle de bain. Soupir. Mes yeux roulent au ciel. J’aurais aimé accéder au personnage d’Hélène, mais tous les silences, les non-dits et le traitement qui lui est réservé par l’écriture de Patrick Delperdange la desservent, au profit d’un narrateur masculin insupportable.
Les femmes esquissées par l’auteur sont bien souvent mécontentes, criardes, pleureuses, et leur révolte n’est jamais vraiment mise en avant, la légitimité de leurs ressentis jamais prise au sérieux. Dans « Lorsque tout sera effacé », l’ado et narrateur ne comprend pas vraiment pourquoi sa copine est fâchée alors que bon… lui et son pote ont quand même trouvé ça drôle de photoshoper la tête de ladite copine sur des corps d’actrice porno et de partager les photos en ligne. Dans « Prise au piège », Ingrid se veut provocante, briseuse des codes, mais le récit, qui prétend peut-être dépeindre une femme libérée sexuellement, le fait en réalité d’un point de vue purement patriarcal en mettant en avant une femme-objet du désir masculin, qui s’accorde volontairement aux dictats de la beauté pour plaire1. Un être qui s'incarne dans ses attributs sexuels, aux gestes tout en pulsions. De façon libidinale, le texte la réduit à son corps et à ce qu’elle en fait. Ce qui était le cas aussi pour Hélène, dans « Une dernière nuit au bord du précipice » ; pareillement, les deux femmes jonglent entre désir sexuel et larmes.
Certes, les nouvelles sont courtes, on pourrait se dire qu’il est difficile d'y inscrire davantage de points de vue, de nuance, mais alors pourquoi écrire là-dessus et le faire de cette manière ? La quatrième de couverture promet d’évoquer de façon plurielle et sensible les corps. Pourtant, ce qui est proposé demeure réducteur. Une forme de sexisme ordinaire rend poisseuse la lecture, les descriptions des corps féminins empestent le male gaze, et le choix des points de vue ne fait que réduire et invisibiliser la parole des femmes. L’incarnation qu’on pourrait ressentir reste d’ailleurs superficielle du fait d'un style avant tout cinématographique et visuel, la sensorialité des corps est ainsi peu mise en avant, et la sensualité se confond vite avec la sexualité. En somme, la « sensibilité » considérée est mentale plus que corporelle, explorant maladroitement la tension entre actions rationnelles et émotionnelles.
Les autres nouvelles sont moins dérangeantes à ce niveau-là. Néanmoins, elles ne permettent pas d'équilibrer Les Corps sensibles et, au contraire, deux d’entre elles (« De l’autre côté du monde » et « Un sacré coup de vieux ») prolongent cette ambiance nostalgique pénible présente dans « Trouble-fête », comme si le fil rouge du recueil était ce manque du passé, cette insuffisance du présent.
Les Corps sensibles ne s’inscrit pas dans la littérature que j’espère être celle qui pourrait guider nos lendemains, casser les normes et réduire en poussière les mœurs délétères pour proposer du neuf. Le recueil me rappelle que la limite entre la critique et la reproduction voyeuriste est ténue, qu’un rien peut faire basculer tout texte. Et le livre, comme il ne se présente jamais explicitement comme une critique, est flou sur ses intentions réelles. Il aurait été judicieux pour un recueil titré Les Corps sensibles de faire appel à des lecteurices sensibles2 pour pouvoir représenter de la manière la plus juste ces fameux corps, au lieu de figurer à nouveau des représentations problématiques.