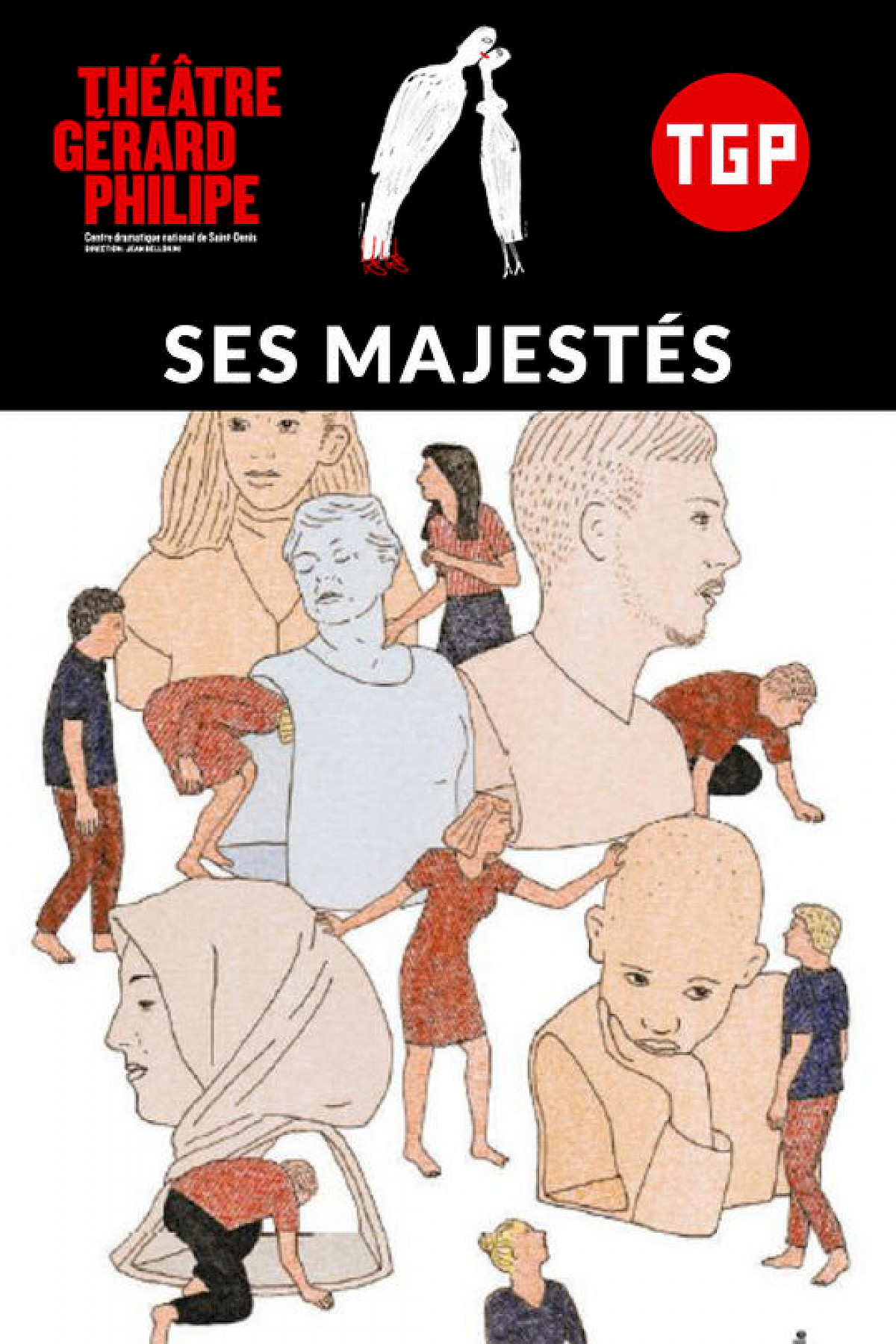
Karoo avait déjà rencontré le danseur et chorégraphe
Karoo avait déjà rencontré le danseur et chorégraphe
Thierry Thieû Niang en 2014à l’occasion d’un spectacle du festival KICKS. Retour aujourd’hui sur
Ses Majestés, découvert le 8 octobre au Théâtre Gérard-Philippe de Paris.
… des passages, des chemins, des cris de joie, des silences retenus qui vont de la salle au public et reverse et cela est si rare et si unique de partager ce mouvement.
Ce n’est pas du théâtre ni de la danse, ce n’est pas amateur ni virtuose, ce n’est pas moderne ni ancien.
C’est quelque chose du monde et qui est nous et qui est chacun, où l’une et l’un, habillé et nu, petit et grand, proche et lointain se donnent la main, s’endorment l’un contre l’autre et saluent en majestés le monde.
Thierry Thieû Niang
S’il est un drame, il est ailleurs. Peut-on dire qu’il y a drame ? Où est-il, alors ? Il n’est ni sur scène ni hors de la scène. Le plateau sert à manifester sa possibilité. Il plane. Le drame plane sur nos vies, autour d’elles, comme un rapace. Ou comme un œil… Comme un soleil, une pupille noir : comme la lune. Mais chaque chose en son temps.
D’abord des mots. Peut-être viennent-ils des Raisins de la Colère . Peut-être n’est-ce pas la question : ils viennent. Ils vont et ils viennent. Ils sont comme l’espèce humaine. Ils sont et ne sont pas comme elle. Ils parlent d’un mouvement d’hommes, de femmes, d’enfants, d’étrangers. Ils expriment un exil. Quelque chose qui a eu lieu, qui ne cesse d’avoir lieu : partir, s’arracher, se sauver, s’accrocher, fuir. Être à la frontière : êtres de la frontière…
Un drame a eu lieu ; un drame n’a de cesse d’avoir lieu. On ne le voit pas. Il faut l’entendre. (Il faut essayer d’y prêter l’oreille.) Des voix racontent une série d’événements qui ont un rapport avec cet épisode, cet exode incessamment recommencé, ça… Ça, qui a eu lieu quelque part, là-bas, ici. Oui, ici même, sur le plateau, ou juste à côté.

Voilà que des corps se lèvent, se couchent, bougent, marchent, s’arrêtent, repartent en grappes. On dirait qu’ils dansent, ils se passent un relais, un témoin, rien, un souffle.
Voilà que le lecteur se transforme en conteur, que le silence s’active, la lumière se fait peu à peu sur le plateau, un peuple occupe l’espace, une femme chante : on découvre des visages qui la regardent, avancent et reculent, attentifs. Puis, des gestes, des postures, des figures : tomber ; se lever ; se redresser, etc.
« Se », qui est-ce ? L’esprit, peut-être, ou le corps ? Se défendre. Se cacher. Ne pas être pris. Se ? Ses… il y a là une pluralité d’êtres, de corps, de mondes. Il y a du monde. Seul un aveugle ne s’en apercevrait pas. « Ses », qui c’est ?
Ses « majestés » ? C’est-à-dire, peut-être, que ça ne peut-être que ça : disons, la réponse d’un titre à la vie, le déploiement d’une série de corps dans l’espace pour dire un drame. Une parole ? Non, des chants, des oreilles qui écoutent, des mains qui tapent, une épaisseur de temps. Des livres ? Non, des textes, comme des portes qu’on ouvre sur le temps de l’exil, ou sur autre chose, mais quoi, mais comment ? L’absence de temps : une texture. La possibilité d’un événement. La marche opposée du drame. Une résistance…
Résistance à quoi, à qui ? Peut-être à la danse elle-même ? À la danse de cours, aux rumeurs de palais. Comme si une autre chorégraphie, de l’âme, était envisageable, souhaitable, nécessaire. Différente de celle en place. D’autres pas que ceux qui mènent au pouvoir. Une puissance de contestation, de composition, de création, en acte : autre chose que les formes qui se conservent à l’abri du vent, de la poussière, du bruit, du drame, des coups, des cris, des séparations, etc.
Une beauté qu’on ne reconnaît pas de nous, car la beauté se reconnaît à ce qu’on ne reconnaît pas de nous, grande étrangère qui emporte tout, à laquelle on accorde pour nul besoin, sans réticence, tout notre soin à s’abandonner. Il n’y a pas de beauté sans entendre l’appel : abandonne-toi. Oui c’est folie, c’est aussi l’autre nom de l’amour. Abandonner les causalités, l’ordre du temps chronologique, assurer le désordre, cela s’appelle hospitalité : faire de la place à ce qui n’en a pas, à ce qu’on ne reconnaît pas. Faire de la place même quand on n’en a pas soi-même ; apprendre à se déplacer à l’intérieur de sa maison, de sa solitude aussi, car la solitude n’est pas une, elle est une puissance du multiple.
( Corinne Rondeau, Akerman Passer la nuit , éditions de l’éclat, Pg 97-98)
Ce que racontent Ses Majestés ? Peut-être une histoire faite de riens… errances, hésitations, tâtonnements. La quête d’un chemin entre les ruines, cadavres du passé, mémoire qui s’esquinte, ligne ténue entre les gouttes de pluie conjuguée à l’éternel présent d’un jour de soleil, route qui vise un temps à venir, horizons inentravés, lueurs, sueurs :
Comme le chemin de ronde/
Que font sans cesse les heures/
Le voyage autour du monde/
d’un tournesol dans sa fleur/
tu fais tourner de ton nom/
le moulin de mon cœur.
*
C’est quand l’écriture devient récit que la pensée se meut,
hors d’elle-même, vers ;
c’est quand la voix rythme poème,
que la nature retourne à la nature,
alors les doigts sont des pieds qui chuchotent,
chevilles délivrées, tapis volant,
les mots, des ciels, des pirogues,
les formulations imprécises comme des chats,
des sauts, de libres contorsions, dans la nuit,
dons, offrandes, prières, trouvailles,
des voyages dans l’espace ;
c’est alors, seulement alors, que vies et drames
se confondent, vont de pair,
avancent dans la même direction,
se prennent par la main, sortent de l’île,
regardent dans le fond des yeux,
prennent la mer, l’eau, vagues éclats,
jusque dans le ventre de la baleine,
matrice d’ombres, le vent souffle,
et passent, ensemble, au-delà des murs,
rouge, noir, brun, vert, jaune, bleu, sombre,
au-delà de l’écran, naissances,
lumières enfin, à travers la grisaille,
par-delà frontières… là-bas, déjà ici,
emportés par les embruns, les tempêtes,
des feuilles mortes ouvrant grands les yeux,
Respire, ma sœur, respire, mon frère,
t’inquiète, ça ira,
ça va passer, ça va aller tu verras !
*
Reposons la question, au calme : le plateau, qu’est-ce que c’est ? Qu’est-ce que c’était ? Peut-être un espace littéraire ? Peut-être un espace politique ?

C’est, en tout cas, le lieu où le temps devient le centre de l’action, un récit prend forme grâce aux corps qui s’y engagent… c’est alors qu’une rencontre entre des êtres humains produit un événement dont le sens ouvre, délivre, sauve.
Hors toute conciliation, toute réconciliation, le plateau, cette condition pour qu’une parole émerge du chaos, assume des mouvements, et donne aux histoires différentes un plan où s’inscrire, aux tourbillons de mémoires clandestines une terre d’ancrage, une échappée. Une manière d’espérance sur lequel puisse se lever une vérité comme un soleil ; l’œil de la lune trouver repos au-dessus des flots.
Allez, murmura-t-il en s’adressant aux éléments,
rends-les nous, soit bonne,
rends-les nous tous…
*
Saint-Denis, onze heures du matin, c’est jour de marché à l’arrêt de métro Basilique… des gens, et des gens, avec des cabas. Je marche vers le TGP, pour participer à Ses Majestés . Ni danseur, ni comédien, ni traducteur, ni voisin… qu’est-ce que je fous là ? Rien : je cherche mon chemin. Thierry Thieû Niang m’a proposé de venir, suite à notre rencontre de cet été, autour de son film Une jeune femme de 90 ans, qu’il était venu présenter au Faito Doc Festival.
Je suis donc là. Parmi d’autres. Des amateurs, des professionnels, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, des rouges, des noirs, des jaunes, des blancs : des comme ci, des comme ça… juste des hommes. Une remise en tête après l’échauffement, et on est parti… Suit un filage, après la pause du midi ; quelques notes. Voilà. À 18 h 30 pile, la machine, une fois huilée, était lancée. C’était gai, émouvant. Qu’est-ce que c’était ? Danser, peut-être, se laisser danser sûrement.
Marcher, s’arrêter, courir, se couvrir, tomber, se coucher, chuter encore, construire une cabane, rayonner, se défaire. Faire se défaire, sur le plateau du TGP, un dimanche soir à Saint-Denis. Et puis se séparer. Retrouver la vie, une chambre dans une ville, à Paris, quelque part rue Victor Hugo. Voilà. Retrouver une solitude passagère avant d’autres visages, d’autres amours, d’autres épisodes curieux où les mots font corps, doublement, avant de perdre toute espèce de forme, de contours précis ; avant de rejoindre l’obscurité, la nuit, l’humidité qui goutte de l’autre côté de la fenêtre, les voitures qui klaxonnent dans le froid pour se réchauffer.
Une douche. Se dévêtir, se changer. Changer, se changer… changer, perdre, reprendre.
Perdre les noms, se remémorer une présence de vie. Un mouvement, une attente, des voix, des pas… des yeux, se souvenir, reprendre son temps. Et sortir à nouveau. Vogue la terre.