Moi, Antoine et les autres

Après notre interview irrévérencieuse en dix questions , voici la suite de notre rendez-vous avec Antoine Wauters. L’auteur liégeois, lauréat du prix Première de la RTBF pour son roman Nos mères , signe une double publication avec Pense aux pierres sous tes pas et Moi, Marthe et les autres aux éditions Verdier. L’occasion pour nous de revenir sur ses œuvres, mais aussi de parler de politique, de critique littéraire et de philosophie.
Je voudrais commencer cette seconde interview en nous intéressant aux mondes que tu mets en place dans tes romans. Le premier, dans Pense aux pierres , est un monde purement fictionnel, mais qui semble être la synthèse des dictatures que le monde a connues entre, disons, 1970 et aujourd’hui. Le second, dans Marthe , se base sur la ville de Paris, mais dans un futur hors du temps. La fiction d’une part, et la transposition d’autre part, sont-elles pour toi les meilleures façon d’appréhender le réel ? Comme en creux ?
Je ne suis pas certain que je cherche à parler du réel contemporain… En même temps, j’ai l’impression que j’aimerais que le bouquin s’adresse à une part primitive de nous-mêmes qui n’est pas historiquement située. Je réalise que c’est peut-être naïf, mais je pense qu’il y a un fond commun d’appréhension des choses entre quelqu’un vivant dans les années 1950 et quelqu’un vivant aujourd’hui. Cependant, je pense que c’est plutôt une infirmité qui me pousse à inventer des mondes. Je n’ai pas du tout envie d’aborder les thèmes de l’inceste ou de la politique en étant dans un pays existant. Je pense que je pouvais dire plus de choses grâce à ce cadre très ouvert. Pour Marthe , c’est vrai qu’il y a ce mouvement de translation dans le futur, mais pour le coup, c’est ce qui se passe déjà aujourd’hui. J’ai simplement grossi et extrapolé certains traits.
On en revient à ce que tu disais dans notre première interview : on peut traiter les mêmes thèmes que d’autres artistes, on sera toujours différent. Parce que l’explication que tu me donnes là est celle que Michel Houellebecq, par exemple, a pu donner pour Soumission .
Ah oui ! C’est très juste.
La réalité semble rattraper tes romans, surtout lors des derniers jours. Les lingots d’or offerts aux fermiers dans Pense aux pierres , ce sont les cent euros de SMIC offerts par Macron pour calmer les tensions.
Le populisme, c’est ça. La dictature dans le roman reste un régime totalitaire, mais elle se base sur ce qu’on peut observer ces dernières années. Le geste de Macron touche à cela. Je pense aussi à Salvini qui, en Italie, paradoxalement, est totalement opposé à l’installation de migrants, mais lutte contre la baisse des naissances en offrant des terres aux Italiens de souche.
Une prime à la natalité ?
Voilà. Pour le troisième enfant, tu reçois un terrain pendant une cinquantaine d’années. Ces mesures-là étaient déjà en œuvre durant le fascisme. J’ai tendance à penser que mes romans parlent du temps présent, mais Nietzsche parle de l’éternel retour du même , et force est de constater que quand on regarde l’Histoire, elle tourne. Certaines horreurs reviennent, certaines beautés aussi.
On n’en est pas encore à l’Histoire repasse les plats , mais les plats ont peut-être simplement une couleur différente.
Oui, et on les épice différemment.
De même, dans Pense aux pierres , Paps va se faire hospitaliser et dit dans une lettre à son frère que le personnel soignant a été remplacé en même temps que le régime politique. Cela me fait penser à Bolsonaro, le nouveau président brésilien, qui veut rompre un traité avec Cuba et expulser tous les médecins cubains, quitte à laisser des zones, notamment rurales, sans soins de santé.
C’est marrant que tu pointes ces actualités qui se retrouvent dans le bouquin. Nos mères avait une atmosphère fermée. Césarine de nuit a été écrit au moment où Nicolas Sarkozy et Brice Hortefeux lançaient leur politique autoritaire et donc en parlaient un peu. Pense aux pierres semble encore plus politique. Je pense qu’en vieillissant, ma perméabilité grandit. Je me sens plus contemporain qu’avant, c’est-à-dire que ce qui se passe aujourd’hui m’occupe beaucoup. Jusqu’il y a peu, l’écriture était pour moi une poche inviolée où tourner le dos au monde. Maintenant, elle reste une zone de repli, mais le monde me suit dans l’abri.
En plus d’interroger le réel, la fiction me semble aussi le lieu pour toi où explorer les tabous. Beaucoup y passent : le transformisme, la misogynie avec les mains baladeuses de Paps, l’inceste évidemment, la bisexualité qui se retrouve également dans Moi, Marthe et les autres… J’arrête ici la liste, même si elle pourrait s’allonger encore un moment. J’aimerais revenir sur cette grande phrase : « La voix d’un petit garçon qui rêve d’être une petite fille…
…et celle d’une petite fille qui rêve d’être un garçon. »
Pourquoi cette volonté de t’attaquer à tous les tabous ? Pour éloigner les ténèbres ?
Je pense qu’écrire un roman c’est prendre des êtres humains, les dévêtir, les mettre dans une maison et faire tomber les murs.
Évidemment, tu te retrouveras confronté à tous ces grands interdits qui existent depuis que l’humanité fonctionne en société. On n’a accès qu’à une moitié des gens lors de nos relations avec eux. Si on pouvait observer un homme seul chez lui, quand il rentre du boulot, en termes de perversion, d’envies sexuelles… Est-ce que c’est déviant ou pas ? Je m’en fous ! Écrire, c’est travailler sur les monstres qu’on porte tous en nous.
Le mot monstre est d’ailleurs régulièrement présent dans la bouche de la mère.
Mais oui ! Moi, je m’endors tous les soirs avec des monstres que je sais enfermer dans des placards. Par exemple, j’ai une obsession dont je parle très peu, c’est même une maladie : je suis malade du jeu. Je suis interdit de casino, interdit de poker en ligne. On retrouve ce jeu dans l’écriture : écrire c’est pouvoir se travestir. Je suis atteint par le jeu. Mais on l’est tous à des niveaux divers, avec une conscience différente de l’effet que cela a sur nous. Écrire, c’est jongler. Jamais dans la volonté de provoquer. Si je voulais écrire un texte perturbant sur l’inceste, je n’aurais pas écrit ce roman.
Tu te serais peut-être justement dirigé vers un huis clos dans lequel les personnages ne peuvent pas se confier ?
Exactement, l’optique utilisée n’aurait pas été la même.
Je t’avoue que lorsque j’ai lu la scène dans laquelle la petite se rend chez son oncle, je me suis dit : elle va se faire violer.
En fait, c’est drôle, j’ai vraiment senti un point de bascule dans le livre qui correspond au point de bascule que j’ai vécu en l’écrivant. Je suis passé d’une envie de destruction immense me concernant à une forme d’apaisement. Je crois que ça a rejailli dans le livre. Je ne voulais pas que ce soit sinistre… En tout cas, tu as lu le livre de près !
J’ai la chance de pouvoir choisir mes lectures et leur nombre, ça aide à s’immerger.
Même en dehors de ça, généralement, Marthe passait à la trappe et Pense aux pierres se résumait à inceste et violence. L’analyse se devait de suivre une ligne éditoriale.
Je prends le compliment (rires) .
J’aimerais revenir sur un tabou en particulier, que j’avais évité à dessein : le masochisme, ou plutôt l’automutilation. Paps la pratique, Marcio également à sa suite. Il y a aussi cette phrase dans Marthe : « Je m’endors en pensant à la meilleure façon de me tuer. » Ou encore dans Pense aux pierres : « Les bêtes enfermées se mutilent, qu’il disait. Mais moi, hein, qu’est-ce que je peux faire ? » L’automutilation, c’est le dernier recours face à l’incompréhension ?
Pour moi, l’automutilation, c’est Marcio qui dit, dans le chapitre cinq, qu’il fait la même chose que son père, que c’est un cadre physique autour d’une douleur qui sans cela serait infinie et insupportable. En arriver à se faire du tort physiquement, c’est circonscrire la douleur dans un champ qui n’est que physique et qui est largement plus supportable qu’une douleur abstraite, mentale, infinie.
Pour te paraphraser, lorsque quelqu’un vous manque, ce n’est pas une fois, mais le lendemain, la semaine suivante… C’est un processus sans fin, contrairement aux ecchymoses.
C’est ça. Ce sont des vases communicants. Plus les coups passent dans le physique, plus la douleur psychologique s’atténue. La plupart des gens en état de santé mentale diraient préférer une souffrance psychologique à une souffrance physique. À l’inverse, dans des situations de grande violence intérieure, comme dans Marthe , on veut le plus de douleur physique possible pour oublier que l’on voudrait mourir.
Je sors de l’automutilation : cela me fait penser à tous ces gens qui vivent dans une grande détresse psychologique, mais qui sont tellement harassés par leur travail qu’ils ne peuvent imaginer aucune solution.
C’est vrai. C’est le mécanisme : cela s’installe puis c’est excessivement difficile à déloger.
Cette violence physique, c’est aussi le moment où l’on perd ses mots ? Je pense à la lettre que Paps envoie à son frère. Il lui demande alors d’expliquer à ses enfants que ses coups de bâton étaient de l’amour.
Là, tu parviens à toucher le cœur brûlant de toute l’histoire. C’est beau que tu le voies. Bien sûr que c’est cela. Le père ne possède pas les mots et répond par la violence. Mais quelqu’un qui possède les mots peut aussi tomber dans une situation où la seule réaction possible dans l’immédiat, c’est la violence.
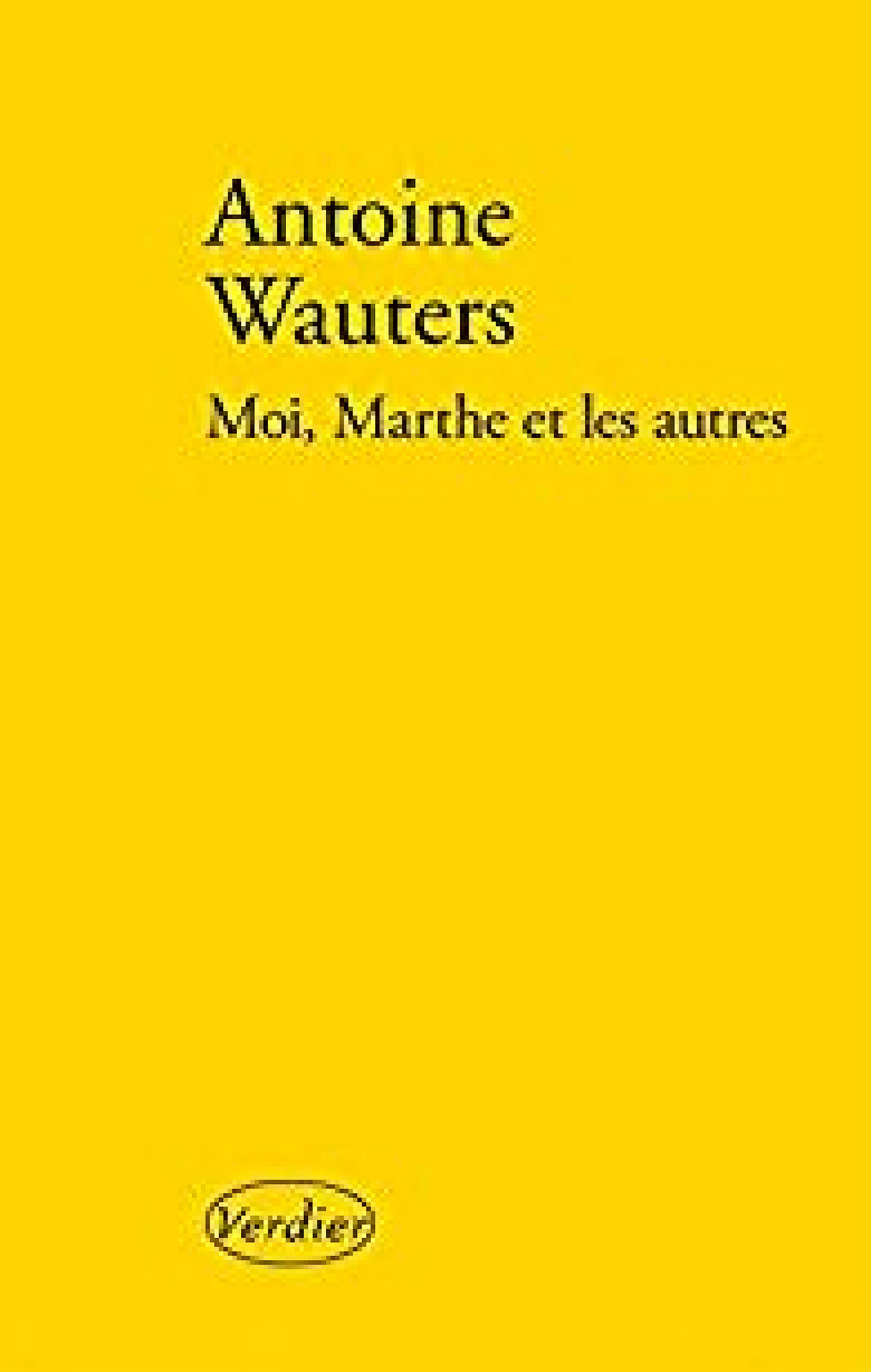
Maintenant que nous avons parlé de la perte des mots, j’ai l’impression que tes deux œuvres ont en commun de mettre le langage au centre des préoccupations. Cependant, le rapport aux mots est ambigu : il est d’abord mélioratif. Toutes les figures de référence possèdent les mots et par ce biais possèdent la connaissance. Mama Luna dans Pense aux pierres donne des cours. Le Vioque est la mémoire du groupe dans Moi, Marthe et les autres , car il se souvient des noms des objets disparus. Marthe apparaît également comme une figure de mère : elle raconte des histoires au sujet de grands hommes oubliés Francesco Dali , Napoléone , Le général de Gauche . Finalement, le plus grand pouvoir, c’est d’être capable de nommer.
Je pense ! Hardy, le personnage principal de Marthe, est le scribe du groupe. Il note ce qui leur arrive, il consigne l’expérience commune. Mais la parole est aussi un moyen d’action : le personnage de Jurgen punit ceux qui se trompent dans les mots. Quand on discute avec des gens qui sont peu allés à l’école, ils se rendent compte de la puissance des mots. Ils se sentent même inférieurs. Aujourd’hui, que Macron, qui possède les mots, soit détesté par le peuple ne m’étonne pas. Ils sentent son pouvoir, mais aussi sa manipulation.
Macron, c’est celui qui n’est « ni de gauche ni de droite ». De l’autre côté, on trouvait Mélenchon qui usait d’un vocabulaire très élevé pendant la présidentielle pour prendre un rôle de professeur.
Tout à fait. Dans Pense aux pierres , Mama Luna demande au groupe de répéter des listes de mots. Je pense que c’est l’illustration du pouvoir performatif de la parole : dire, c’est déjà agir d’une certaine façon. Je ne sais pas si c’est mon créneau de poète, mais dire c’est agir, c’est aussi mentir ou trahir. Entre Macron qui trahit et quelqu’un qui porte une parole sincère qui contient en elle une réalisation possible, il y a un monde. Mais c’est le même pouvoir.
La parole est aussi un danger ; on vient de frôler la question. Par exemple, le premier réflexe du groupe dans Marthe est de faire disparaître la plaque nominale de leur rue.
Je me suis demandé récemment pourquoi ils avaient caché la plaque… Un vieux réflexe atavique du type : c’est notre adresse ? C’est étonnant, sachant que personne ne sera à même de la lire. Je ne peux pas expliquer tout ce qu’ils font.
Comme Zola ? Tu déposes tes personnages dans un milieu et tu vois comment ils agissent ?
Des choses s’imbriquent, toujours.
Détail signifiant : dans Marthe , la mort d’un personnage correspond au moment où on lui scelle les lèvres. C’est d’une grande symbolique : la mort, c’est la perte de parole.
C’est vrai ! Le personnage meurt, le récit se termine parce que les mots disparaissent.
On ne peut pas appeler tes romans des poèmes en prose, ni même des romans poétiques. Par contre, j’ai remarqué qu’il y a pas mal de répétitions de phrases et d’autres jeux dont on a déjà un peu discuté lors la première interview. J’aimerais qu’on revienne sur les interludes, les notes de bas de page ou, plus spécifiquement dans Marthe , cette notation chiffrée qui peut ressembler à des aphorismes, voire aux versets de la Bible que les personnages trouvent dans les ruines.
Oui, c’est bien vu. C’est différent dans les deux bouquins. Dans Marthe , le but était clairement d’ordonner le chaos. Se dire que tout se délite et que nommer les choses, les numéroter est une façon de créer de l’ordre. Avec peut-être l’idée de reformer un grand livre. Le livre d’un après ou d’un recommencement. Dans Pense aux pierres , c’est presque technique. Ce qui est développé dans les interludes ne pouvait pas être greffé dans le cœur de l’histoire sans la lester d’un poids trop explicatif. J’ai essayé de garder les chapitres classiques assez purs et fluides et de jouer sur un système d’à-côtés qui permettait de pouvoir poser un regard sur l’histoire depuis un autre point de vue. Léonora les dit, ou les écrit, quand elle a vieilli, du haut d’une nouvelle expérience de la vie. Les notes de bas de page sont encore différentes : elles créent de la vraisemblance dans quelque chose qui n’est pas réel.
Les cartes ont le même objectif ?
Les cartes étaient présentes pour ne pas perdre le lecteur. Quand j’ai relu le roman après l’avoir retravaillé, ma seule inquiétude était que le lecteur cherche pendant cinquante pages dans quel pays l’histoire se déroulait. La meilleure manière de couper court à cela était de poser une carte au départ du bouquin. C’est un pacte narratif qui règle la question. Toutes ces techniques me permettent aussi de varier les registres. Il y a une note dans Pense aux pierres qui me donne l’occasion d’aborder quelque chose qui m’obsède : la mémoire et donc aussi l’oubli. Marcio dit qu’il ne se souvient plus des traits de son père. Justement, le père revient à la fin, mais très vieilli, les traits changés. La note pose cette question : quel est le dernier point de contact entre une personne que l’on a connue et l’oubli ? De nouveau, l’enchâsser dans le texte lui-même aurait alourdi. Le bouquin aurait pu être beaucoup plus gros, mais j’aime couper.
Cela m’a fait rire lorsque j’ai lu la première lettre du père, je me suis dit qu’il était étonnant qu’il écrive si bien. Justement, il est précisé qu’on a relu sa lettre. Pour mon plaisir, il ne manquait qu’une seconde lettre non relue, et tu l’as écrite.
Je trouve ça marrant de pouvoir faire un livre où d’une part tout n’est pas bien écrit et où on peut laisser des fautes d’orthographe. Le père n’a pas appris à écrire. Sa lettre est touchante, mais a peu de valeur littéraire.
D’ailleurs, tu as réutilisé le procédé dans Moi, Marthe et les autres puisque beaucoup de noms sont tronqués, syncopés.
Oui, ils sont estropiés.
Pour en terminer avec les mots. Frog dit dans Pense aux pierres : « Vous parlez parce que vous êtes morts. » Il reproche aux autres de ne pas danser. Mama Luna tient le même discours : « Vous êtes vivants bande de ploucs. Encore faudrait-il que vous vous en souveniez. » Tes textes sont-ils des hymnes à la révolte, à l’action ?
Je suis certain que ces livres ne changeront rien. Il ne va pas y avoir tout d’un coup une insurrection. Mais dans le même temps, je suis étonné des retours des lecteurs. Notamment le jour où le président Bolsonaro a été élu au Brésil. Des gens m’ont envoyé des photos de Pense aux pierres en soulignant des extraits et en me disant que mes textes leur faisaient du bien et les poussait à s’unir.
Des Brésiliens ?
Pas forcément. Mais des Européens qui avaient vécu au Brésil. Quelques Brésiliens qui n’y vivent plus également. C’est vrai que j’ai écrit ces livres avec une part de colère. Mon insatisfaction se ressent lors de la lecture et c’est très bien si cela fait écho. Pour autant, ce n’est pas parce que tu as vu un concert ou un film qui te touche que tu vas descendre dans la rue…
Peut-être au troisième, au quatrième, au cinquième…
C’est vrai qu’une accumulation peut se produire.
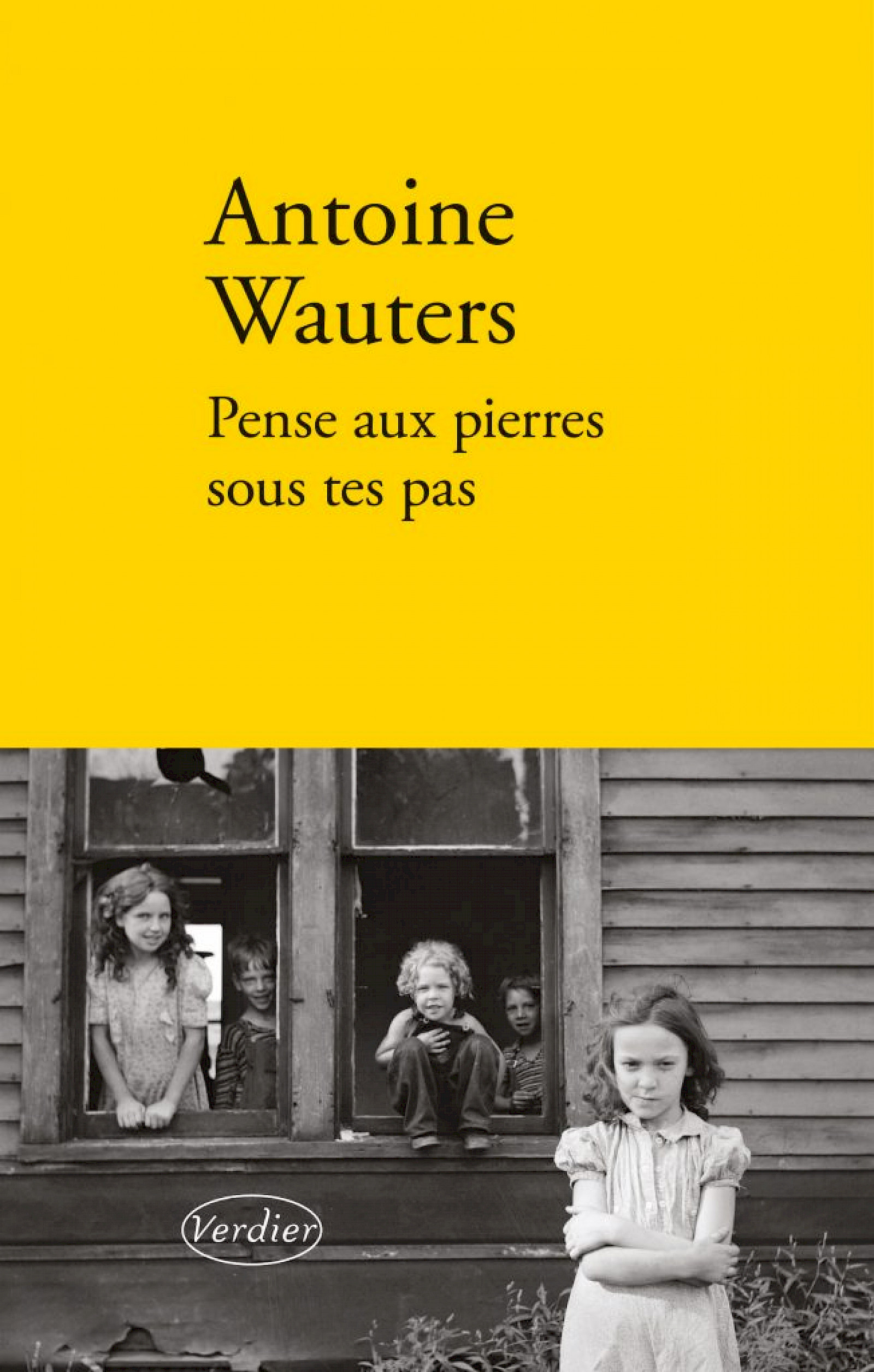
On vient de parler de révolte. Je n’ai pas l’impression que la guerre soit valorisée dans tes romans. Dans Pense aux pierres , malgré un entraînement presque militaire, le groupe s’isole sans combattre. Dans Marthe , il y a cette phrase : « Je crois que la sagesse, parfois, est de se dire vaincu et de rendre les armes. » Il n’y a pas de solution armée.
Non. C’est plutôt de la désobéissance civique, ou civile. J’ai écrit une carte blanche qui n’en était pas une pour les élections communales où j’affirmais que je ne voterais pas cette fois-ci, contrairement à une envie et une obligation. Depuis l’enfance on nous dit : « Vous avez une chance de donner votre avis, faites-le. » Pourtant, j’ai l’impression qu’aujourd’hui, si des fragments de révolte doivent exister, c’est peut-être à travers cette démarche : en s’agrégeant et en affirmant que l’on ne veut plus jouer à ce jeu. Vous voulez nous vendre un ballon de foot, mais on ne veut plus jouer. On ira acheter des balles de tennis, et on jouera avec les pieds s’il le faut. Encore que parfois, j’ai des élans beaucoup plus violents, plus personnels, mais qui ne sont pas forcément transcrits dans les livres.
Dans Pense aux pierres , Zio est très violent, mais en toute décontraction.
Oui. Cela dit, s’il ne l’avait pas fait, il serait certainement resté dans sa léthargie. Il faut que quelqu’un le fasse pour ouvrir une brèche.
Il s’agit plus d’anarchisme que de révolte armée.
Voilà. Ce qui est drôle dans l’actualité qui rattrape le bouquin, ce sont les gilets jaunes. J’étais sur France Info il y a quelques semaines et le journaliste me demandait si je voyais des liens entre l’insurrection du roman et leur mouvement. À la fois, je me sens très éloigné des gilets jaunes, et pourtant je comprends profondément comment des gens peuvent faire bloc. Leur manière de le signifier ne sont pas des mots qui font échos aux discours mensongers, mais le physique, le factuel. Quelque chose de gênant pour le pouvoir et pour les autres personnes. Je trouve ça très beau, mais cela démontre en même temps une impuissance, comme toutes les révoltes. Cela touche à l’automutilation. Je ne suis pas allé dans cette violence dans les romans. Parler d’inceste, de cannibalisme, pour moi, cela reste soft et chacun le lit avec son ressenti personnel. Cela n’est pas le centre de l’intrigue. Mais passer à l’appel à la violence n’est pas ce que je veux faire. Il n’y a pas de thèse. Pas de demande de passage à l’acte. Tout au plus l’intuition de ce qui pourrait être, en restant dans la fiction.
Un nœud commun aux deux romans est la création d’une communauté. Une communauté, surtout dans Marthe , c’est un groupe inclusif, mais qui rejette aussi toute personne extérieure. Se réunir, c’est forcément exclure ?
Grande question. Dans Marthe , ils sont dans une situation de survie qui réserve le meilleur et le pire. Leur seuil d’acception d’autrui, dans cette configuration, est très limitée. Les personnages sont extrêmement grégaires. Mais c’est symétrique : le côté hermétique de leur groupe n’est que le reflet de l’hermétique des autres groupes. Il y a très peu de transferts… à part des transferts violents qui signifient la mort. Dans Pense aux pierres , c’est une communauté autarcique. Elle crée des ponts, mais très peu. Si j’essaie de le comprendre, je dirais que même si je suis quelqu’un qui a le besoin de sentir que des projets collectifs se créent… J’ai d’ailleurs pas mal d’idées autour de l’écriture et de la mise en commun de certaines pratiques : une sorte de village dévolu aux arts comme l’écriture, mais aussi le cinéma. Pas un lieu de profits, capitaliste, mais un lieu où les gens pourraient venir bosser et avoir des interlocuteurs. Cela m’importe énormément. Mais d’un autre côté, si je passe ma vie à écrire, c’est que je suis quelqu’un de solitaire. Ce petit groupe qui accepte quelques personnes, mais pas beaucoup plus, c’est peut-être ma propre limite. J’admire ces gens qui sont capables d’être totalement ouverts, de discuter, de prendre des décisions collégialement. Je ne m’en sens pas encore la grandeur d’âme, la patience. Dans Marthe , cela balance régulièrement entre l’envie du groupe et le besoin de la solitude. Ce n’est pas un texte hippie dans lequel tout le monde s’aime. C’est une utopie, mais pas naïve.
Dans Marthe , une chose qui m’a marqué est que chaque interaction avec Frog, qui fait pourtant partie du groupe, commence par une flèche dans le corps. Même les amis blessent avant de s’approcher.
Oui, c’est vrai. C’est très nietzschéen : il disait que nos meilleurs amis étaient avant tout des ennemis. La relation de Frog et Hardy est violente. Pour moi, une relation avec quelqu’un ne dispense pas, non pas d’être un ennemi, mais d’être sincère. Tu peux dire à un ami des choses qui vont lui déplaire sur le moment. Peut-être que quelques mois plus tard, il y réfléchira. Sinon, ce n’est que du tautologique, de la parole blanche. Dans Marthe , cela se manifeste avec plus d’éclat à travers ces flèches. Même Frog qui est un gosse en rit : il tire une flèche sur Hardy, le ligote, le menace puis lui dit de revenir sinon il lui arrachera le foie. Il en rit lui-même. Peut-être qu’il le fera pourtant.
Toujours dans cette vie en communauté, il y a des tensions entre le sexuel et l’affectif. Entre les jumeaux, évidemment, avec l’envie toujours repoussée. Entre Hardy et Marthe, également. Mais plus largement dans les deux groupes, le sexe est libéré, sans pour autant sembler suffisant pour combler la misère affective des personnages.
Ce sont des gens désespérés et étant désespérés, ils cherchent à combler un manque, un manque de tendresse.
Au figuré, comme au propre.
(rire) Non, mais c’est ça ! Les jumeaux sont très obsédés par tout cela, surtout quand ils quittent le foyer. Léonora se prostitue, Marcio aussi fait ses expériences. Ayant grandi dans une famille sans amour, ils cherchent à obtenir ce qu’ils n’auront sans doute jamais.
Le sexe est un ersatz de l’affection.
Oui, je pense. En tout cas dans leur situation de manque. C’est un jeu d’enfant qui procure un plaisir immédiat. Par contre, si le sexe est tellement présent, c’est parce qu’ils savent que l’acte consumé, le manque reviendra. D’où une envie boulimique, car rien ne peut les combler à part une vraie tendresse qui n’existe pas dans le roman.
Ton expression, la boulimie, me rappelle la scène dans Marthe où les protagonistes tombent sur un hôpital et consomme le maximum de drogue possible avant de repartir.
Exactement. On peut faire le lien avec ce qu’on appelle les no-life . Ces gens qui restent enfermés chez eux, branchés à leur ordinateur. Tu as deux possibilités dans Marthe : arracher des fétus de joie dans ce monde désolé et désolant, ou rentrer dans le nihilisme et alors on se shoote à la morphine, au sexe… On flotte et on ne ressent plus rien du tout. C’est une ambiguïté proche de celle que tu soulignais entre communauté et solitude. Une ambiguïté que l’on ressent tous.
La consommation aisée de drogue, le sexe supermarché de Tinder , les difficultés alimentaires. Un problème général qui s’exprime selon différentes facettes.
Exactement. J’ai tiré sur ces quelques fils pour les livres, mais c’est vrai qu’aujourd’hui c’est excessivement présent ! Ces différentes choses sont à prendre comme des symptômes. Des symptômes de quoi ? Dans les bouquins, je ne veux pas répondre. Quand je dis que leur sexualité est là pour combler un manque, c’est moi qui y réfléchis avec distance. Généralement, on agit sans connaître ses propres motivations. C’est étrange. Cela rejoint ce que je te disais tout à l’heure à propos des monstres qui nous habitent et avec lesquels nous devons toujours composer.
C’est le cas de le dire (rires).
(rires) Clairement !
Enfin, on ne peut pas passer à côté de la figuration des liens parentaux dans les romans. Dans Pense aux pierres , les parents sont « des êtres lourds, toujours préoccupés par le bien-être de leurs enfants, et en même temps toujours en train de chercher à s’en débarrasser » . Dans Marthe , les personnages sont tous dans l’amour de leurs parents, sans même les connaître. Par exemple, Rutten projette une image fantasmée de sa mère sur des mannequins
C’est le même phénomène vécu différemment. Dans Pense aux pierres , ils ont connu leurs parents, mais ont manqué d’amour. Les jumeaux les détestent, notamment de les avoir enfermés dans des rôles suffocants. Mais en même temps, ils les aiment. Tu as beau avoir été détruit par tes parents, une part de toi continue à les aimer. Non pas parce qu’il y a un lien de sang, ça pourrait tout à fait arriver avec des parents adoptifs, mais parce que tu espères. À moins d’être allé très loin dans les mesures contre la peine (voir la première interview , N.D.L.R. ) et d’avoir tiré un trait pour éviter de trop souffrir, Léo met en place une stratégie d’évitement. C’est quelque chose que je fais moi-même : mettre les êtres qui me manquent entre parenthèses pour éviter de souffrir. Dans Marthe , c’est le même chose, mais presque le modèle inversé : ils n’ont pas connu leurs parents et les idéalisent. Mais il y a toujours un manque, de la nostalgie. Dans Nos mères , j’avais déjà le même regard. Un rapport d’amour-haine entre une mère et son fils. Cette phrase que tu cites, à propos des parents qui sont des êtres lourds, est très dure, mais elle est très vraie. Les parents oscillent en permanence entre l’envie de tout donner à leurs gosses et l’envie de les faire disparaître de leur vie, de leurs pensées.
On doit également parler du rapport à la nature de tes personnages qui me semble liée à l’invitation au voyage comme disait Baudelaire. Prendre le bateau et partir au loin dans Moi et Marthe . La traversée du désert dans Pense aux pierres …
Ce n’est pas une nature entièrement bienveillante. Dans Pense aux pierres , c’est une nature magnifique et réconfortante, mais qui n’épargne pas : le volcan, la sécheresse, leur malheur même vient de la difficulté à travailler la terre.
Un éclair suffit à mettre le feu à la ferme.
(rires) Oui. Mais dans le même temps la nature est un lieu refuge. C’est pour cela que lorsque Léonora se rend chez son oncle, je décris ces petits chemins qu’elle emprunte. C’est drôle, cette scène est basée sur des notes que j’avais prises au Danemark : cette petite ferme, ces paysans aux yeux clairs. J’ai souvent ce sentiment lorsque je vais marcher dans les Fagnes : de prime abord je trouve cela magnifique. Mais si tu y restes une journée, seul dans les bois, tu meurs.
Comme dans Marthe : les pièges à lapins sont parfaits… il n’y a juste pas de lapins (rires)
(rires) Tu vois ! J’aime les états d’échos entre des états intérieurs et la nature extérieure.
C’est très romantique comme conception.
À fond ! C’est très cliché, aussi. Mais tu peux jouer en retournant le procédé. C’est-à-dire que la nature est vaste comme un horizon de vie, mais dans le même temps une compagne accablante. Cette ambiguïté existe depuis toujours. Elle est identique à celle qui existe entre les gosses et leurs parents. Cela dit, j’ai beaucoup écrit sur les enfermements : dans Césarine de nuit , il était question de jumeaux enfermés dans un centre ; dans Nos mères , d’un garçon enfermé dans un grenier ; dans Sylvia , je parlais de la maladie de mes grands-pères qui étaient dans des homes… Je sais précisément d’où cette thématique est tirée dans ma vie personnelle. Mais pour ces livres, je voulais garder ma liberté d’écrivain et écrire enfin un texte dans lequel je pouvais respirer.
Il y a cette nature, mais dans Marthe , il est également question d’un voyage fabulé.
C’est un truc qu’on a tous : quand tu vas mal, tu veux partir quelque part.
Psychologiquement, ce serait l’occasion de casser les routines.
J’en suis sûr. Tu pars une journée en forêt : tu n’as plus de mails, plus de messages. Tu as l’impression d’avoir été déconnecté très longtemps. Dans Marthe , le voyage rêvé participe aussi à la résilience. Les personnages réalisent qu’ils ne peuvent pas avoir accès au bonheur là où ils sont. Naïvement, comme dans enfants, quoique les enfants soient plus résistants que nous, on se dit que notre salut se trouve ailleurs. C’est une réponse élémentaire qui renoue presque au nomadisme premier. Dans Marthe , les personnages changent de lieu très régulièrement. C’est un changement de paradigme qui rejoint ce que nous disions dans la première interview avec la collapsologie. J’ai l’impression que, pour la première fois en littérature, les créations se font sur des seuils menacés de grande instabilité. Avant, les écrivains proposaient des romans ancrés sur Terre, avec des lecteurs ancrés, et on pensait que tout allait rester identique pour très longtemps. Aujourd’hui, on sait qu’on doit composer avec l’instabilité. Elle est économique, environnementale, et même systémique. Alors se pose cette question : « Cela vaut-il encore la peine d’écrire ? » Et si on le fait, peut-on continuer à le faire comme avant ?
Cela touche à la fois au fond et à la forme des œuvres. La structure est altérée également. D’après moi, cela se voit dans la déconstruction de tes deux romans.
C’est une lecture presque darwinienne du monde : tu t’adaptes ou pas. Dans Marthe , soit les personnages se déplacent, soit ils meurent. Ils n’ont pas notre chance de retrouver notre lit tous les soirs. Les œuvres qui sont capables d’embrasser les grands mouvements du monde me fascinent en littérature. Ce n’est pas le sujet de mes livres, mais inconsciemment, dans Marthe en tout cas, c’était là. C’est pour cela que le texte était lapidaire. Les romans fleuves sont les livres de gens qui ont du temps devant eux. Hardy n’en a pas.
Chaque minute d’écriture est une minute pendant laquelle il peut se faire tirer dessus.
Exactement : tu t’installes dans du discours quand tu sais que tu peux le faire. Ce n’est pas son cas. C’est une idée très intéressante à explorer dans un monde littéraire où les livres les plus vendus sont encore des bouquins de trois ou quatre cents pages. Les livres courts sont considérés comme des sous-œuvres. Pour ma part, je lis énormément de romans courts.
Dans le monde anglo-saxon, c’est différent. Les nouvelles sont reconnues. Il suffit de penser à la Canadienne Alice Munro qui a gagné le Nobel de littérature en 2013.
Oui. Sachant que les agents américains, j’en ai rencontré un pour publier Pense aux pierres aux États-Unis, posent tout de même cette première question : quel est le nombre de pages ? Cela reste un étalon à partir duquel ils se demandent si cela vaut la peine d’être traduit.
Et la démarche vise à savoir si le roman est assez long ?
C’est vrai que de toute manière le système d’agents est bien plus développé là-bas. Si la boîte décide de faire d’un livre un best-seller , elle le fera. Je pense à Justin Torres qui a publié We the Animals qui est un roman très court. Mais il a été repéré, il a trouvé les bons agents et il a été poussé. Il n’y a plus vraiment de normes, mais les briques ont encore leur place dominante. Je pense que dans plusieurs années, ce ne sera plus le cas.
Déjà ces dernières années, quand un gros livre gagne un prix littéraire, les libraires se plaignent. Cela encombre leurs étagères, car les acheteurs se dirigent moins vers eux.
Cela a été le cas avec Yann Moix quand il a publié Naissance chez Grasset. Il a remporté le Renaudot, mais il y a eu 60 % de retours.
Ou encore de l’Art français de la guerre d’Alexis Jenni qui s’est finalement mal vendu malgré son Goncourt. Je connais même peu de gens qui l’ont lu jusqu’au bout.
C’est vrai. On en reviendra et on en revient déjà.
Pour en terminer avec la place de la nature, j’aimerais ajouter une citation de Walter Benjamin à laquelle tu m’as fait penser lorsque tu parlais de la force destructrice qu’elle portait également dans tes romans. Il disait : « Le sens de l’Histoire, c’est le cheminement irrésistible de catastrophe en catastrophe. »
Il dit irrésistible ? Dans Pense aux pierres , c’est cela ! C’est magnifiquement trouvé. S’il était avec nous, je voudrais lui dire que j’aimerais que ce soit le cheminement, irrésistible sans doute, mais ralenti par notre intervention. Dans sa formulation, j’ai l’impression que c’est irrémédiable, même si cela l’est sans doute.
On peut imaginer une polysémie : irrésistible , soit irrémédiable, mais aussi irrésistible , dont on a envie inconsciemment, à qui on ne saurait opposer un refus.
Quoiqu’il en soit, on produit de la catastrophe. C’est peut-être un moteur dont on a besoin. Au premier barreau de l’échelle, c’est le début de la catastrophe, mais potentiellement le début de quelque chose de plus beau. J’espère en tout cas que nos réponses à ces catastrophes seront portées vers la recherche de sens.
Dans Pense aux pierres , tu écris : « Être vraiment écouté par quelqu’un est quelque chose de dingue, je me disais. Peut-être la meilleure qui soit. » Écrire et être lu sont-elles les meilleures choses qui soient ?
Écrire est la meilleure chose qui soit. Être lu, cela peut être très agréable comme tout à fait désagréable. Moi, par exemple, je suis dans un moment où j’aimerais ne pas avoir été lu. C’est une belle période, mais elle est paradoxale. Tu écris avec l’envie d’être lu. Mais j’écris avant toute chose pour être seul. L’ironie est que tu laisses s’exprimer des parts de toi qui d’ordinaire sont lettres mortes puis tu publies ton bouquin et tu ne fais plus que parler de toi. J’écris pour n’être personne, mais quand tu publies et que tu as un peu de succès, tu deviens quelqu’un dans ce milieu-là.
Tu parlais de vases communicants : tu as eu la solitude et tu reçois ensuite une surexposition.
Oui. J’ai récemment discuté avec Pascal Quignard lors d’un festival. Je lui disais que j’arrivais au bout de la promo, réellement, mais aussi de mon envie de le faire. Il m’a répondu de le prendre comme un acte sacrificiel : c’est une cicatrice à garder quelque part en soi. Cette cicatrice à la fois marque une épreuve, mais rend vierge pour l’écriture suivante. C’est totalement vrai. Être lu, c’est très beau, mais est-ce être écouté ? Et j’irais plus loin : ai-je seulement envie d’être écouté ?
J’aimerais simplement lancer des textes comme des comètes et que cela infuse.
Le problème, c’est que les gens qui te lisent veulent souvent entrer en contact avec toi. C’est facile de nos jours. J’ai reçu des centaines de messages d’inconnus qui m’envoyaient des photos d’eux avec les bouquins. Il y a quatre ans, ce n’était pas le cas. Que veux-tu en faire ? Tu ne peux pas répondre à tout le monde. Je l’ai fait au début, maintenant je ne le fais plus. C’est n’est pas ce que je veux, même si une part narcissique apprécie la circulation du livre.
Un mot pour la fin ?
J’aimerais te dire que tu as lu les livres avec beaucoup de profondeur, de clairvoyance, et que c’est assez rare. Ces interviews étaient vraiment intéressantes !