La Disparition des rêves de Marianne Rötig
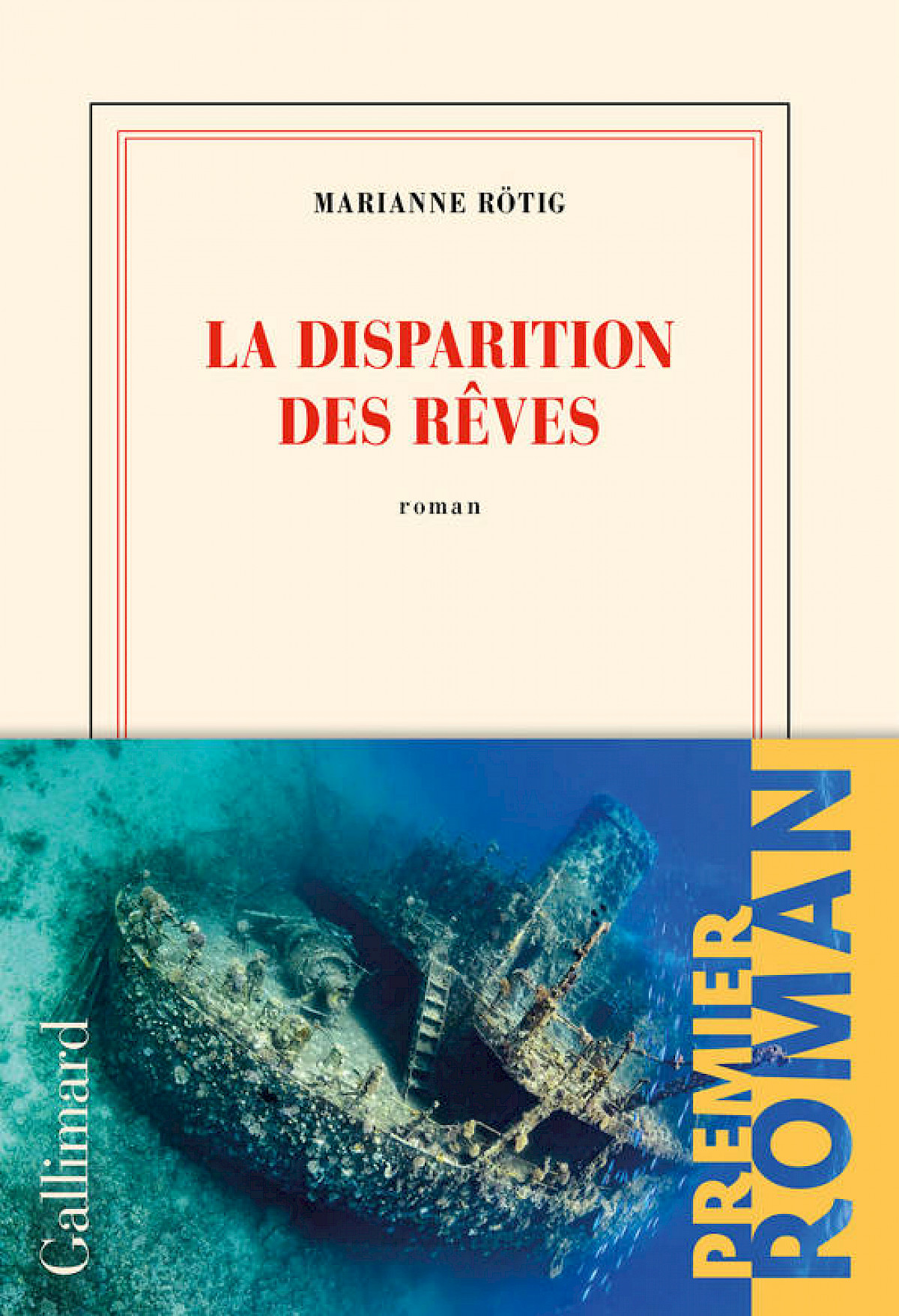
Marianne Rötig, dans ce premier roman, La Disparition des rêves , pose ce postulat au premier degré : sa narratrice ne rêve plus. Journaliste, elle découvre qu’en réalité elle est loin d’être la seule et que des organisations gouvernementales, d’autres clandestines, se penchent sur le problème.
La Disparition des rêves ouvre sur ce pitch hyper alléchant : les rêves ont disparu et puisque la narratrice est atteinte du mal, et s’en rend compte puisqu’elle est obsédée par le spectacle onirique de ses nuits, elle est la première sur le coup, sur ce scoop ! Par des rencontres hasardeuses, elle met la main sur des informations secrètes et pénètre un monde parallèle où le rêve est un enjeu depuis des temps anciens et traité avec le plus grand sérieux par des institutions officielles comme par des réseaux clandestins.Seulement, tout le sel du récit s’arrête là.
Une histoire Z (ou généralement B ou C, en opposition à la A, l’intrigue principale) (le Z est pour marquer ici qu’on est à l’opposé malheureux du moindre intérêt), c’est une intrigue dérivée du dérivé de l’intrigue principale. Comme si vous accédiez aux aventures de Superman à travers les yeux de l’homme de ménage du Daily Planet . Les aventures du Bardamu de Céline à travers les yeux d’un de ses grains de beauté qui parle, ou encore si Proust vous était conté via la vie sans doute passionnante de la madeleine dévorée elle-même. Original mais frustrant au possible.
Ici, chaque élément du récit concourt à cette sensation désagréable de constamment passer à côté de l’essentiel. Ne plus rêver, c’est physiologiquement grave. Il n’y a aucun consensus scientifique à l’heure où j’écris ces lignes sur l’utilité réelle, biologique, du rêve ; cependant, si on coupe la phase de sommeil où le rêve a lieu, les dégâts neurologiques sont importants. Dans le texte, ne plus rêver est traité comme un fait poétique, vaguement angoissant, qui révèle un lien à l’élément aquatique jamais vraiment exploité ni bien installé et une inquiétude générale dont on saisit mal l’urgence. Bref, un machin mystico-secret dont la narration explore l’aspect sexy avec maladresse.
Première sensation de malaise : ce fait alarmant est traité par-dessus la jambe. Où sont les morts ? Les victimes ? Certes, on est avant la découverte publique du mal. Et à la fin on a vaguement un appel d’un ami de la rédaction qui dit en quatre mots que « c’est la panique ».
Quand plus tard la narratrice rencontre Andrea, capturé par une agence gouvernementale pour sa capacité à rêver mieux que le commun des mortels et à pouvoir pénétrer et se balader dans les rêves des autres, sorte de patient 0 du mal, un des premiers infectés, devenu bleu translucide à force de vivre dans un caisson sous la mer, la journaliste prend une décision audacieuse et professionnelle. Elle décide qu’Andrea est super beau et que c’est cruel de l’enfermer, donc elle le kidnappe, ils font l’amour et son super pouvoir sert à… lui montrer sa mère, à lui. En rêve. Suivent des descriptions d’actes sexuels dignes des meilleurs Harlequin des années 90, les cow-boys du Montana en moins. Le Dr Manhattan version Lidl.
Chaque personnage est dégonflé systématiquement par la narration : ils sont plutôt bien esquissés comme originaux au départ, et une fois encore, ça s’arrête là. Par exemple Archibald, ancien dirigeant d’un groupe secret d’études des rêves ? On le sait à la dernière page et le gars le dit lui-même face au soleil couchant. Une vague impression de présentation à la Inspecteur Gadget . La figure maternelle inspirante et essentielle à la croissance de l’héroïne ? Elle a deux scènes avec un chat et un flashback mal amené. Même Camille, la protagoniste, n’est qu’esquissée : pourquoi ose-t-elle foutre en l’air sa carrière pour un superhéros en carton enfermé dans un cube sous l’eau ? Pourquoi s’investir autant dans cette enquête et traverser la moitié de la planète ? Pourquoi impliquer ses ami·es si c’est si dangereux ? Le ton léger et poétique n’excuse pas un manque de motif et de profondeur. On pense au K avec nostalgie, ou à Vian.
Autre frustration : tout élément extraordinaire finit par être expliqué par un des personnages ! Lire une note de bas de page régurgitée par un des personnages n’a rien de romanesque. Le style est à l’avenant : assez plat, parfois caustique, l’onirisme, qui devrait être une force du récit, est absent, rare si on considère les rêveries en italique de la protagoniste comme réussies.
Le récit se termine sur du vide : Camille a retrouvé ses amis dans l’organisation secrète et rêve à nouveau parce qu’elle mange des algues. Bien. Et le reste du monde ? Le défaut du happy end où le focus nous aveugle: les gentils ont gagné, le monde est sauvé. Tout comme dans Le Jour d’après ou Ravage , la sensation d’apaisement vient du protagoniste sauvé du problème alors que la planète brûle derrière lui.
Si vous voulez lire un roman qui ouvre une logique et la suit absolument jusqu’au bout et dans ses moindres ramifications, lisez l’Homme-dé de Luke Rhinehart ou Le Nazi et le Barbier d’Edgar Hilsenrath.