Bienvenue à Gattaca
Une fable déterministe
Autopsie philo-cinématographique #1
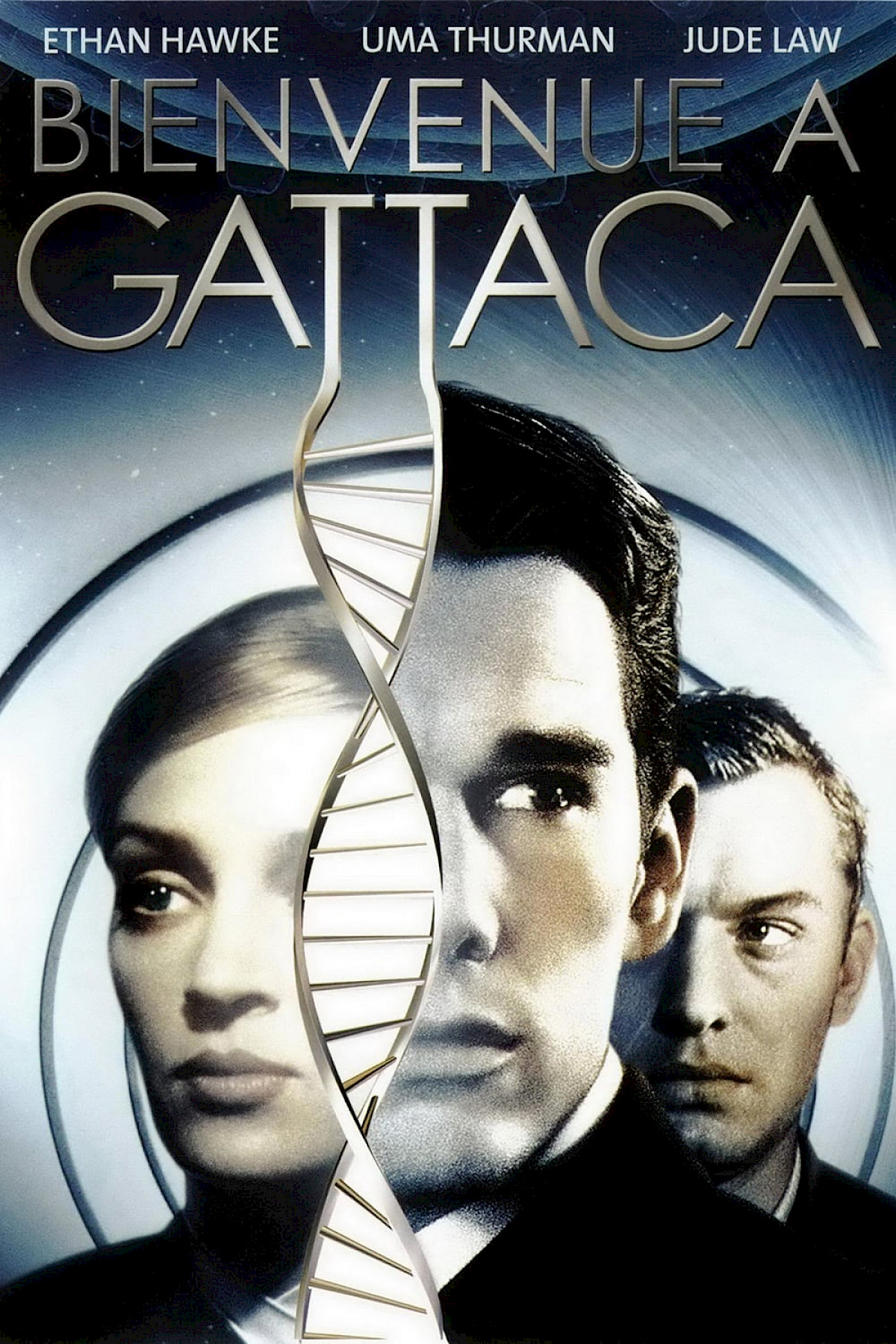
Transhumanisme, perfection et génétique, Bienvenue à Gattaca (Andrew Niccol, 1997) est une œuvre d’anticipation sur l’avenir eugéniste de l’humanité. Par cette fenêtre dans le futur, notre regard découvre les dérives d’un projet aussi fou qu’illusoire : vouloir rapprocher l’Homme de Dieu.
Vous rêvez de perfection physique et intellectuelle, alors Bienvenue à Gattaca ! Sorti en salle en 1997, ce film met sous le feu des projecteurs le déterminisme. Andrew Niccol exploite le registre de la dystopie scientifique et nous raconte l’avènement du surhomme génétique. S’amorce alors une réflexion sur la condition humaine et plus encore sur l’effort de dépassement qui la caractérise. Bienvenue à Gattaca est une œuvre magistrale, truffée de doubles sens et employant les subtilités langagières de la littérature comme du cinéma. Par son look rétro-futuriste et sa grammaire poétique, cette œuvre d’anticipation dégage une aura intemporelle. Son message aussi est une éternelle ode à la vie et à la liberté authentique.

L’horreur cartésienne
Tandis que notre époque s’interroge toujours sur les débouchés du transhumanisme, Bienvenue à Gattaca dépeint le grand projet cartésien d’un homme rendu « maître et possesseur de la nature ». Le rêve cartésien s’exprime ici sous une forme bien précise : la conquête spatiale. Mais pour accéder à un tel privilège, il faut être exempt de toute tare génétique. La sélection s’effectue au sein de l’agence spatiale Gattaca, dont le nom fait directement écho aux quatre lettres utilisées pour les bases nucléotides de l’ADN. La forteresse imprenable qu’est le centre de recherche spatiale fonde sa philosophie de recrutement sur un eugénisme poussé à l’extrême. Le genre humain est alors réduit à un strict calcul de probabilités, de potentiels et de séquençages ADN. Les « Valides », individus conçus par la science, surclassent les « Invalidés » conçus naturellement. C’est le point de départ à toutes les injustices socio-économiques : seuls les plus aptes pourront caresser le rêve étoilé.
Ce rêve se nomme « Titan ». La planète où doit se rendre l’élite humaine traduit ainsi par son nom le gigantisme d’un projet qui veut rapprocher l’Homme de Dieu. Et quelle autre forme que le cercle convoque mieux l’imaginaire du divin et de la perfection ? Au travers de son langage cinématographique, Bienvenue à Gattaca ne cesse de suggérer cette forme géométrique (porte, hublot, miroir, médaille, lunettes, tunnel, chaise roulante, etc.). Représentés de la sorte, l’infiniment petit (la cellule ADN) et l’infiniment grand (l’astre) sont les deux échelles de grandeurs qui balisent la quête de perfection de cette humanité. Au départ de la manipulation génétique, le projet cartésien s’achève ainsi avec la conquête spatiale. Cette forme stratosphérique d’élévation exprime simultanément les promesses du transhumanisme et le cauchemar social qui en résulte.
« Nous avons fait de la discrimination une science. » (Vincent)
La scène du concerto de piano illustre ce darwinisme social entre les bénis et les abandonnés de la science. Tandis que les Invalidés sont parqués par la police derrière des grillages, les Valides assistent confortablement à un concert exceptionnel. Le pianiste de la soirée dispose en effet de mains à six doigts lui permettant de jouer des partitions inédites. Le transhumanisme se lit dans ces doigts supplémentaires, une difformité génétique faisant de l’individu un virtuose de naissance. Le handicap devient alors l’absence d’altération génétique.

Le héros de notre histoire, Vincent (Ethan Hawke), se heurte à cette réalité discriminatoire. Lui qui poursuit le rêve de l’espace infini n’y a pas accès. Il est confronté à la finitude de sa condition. Né du hasard de l’amour, cet « enfant du destin » n’a pas bénéficié des largesses de la technique eugéniste. Cette même science lui diagnostiquera une myopie doublée d’une faiblesse cardiaque qui lui concède tout au plus trente ans à vivre. Le verdict est sans appel pour celles et ceux mis au monde hors des progrès génétiques. Dans cet enfer peint aux couleurs du paradis, Vincent est condamné, comme tout Invalidé, à demeurer un citoyen de seconde zone. La sentence tombe de la bouche de son propre père : « Ta seule chance de voir l’intérieur d’un vaisseau spatial, c’est d’y faire le ménage. » Vincent comprend alors que déterminisme social et déterminisme génétique ne cessent de s’alimenter.
Non contente de le priver de son rêve, la science mettra également sur sa route un terrible rival : Anton, son frère né in vitro, sa némésis génomique. Homme augmenté, le petit frère de Vincent dispose du meilleur patrimoine génétique de leurs parents. De l’aveu de Vincent, Anton est le « fils que [leur] père considérait digne de son nom ». Ce frère ennemi malgré lui sera un taon pour Vincent, le rabaissant de sa simple présence. Il se fera néanmoins battre lors d’une de leurs courses à la nage. Cette seule victoire servira de déclencheur à une prise de conscience : rien n’est acquis. Le pauvre Vincent, auquel immanquablement nous nous identifions par sympathie, quittera alors le domicile familial.

Le plan de la scène du départ cadre sur une photo de famille dans laquelle Vincent paraît insignifiant et à l’opposé du père. D’un geste annonciateur de sa renaissance en un autre, il déchire l’image à l’endroit de son visage, révélant par-delà la photo Anton comme celui qui, toujours, vient occulter Vincent. Cette mutilation est une marque de rupture et d’effacement : Vincent va s’arracher au regard de ses proches conditionnés par les certitudes de la sacro-sainte science. À l’hypocrisie d’une société qui reproduit les inégalités sociales, l’illégalité est son unique échappatoire…
Eugène : l’angoisse de l’excellence
Dès le second acte du film, Vincent embrasse l’illégalité d’une liberté authentique. Mais le prix exigé est conséquent. Cet effort pour gommer son identité – parfaite allégorie du phénomène d’acculturation sociale – ne lui apporte aucune gratification, sinon personnelle. Vincent devra porter sa croix sans l’appui de ceux qu’il aime. Toutefois, il trouvera un allié de fortune dans sa rébellion contre le système eugéniste : le bien nommé Jérôme Eugène Morrow (Jude Law). Ce Valide devenu paraplégique lui louera son identité.
Radicalement différent de Vincent, il lui fournira tout le matériel génétique nécessaire afin de se faire passer pour lui et s’introduire à Gattaca. Eugène Morrow porte en son nom l’essence de son personnage. Eugène (littéralement « Bien-né ») était destiné par la sélection eugénique à devenir un athlète de haut niveau. Son nom de famille, Morrow (« Demain »), évoque avenir et espoir. Or Eugène n’en a plus depuis son accident de voiture. Comme le résumera Vincent, « Après tout, il n’y a pas de gêne pour le destin ». Ce surhomme brisé, d’abord hautain et sarcastique, nourrira petit à petit une complicité avec Vincent. Bienvenue à Gattaca nous fait ainsi suivre en parallèle de la quête de Vincent l’arc de rédemption d’Eugène : l’aide qu’il fournira à Vincent redonnera sens à sa vie gâchée par un accident ; la réussite de Vincent sera la sienne.
« J’ai eu la meilleure part dans l’affaire. Je t’ai seulement prêté mon corps. » (Eugène)

La scène qui marque définitivement la transformation d’identité de Vincent en Eugène succède à l’entretien d’embauche à la station spatiale de Gattaca. Dans un plan d’ensemble, on aperçoit en unique élément de décor l’escalier tournant sur lui-même, évocation de la double hélice de l’ADN. Ce partage d’identité ne consiste pas simplement à singer les mimiques d’un autre ou à imiter sa signature, mais à en revêtir aussi le cuir et en absorber le sang. À l’avant de l’image, le véritable Eugène, vissé à sa chaise roulante, le regard vide, tourne le dos à l’escalier qu’il ne peut plus gravir. En surplomb, à l’arrière-plan, Vincent se fait l’ombre d’Eugène. Par cette mise en scène, le langage cinématographique synthétise la symbiose des deux hommes. Eugène a tiré un trait sur son patrimoine prometteur que Vincent compte exploiter pour se hisser vers les étoiles. Les deux personnages sont ainsi construits en miroir, l’un luttant pour obtenir ce à quoi l’autre a renoncé. Mais l’inertie à laquelle semble condamné Eugène relève bien plus d’une fermeture d’esprit que d’un handicap physique.
« Je ne veux pas changer, on ne peut pas changer ! » (Eugène)
Le piège d’une vision déterministe à outrance nous est dévoilé à travers l’incapacité d’Eugène d’envisager la moindre reconversion. Dès lors, l’alcool sera son unique refuge et l’escalier son ultime obstacle. Mais le masque froid et égocentrique qu’il porte finira par se rompre au contact de Vincent. Dans un moment d’ivresse, le surhomme brisé confessera la vérité sur son handicap : l’accident de voiture était une tentative de suicide ratée. Finir second sur le podium d’un championnat de natation – sa médaille d’argent – était à l’origine d’une crise existentielle. La chute de son piédestal avait laissé cet être conditionné pour l’excellence face à une absence de sens.
Vincent viendra mettre en échec la logique d’Eugène, prouvant par son obstination qu’il est permis de dépasser sa condition première et de déjouer tous les pronostics. Les deux invalides, de naissance et d’accident, joindront ainsi leurs efforts pour combattre le système discriminatoire de Gattaca. En cherchant à redorer son nom à travers Vincent, l’égocentrique Eugène se découvrira même un certain penchant altruiste. C’est ainsi qu’il constituera pour Vincent des stocks d’ADN en prévision de sa disparition à venir.
Toujours sous l’impulsion de Vincent, Eugène finira également par grimper l’escalier pour recevoir la visite impromptue d’un inspecteur. Cette scène allégorique montre sa victoire sur son handicap, et, à plus forte raison, sur son blocage mental. De cette façon, Eugène prendra pleinement conscience des efforts fournis par Vincent pour atteindre son rêve. Car le caractère fondamentalement inégalitaire d’une société repose sur un manque d’empathie, une méconnaissance des difficultés auxquelles certains, plus que d’autres, sont confrontés au quotidien. Jérôme Eugène mesurera enfin l’étendue des privilèges d’un « bien-né ».

L’arc narratif d’Eugène s’achève avec l’accomplissement du rêve de Vincent. La mise en parallèle du départ de ce dernier dans l’espace et du suicide de son ami colorent ce final d’une tonalité émotionnelle qui accentue l’effet de contraste entre les deux personnages. Les plans se chevauchent et les couleurs se répondent : Vincent dans la navette de ses rêves, Eugène dans la douche-crématoire ; chacun sur le départ. Dans une métaphore filée, le feu des réacteurs de la navette devient le combustible de la douche-crématoire. Cette douche, qui gommait chaque jour l’identité de Vincent, consumera cette fois le corps d’Eugène. D’un plan à l’autre, on assiste à la disparition des deux hommes de la surface de la Terre. Et tandis qu’une parcelle du véritable Eugène (une mèche de cheveux) s’envole, sa médaille d’argent qui blessait sa fierté devient d’or au travers des flammes. On distingue alors pour la première fois la gravure de deux nageurs, ultime hommage à la complicité des deux amies. Eugène voulait redorer son blason en aidant Vincent à atteindre son rêve, il aura surtout gagné en humanité. Programmé à l’excellence, le jeune homme finit par transcender sa nature égoïste. L’arc de rédemption d’Eugène – son dépassement – prouve que la perfection est à chercher dans notre rapport à l’altérité.
Vincent est-il un criminel ?
La dystopie eugéniste de Gattaca ne nous est pas dépeinte de façon frontale comme dans un docu-fiction. Ce système discriminatoire et la révolte de Vincent nous sont racontés au travers d’une enquête. Elle débute avec l’assassinat du chef de mission, seul obstacle de Vincent. Automatiquement, les soupçons se portent sur l’Invalidé dont l’ADN (un cil) a été retrouvé non loin du lieu du crime : Vincent. Andrew Niccol nous rappelle ainsi les dérives passées d’une certaine conception scientifique incapable de dissocier faits et interprétation des faits. S’il ne fallait en retenir qu’un exemple, la phrénologie du XIXe siècle se proposait déjà de prédire les capacités et penchants des individus sur la base d’une mesure de leur crâne. Mais à Gattaca, nul besoin d’étudier la circonférence crânienne : le crime se lit dans les gènes.
L’enquête compliquera les plans déjà ardus de Vincent pour atteindre sa navette, son portrait s’affichant sur tous les écrans. Notre suspension consentie d’incrédulité est mise à mal par l’absence de réaction du personnel de Gattaca : comment ne pas reconnaître Vincent sur les avis de recherches massivement diffusés ? Et si personne ne voulait le dénoncer…
Une scène cryptique nous met la puce à l’oreille. Dès la diffusion de l’avis de recherche, le chef adjoint de la mission vient voir Vincent en plein travail. Tout en posant une question insignifiante sur la mission spatiale, le chef attire l’attention de sa recrue sur l’avis de recherche qui s’affiche au bas de l’écran d’ordinateur. Un rapide échange de regards inquiets achève la scène. Dans un monde inauthentique, la vérité ne peut se dire que du bout des cils.

La question est alors la suivante : depuis combien de temps l’adjoint en chef de la mission spatiale connaissait-il l’identité réelle de Vincent ? À chaque échange entre les deux hommes, le chef de mission ne cache pas sa fascination pour l’un de ses « meilleurs éléments ». On comprend alors qu’il protégeait le secret de Vincent. Il le défendra d’ailleurs face aux investigations des enquêteurs et déposera lui-même son propre ADN à leur intention afin de se faire arrêter et de passer aux aveux.
Vincent est donc présumé innocent. C’est du moins ce que l’on veut nous suggérer. Car l’ADN du vieux chef de mission ne contenait aucune trace d’agressivité, là où celui de Vincent laissait apparaître quelque prédisposition de cette nature. Aussi, deux lectures sont possibles. La plus évidente est une critique de l’herméneutique génétique : il ne faut pas se fier aux apparences, encore moins aux codes génétiques des individus. Derrière le vieux sage peut se cacher une brute capable d’une froide sauvagerie.
La seconde lecture nous invite à questionner la pseudo-culpabilité du chef de mission. La résolution de l’enquête apparaît tel un deus ex machina expéditif. Vincent est sauvé in extremis par l’auto-dénonciation du chef de mission. Le mobile du crime est obscur et on devine que le chef de mission couvre un Vincent acculé, plus qu’il ne se libère du poids d’une culpabilité. Alors que l’enquêteur au chapeau explique fièrement à son collègue le mobile du coupable, celui-ci affiche un sourire en coin. Rappel de l’échange de regards avec Vincent, ce sourire espiègle en dit long. Le chef de mission semble davantage s’amuser de la situation que de s’enorgueillir d’un crime pour lequel il se serait dénoncé sans raison crédible. Ses aveux ne nous disent pas que Vincent est innocent ; ils nous montrent le sacrifice d’un homme qui a su dépasser ses préjugés de classe par une reconnaissance méritocratique. Cette seconde lecture nous force à voir plus loin et à réinterroger l’impact du darwinisme social sur les individus.
Vincent : victoire de l’acquis sur l’inné
Débarrassé des soupçons qui pesaient sur lui, Vincent sera confronté une dernière fois à son frère. Anton, que la sélection génétique avait voulu brillant inspecteur, retrouve finalement sa trace. Ces retrouvailles non moins hostiles qu’inattendues reproduisent le triangle dramatique de Karpman, les deux frères jouant à tour de rôle les victimes, sauveurs et bourreaux. Anton pose d’ailleurs sur Vincent le regard contempteur de leur père :
« ― J’ai le droit d’être ici, toi non. (Anton)
― Est-ce que pour toi, le seul moyen de réussir c’est de me voir échouer ? (Vincent) »
Derrière cette querelle fraternelle se cachent les préjugés discriminatoires auxquels Anton est resté enferré. Les deux frères s’affrontent lors d’une ultime course à la nage pour trancher la question de la légitimité des droits supérieurs accordés aux hommes augmentés. Alors que le véritable Eugène aurait vaincu Anton sans peine, la victoire de Vincent est une surprise, sauf pour le vainqueur :
« Tu veux savoir comment j’ai fait ? Je vais te dire comment j’ai fait, Anton : j’ai jamais économisé mes forces pour le retour. » (Vincent)
Vincent Freeman porte en son nom la synthèse du film : l’homme libre vaincra. Sa victoire sur Anton est le pivot de cette fable philosophique. Elle symbolise la victoire de l’acquis sur l’inné, du mérite sur le privilège, du fils sur le père. Car la préférence du père de Vincent pour le frère génétiquement optimisé se lisait jusque dans le legs de son prénom. Anton est le favori, l’héritier. Il n'accomplit toutefois rien de mémorable : il échoue à disculper Vincent, à le coincer chez Eugène, à le battre à la nage. Et s’il échoue de peu à la noyade, c’est par l’intervention salvatrice de ce même frère qu’il sous estime. Anton, qui devait embrasser le meilleur de son potentiel génétique, est ainsi montré comme un être défaillant. Cette victoire de Vincent, de l’homme libre sur l’homme formaté, se comprend au travers du concept de perfectibilité tel que défini par Rousseau :
« […] Sur cette différence de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue, et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation, c'est la faculté de se perfectionner ; faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres, et réside parmi nous tant dans l'espèce que dans l'individu, au lieu qu'un animal est, au bout de quelques mois, ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de mille ans, ce qu'elle était la première année de ces mille ans. »
(Rousseau, Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755)
Jean-Jacques Rousseau exprime la distinction homme/animal en opposant l’acquis et l’inné. Le potentiel humain étant de l’ordre de l’acquis, notre nature n’est pas totalement prédéfinie par notre patrimoine génétique. Contrairement à l’animal, nous pouvons nous émanciper de l'hérédité en progressant et en innovant. Vincent est humain – trop humain – en ceci qu’il s’accomplit entièrement dans sa perfectibilité. Il se confronte aux individus les mieux outillés génétiquement. Ce faisant, il repousse ses limites, n’économise rien de ses forces. Inversement, Anton, né du progrès scientifique, avance clés en main du meilleur de son potentiel. Dans son cas, il réalise sa condition plus qu’il ne la perfectionne. Bien qu’il porte aussi le nom de Freeman, il représente l’antithèse d’un homme libre. Même constat pour Eugène, l’athlète de haut niveau destiné à l’excellence par ses prédispositions génétiques :
« Pour Jérôme (Eugène), la sélection était quasiment garantie à la naissance. Il a le bonheur d’être pourvu de tous les dons requis pour une telle entreprise : un quotient génétique inégalable. Non, il n’y a réellement rien de remarquable dans la progression de Jérôme Morrow. À cela près que, moi, je ne suis pas Jérôme Morrow. » (Vincent)

Le conformisme génétique de l’excellence ôte toute appréciation de la perfectibilité humaine. Du fait de leur code génétique, les humains conditionnés de naissance se rapprochent davantage des abeilles générées par la ruche selon des besoins spécifiques. L’absence d’animaux ou de leur simple évocation durant le film renforce ce parallélisme entre l’élite humaine de Gattaca et l’animalité définie par le concept d’innéité. Mais c’est surtout la scène du pianiste aux douze doigts qui met en lumière le processus de déshumanisation par l’altération génétique. L’écart entre l’humain augmenté génétiquement et le chien d’élevage devient ténu. Sur l’affiche du concerto auquel assiste Vincent, le pianiste virtuose occulte totalement son visage derrière ses mains difformes. Terne et dramatique, la photo suggère par sa mise en scène la perte d’humanité.
Cette perte se lit d’ailleurs dans le conformisme extrême auquel se soumettent les recrues de Gattaca. Leur costume monochrome, leur coupe de cheveux à l’identique et leur démarche synchronisée – rappel de Métropolis de Fritz Lang – les font paraître à l’écran pour des automates. Vincent arrachera l’intrigante Irène à ce mode de vie inauthentique. Soucieuse de découvrir les imperfections de chacun et s’intéressant d’abord au supposé Eugène pour ses prédispositions génétiques élevées, la jeune femme finira par aimer Vincent pour ce qu’il est réellement.
Avec son esthétique épurée, Bienvenue à Gattaca nous offre ainsi une réflexion aboutie sur la déshumanisation qu’engendre l’eugénisme – un message tout droit adressé à l’eugénisme libéral1 légalisé outre-Atlantique. À vouloir tordre la nature perfectible de l’Homme, la science eugénique le réduira à un être bêtement formaté. Notre essence n’est pas une réalité prédéfinie, et il suffit de se remémorer cet aphorisme de Nietzsche pour s’en convaincre : « La grandeur de l’Homme c’est qu’il est un pont, et non une fin. »
Le Dr Lamar : un père, un espoir
Bienvenue à Gattaca s’offre le meilleur des dénouements avec un brillant deus ex machina. Dans ce dernier acte, le rêve de Vincent semble lui échapper avec un test d’ADN au débotté. Tel Orphée à la sortie des enfers, Vincent se retrouve coincé à la porte du sien. Il comprend que Lamar, le docteur qui suivait son parcours médical depuis son entrée à Gattaca, est sur le point de découvrir la supercherie et de l’arrêter. Mais Lamar n’en fait rien et révèle être au courant de la fausse identité de Vincent. Une fois encore, tout est dans le non-dit : Lamar active le bouton qui rend « valide » l’identité de Vincent – c’était si simple. Pour se justifier, le médecin se sent le besoin de lui parler de son fils dans un échange qui fait écho au début du film :
« ― Je vous ai déjà parlé de mon fils ? (Lamar)
― Non jamais. (Vincent)
― Faites-moi penser à vous en parler un jour. » (Lamar)
Ce fusil de Tchekhov installé à la sixième minute s’active six minutes avant la fin du film. Un tel soin du métrage montre l’importance de la relation entre le Dr Lamar et Vincent. Ces deux scènes en miroir se doublent d’une remarque sur le sexe de Vincent. L’étrange fascination que le Dr Lamar portait au début du film pour l’organe d’« Eugène » s’explique lors de cette scène finale. En effet, pour parfaire son imitation d’Eugène, Vincent, gaucher de naissance, était devenu ambidextre. Or, l’usage des claviers rendait inutile cet effort. Aussi, Vincent négligeait-il de se servir de sa main droite lors des tests d’urine. Les étranges remarques du Dr Lamar au sujet du sexe de Vincent avaient donc pour but d’attirer son attention sur ce geste anodin qui le trahissait. En définitive, Lamar se trouvait être l’ange-gardien de Vincent, et non celui de la navette.

Dans ce final, le Dr Lamar partage à Vincent l’admiration que lui porte son fils, un enfant créé conformément à la philosophie eugéniste… mais avec un résultat en deçà des attentes initiales : « Malheureusement, mon fils n’était pas tout ce qu’ils avaient promis… Cependant qui sait ce qu’il saura faire ? » En un instant, le film renverse les perspectives : la science ne nous est plus présentée comme omnipotente. Heureusement, Lamar ne voit pas son fils comme un échec. Dans la conclusion pleine d’optimisme de ce père médecin, on pourrait presque entendre la réponse de Spinoza à la conception mécaniciste du corps cartésien : « Nul ne sait ce que peut un corps » (Éthique III, 2, S). Car c’est bien là l’erreur que dénonce le film : penser l’Homme et le monde comme une machinerie qu’on pourrait rationaliser et contrôler. Lamar apparaît telle une lueur d’espoir dans cette dystopie ultra-déterministe. Tout en évoquant la similitude qu’il perçoit entre Vincent et son fils, le médecin exprime l’échec du système auquel pourtant il participe.
De son côté, Vincent tire un enseignement de l’intervention salvatrice de Lamar : on ne peut se construire sans l’aide des autres. Le déterminisme n’est pas seulement une affaire de génétique, il est bien plus social. Le mythe du self-made man prétend s’en extraire. C’est une vue de l’esprit. La logique causale du déterminisme nous lie invariablement à l’altérité. En effet, Vincent aurait-il pu atteindre les étoiles sans l’aide d’Eugène, d’Irène, du vieux chef de mission, et même d’Anton ? Non. Cette vérité, Vincent l’avait oubliée en rompant toute attache familiale. Et il lui fallut la révélation du Dr Lamar pour s’en apercevoir. Ainsi, reconnaître l’existence du déterminisme ne nous octroie pas le privilège de lui échapper. Sa réussite personnelle, Vincent la doit autant à son entourage qu’à son obstination.
Cette démystification du self-made man amène un peu d’humilité dans la réussite de Vincent. Elle s’accompagne néanmoins d’une récompense pour sa persévérance. Le jeune homme reçoit le plus beau témoignage d’estime de la bouche du Dr Lamar, celui de l’inviter au départ par son véritable nom. Le médecin-contrôleur comble de la sorte l’aporie laissée par l’absence d’une figure paternelle structurante. Tout dans la mise en scène y est symbolisé.

Tandis que Vincent est invité par Lamar à prendre la navette, la caméra le cadre en gros plan ; une porte ouverte à sa droite, une autre fermée à sa gauche. Dans cette perspective, Vincent semble écrasé par ces deux portes qui représentent de part et d’autre la poursuite ou l’échec de son rêve. Dos tourné à ces deux choix, il adresse un ultime regard au Dr Lamar. Le masque d’indifférence de Vincent qui singeait Eugène s’efface d’un coup pour laisser place au regard trouble d’un enfant perdu. En réponse, le Dr Lamar lui décoche un léger mouvement de tête, tel un père qui se voudrait rassurant.
La boucle est bouclée, la filiation est établie hors de tout lien génétique. Lamar était le père que Vincent cherchait, et Vincent le fils que Lamar aimerait voir advenir. La seconde quête de Vincent s’achève en même temps que son rêve d’astronaute – rêve d’enfance jadis brimé par son père biologique. Une fois dans la navette, il semble être le seul passager à ne pas contempler le décollage. Sa victoire est plus grande. Ses yeux sont clos, comme s’il ne se souciait plus de ce rêve qui l’a porté. La sérénité d’avoir trouvé un substitut paternel en ce monde est peut-être la raison pour laquelle Vincent admet finalement avoir « soudain du mal à le quitter ».