Rocky, dernier rivage de Thomas Gunzig
« Il oubliait que le monde avait disparu »
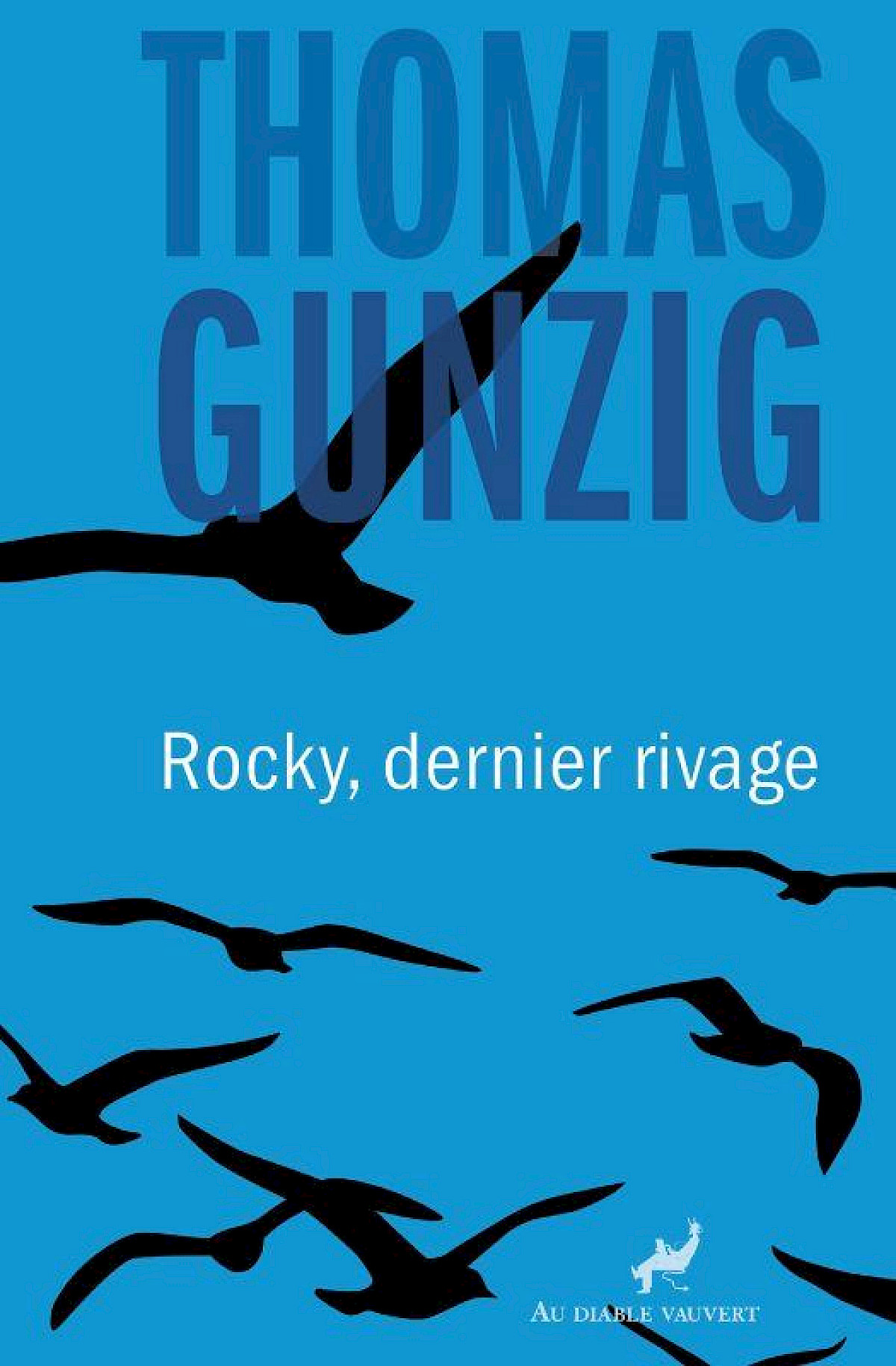
Dans l’esprit de l’absurde, du fantastique et des dénonciations sociales qui le caractérisent, Thomas Gunzig fait fort : montrer la fin du monde sous l’angle de ceux qui y échappent. Derrière son titre mystérieux, Rocky, dernier rivage cache les affres d’une époque tourmentée.
Cette année, Thomas Gunzig nous emmène quelque part dans le futur, après la fin du monde. Alors qu’on peut s’attendre à une histoire remplie de lieux communs, où des personnages tentent de survivre dans un environnement postapocalyptique, l’auteur nous surprend et nous présente une famille multimillionnaire, la dernière famille en vie sur Terre.
Fred, riche investisseur dans l’informatique, a fait construire un abri de luxe sur une île isolée de l’Atlantique, et y protège ses proches. Lorsqu’un bug survient dans les disques durs, tout le patrimoine humain sauvé, séries, musiques et livres numérisés, disparaît pour toujours… sauf un titre : le film Rocky.
Le monde montrait quelques signes inquiétants : pandémies, soubresauts économiques, guerres, anomalies météorologiques… Ça donnait l’impression de vivre dans un train dont le conducteur aurait sauté en marche.
On apprend au milieu du roman que la fin du monde a pour origine la propagation d’un virus fromental1. Si aucune institution ne prend d’initiative, c’est parce que les actionnaires du secteur du blé attendent les pénuries pour en augmenter le prix. Ce fond d’inhumanité illustre les inquiétudes sociales et écologiques de Rocky, dernier rivage, par lesquelles le choix du blé rappelle un synonyme d’argent. Il étend aussi une réflexion sur la transition écologique que nous vivons : un développement durable, qui transforme la protection de l’environnement en un marché à conquérir, est-il possible ?
Le récit est construit sur quatre parties qui segmentent la chronologie et la réarrangent selon les besoins de l’intrigue. Les voix qui la maintiennent sont celles des personnages. Fred, le père, est un produit de l’élitisme social fondé sur le succès économique. Il chérit encore sa fortune anéantie, en surveillant de près chaque recoin de son île aménagée. Il en vient à craindre la solitude et rappelle autant la nécessité rousseauiste de faire société, que Jack Torrance de Shining qui sombre dans une folie assassine.
Il savait bien que, d’une certaine manière, sa vie d’avant n’avait pas plus de sens mais au moins, grâce à l’agitation qui y régnait, il avait l’illusion d’être la pièce essentielle d’un spectacle que tout le mon
Il y a aussi Hélène, la mère, qui pleure chaque matin presque rituellement. Elle se drogue au Xanax, comme pour éviter d’affronter la réalité. Mais le fils aîné Alexandre est le personnage qui m’a le plus ému. Contrairement à sa mère, il est moins dans une démarche de déni que de plénitude : il passe ses journées à écouter de la musique et à boire jusqu’à l’ivresse en face de l’océan. On peut y entendre un écho à Baudelaire, et en particulier au premier vers de L’homme et la mer : « Homme libre, toujours tu chériras la mer ! »
Ces trois jours passés seul sur la plage avaient été trois belles journées, grâce aux baies sombres, grâce à la vodka, grâce à la musique s’ajoutant à l’ivresse, la tristesse avait un peu relâché l’emprise qu’elle avait sur son esprit et la vie lui avait paru plus légère.
Enfin, Jeanne, la cadette, est une amatrice de musculation, de séries télévisées américaines et de leurs personnages qu’elle rêve d’incarner. Pour faire face à l’ennui qui la ronge, elle épie ses proches et s’immisce dans leur intimité. Ce n’est d’ailleurs pas sans rappeler le divertissement pascalien qui, selon le philosophe, nous évite de ruminer à propos de questions existentielles.
En effet, les interrogations ontologiques2 se révèlent derrière l’absurdité de la situation, presque son comique en fait. Cette situation qui fait de cette famille la dernière sur Terre et dans l’Histoire. Mais aussi une situation spatiotemporelle très floue. On sait qu’on est dans le futur et l’Atlantique, et c’est à peu près tout. Finalement, cette angoisse : qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on s’accroche à la vie, sans savoir où elle nous mène, ou bien est-ce qu’on se résigne à l’entropie et à se laisser mourir ? Et si le choix de Rocky comme dernière trace de l’humanité évoque des héros qui se battent et perdent la tête haute, on peut dire que Thomas Gunzig se montre plus pessimiste…
Il n’y a plus rien ici non plus. Je préfère un « rien » que je ne connais pas à un « rien » que je connais par cœur.