Rencontre avec Julie-Marie Duro
Comment raconter la mémoire ?

Exposée toute cette semaine dans notre galerie virtuelle, Julie-Marie Duro a répondu à quelques questions. De quoi cerner un peu mieux son travail, ses ambitions et son caractère.
Il paraît que tu travailles pour le moment au Churchill parce que tu n’as pas de bourse pour financer ta thèse.
Julie-Marie Duro : Exactement ! Je fais une thèse en art à l’ULg, dans la section arts et science de l’art.
Quel a été ton parcours avant d’arriver à cette thèse ?
J.-M. D. : Je suis née et je vis à Liège. Je suis d’ailleurs née à trois cents mètres de ma maison actuelle… J’ai étudié la philo à l’ULg et me suis beaucoup intéressée à la philosophie de l’art, et notamment à l’art de masse, d’où découle mon intérêt pour la photographie, qui était purement théorique au début. Et puis petit à petit, à ma sortie de l’université, j’ai voulu la pratiquer. Donc je me suis inscrite à Saint-Luc en cours du soir, des cours de promotion sociale.
En sortant de là, j’étais persuadée que j’allais être une reporter de guerre… Déjà pendant l’université, je m’étais inscrite à la Défense, et ils ne m’avaient pas choisie parce qu’il trouvaient que je n’avais pas le bon diplôme… Pour commencer, avant de me lancer dans un projet aussi hardcore, j’ai séjourné en Afrique, au Burkina Faso, dans une école qui est parrainée par des Belges.
Ça, c’est donc ton projet JM Jessica.
J.-M. D. : Oui ! Je parrainais cette petite fille depuis quatre, cinq ans. J’ai d’abord interviewé des personnes ici qui étaient aussi parrains pour savoir ce qu’ils attendaient de cette initiative, puis j’ai posé des questions aux enfants qui bénéficiaient de ces parrainages, mais là-bas, au Burkina Faso. Et là, je me suis rendu compte qu’il y avait deux manières de voir les choses qui ne se rencontraient en fait jamais. Les attentes étaient différentes, donc la frustration était palpable des deux côtés.
J’ai donc compris à ce moment-là que je n’étais pas faite pour le métier de reporter de guerre. Tout me faisait peur, et j’ai très vite compris que j’avais besoin d’un certain confort pour évoluer. Même avec les gens, je n’arrivais pas à gérer émotionnellement ce que je voyais. Donc, le travail que j’ai essayé de réaliser sur place n’était pas bon.
Même avec cette ambition de capter quelque chose de la réalité, tu n’es pas parvenue à dépasser ton désir de confort, à vivre dans des situations hors du commun pour satisfaire ton projet ?
J.-M. D. : Il faut aussi savoir que je n’ai pas supporté l’antipaludéen, j’ai donc fait des crises de paranoïa pendant un mois… J’étais plutôt tout le temps stressée… J’ai donc fait de belles photos de voyage, mais aucune n’entrait dans le cadre de mon projet, parce que je n’arrivais pas à prendre sur moi pour aller plus loin dans les conversations, etc. Quand une porte m’était fermée, elle était fermée, et je ne faisais rien pour l’ouvrir. J’avais besoin de me sentir en sécurité, sinon je n’arrivais pas à penser à autre chose qu’à ça.
C’est pour ça qu’en revenant, j’ai plutôt transformé cette expérience en texte. Quand je suis revenue, j’ai pu relire toutes mes notes, que je prenais sur place au fur et à mesure mais sans jamais pouvoir y revenir. Je savais que je pouvais les retravailler après, ce qui n’est pas le cas des photos.

Est-ce que c’est ton côté « philosophe » qui a repris le dessus à ce moment-là ?
J.-M. D. : Je ne pense pas. Mes études ont sans doute influencé mon texte, mais à la base je voulais plutôt rédiger un texte narratif sur mon expérience et sur ce que j’avais pu glaner comme informations pour mon projet ; je ne désirais pas produire une réflexion. La philosophie a certainement influencé mon écriture, mais elle n’a pas été un but à atteindre pendant la rédaction de ce texte.
Tu as donc produit un récit qui entre dans ta recherche sur l’écriture et la narration mémorielles.
J.-M. D. : Que ce soit en photo ou sous forme textuelle, mon travail tourne autour de ça, en effet. J’ai aussi un intérêt particulier pour le récit subjectif. Quand on parle de récit, on pense souvent à la fiction, or mon but n’est pas de faire de la fiction, en tout cas pas de la pure fiction, j’aime bien quand il existe un lien avec la réalité. Je mélange le réel et le fictionnel, notamment dans mon travail sur la recherche de mon oncle (cf. l’exposition à la galerie Satellite).
La fiction est venue par hasard. Quand j’ai commencé à chercher mon oncle, j’ai d’abord pensé que j’allais faire un récit narratif vraiment factuel. J’ai cru naïvement que j’allais partir au Japon, rencontrer des gens qui connaissait mon oncle, récolter de plus en plus d’informations et que ça allait ressembler à une enquête policière… Sauf que chaque fois que je rencontrais quelqu’un, j’arrivais à un cul-de-sac. Chaque piste que j’empruntais s’arrêtait très tôt. J’ai donc commencé à imaginer les parties qui me manquaient.
Tu viens d’esquisser ton projet actuel, mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? À quoi correspond cette recherche de l’oncle ?
J.-M. D. : Depuis mes seize ans, je suis allée quelques fois au Japon avec ma mère. Elle est fascinée par ce pays. Pour moi, c’était juste des vacances au Japon. D’ailleurs au début, je ne comprenais pas la fascination de ma mère, je n’aimais rien là-bas, la nourriture, les gens… Et puis ma mère m’a annoncé que j’avais un oncle japonais. Je n’ai pas été tout de suite marquée par cette révélation, jusqu’à ce que je me rende compte que je faisais finalement comme ma mère, c’est-à-dire que je regardais les gens et essayais de voir des personnes qui rentraient dans la catégorie « oncle possible ».

Est-ce que vous alliez dans les endroits où il pouvait potentiellement vivre ?
J.-M. D. : Non, au départ on allait en vacances, donc on allait un peu partout.
Mais si vous alliez un peu partout au Japon, est-ce que ta mère avait déjà cette quête d’un oncle inconnu en tête ?
J.-M. D. : Je pense qu’elle ne voulait pas le chercher, mais qu’elle voulait le trouver. Elle n’avait pas une démarche active, mais elle favorisait le hasard d’une rencontre. Quand j’ai pensé à ça, je me suis demandé pourquoi moi je ne le chercherais pas. Maintenant que je le fais activement, elle voudrait que je le retrouve. Mais comme je le disais, je n’ai actuellement plus aucune piste valable.
Ce travail représente une partie de ta thèse. Si tu as épuisé toutes les pistes pour le retrouver, qu’est-ce qui se passe ?
J.-M. D. : Je vais pouvoir travailler sur la partie académique ! Elle porte sur le rapport ente la fiction et le vœu de fidélité à la réalité dans la mémoire familiale, sur la manière dont la fiction apparaît dans la mémoire familiale et si l’on doit l’éviter ; et puis sur le rapport entre la mémoire et le lieu, plus précisément entre la mémoire et le paysage : est-ce que les paysages favorisent le travail mémoriel ?
À terme, quelle est ton ambition première, faire valoir le volet académique ou le volet artistique de ta thèse ?
J.-M. D. : J’ai plutôt envie de défendre la partie artistique. Mais je trouve que la partie académique sert la partie artistique. J’ai une meilleure compréhension de ce que je fais, et ça donne de nouvelles idées pour le futur. Dans mon travail actuel, il est impossible de distinguer les deux parties parce qu’elles se nourrissent l’une l’autre.
Mais est-ce qu’un jour tu pourrais imaginer ne produire que de l’artistique, sans concept derrière ?
J.-M. D. : Oh oui ! Là, pour le moment, ça se passe ainsi. Je fais un travail documenté, et c’est vrai que se documenter est un réflexe, mais je pourrais ne pas toujours remplir une œuvre de concepts.

Un travail purement artistique, ce serait quoi ?
J.-M. D. : Ce serait un travail où il n’y aurait pas d’académique ou d’essai derrière, ce serait un ensemble d’images pures. Ce qui n’empêche pas que les images soient le résultat d’une recherche préalable. Mais le résultat n’est qu’images.
Exposes-tu aussi ton travail académique à la galerie Satellite ?
J.-M. D. : Non, je ne montre que les images, pour deux raisons : je dois encore travailler sur cet aspect-là, il n’est pas encore présentable, et je veux que les deux parties existent aussi indépendamment l’une de l’autre.
Tiens, d’ailleurs, quelle serait pour toi la plus grande consécration ? Si tu as envie d’être un jour consacrée ?
J.-M. D. : Ce serait de pouvoir faire ça du soir au matin, d’avoir du temps pour réaliser tous mes projets.
Tu utilises aussi le média vidéo. Quel est selon toi le média le plus intéressant pour représenter une mémoire ?
J.-M. D. : Je ne pense pas qu’il y ait un média meilleur qu’un autre. Je crois que la pluralité est intéressante. Que ce soit la vie ou la mémoire, tout est très fragmenté, et nous vivons avec des informations éparses, qui viennent d’un peu partout. Rien n’est uniforme, donc mon travail n’a pas à l’être.
Revenons un peu en arrière. Tu travailles donc dans une faculté qui s’appelle « arts et science de l’art ». « Science de l’art », quel drôle d’intitulé… Est-ce qu’il existe une science de l’art ?
J.-M. D. : Moi j’ai de toute façon un problème avec « art », un problème avec « science » et j’ai un problème avec « science de l’art ». Les trois sont selon moi impossibles à définir. Je ne peux pas te répondre, parce que ce sont des notions floues. Parfois, je classe ce que je fais parce qu’il le faut, et je laisse à d’autres chercheurs le soin de définir tout ça !
Cette faculté me permet néanmoins de mener de front deux de mes ambitions, l’académique et l’artistique. C’est une faculté qui se distingue parce qu’elle propose d’utiliser l’art comme un laboratoire de recherche. Ce n’est pas comme en philosophie où l’art peut appuyer un propos, ou dans des facultés purement artistiques où l’essai peut servir à appuyer l’œuvre. Ici, l’art est le point de départ d’une recherche.
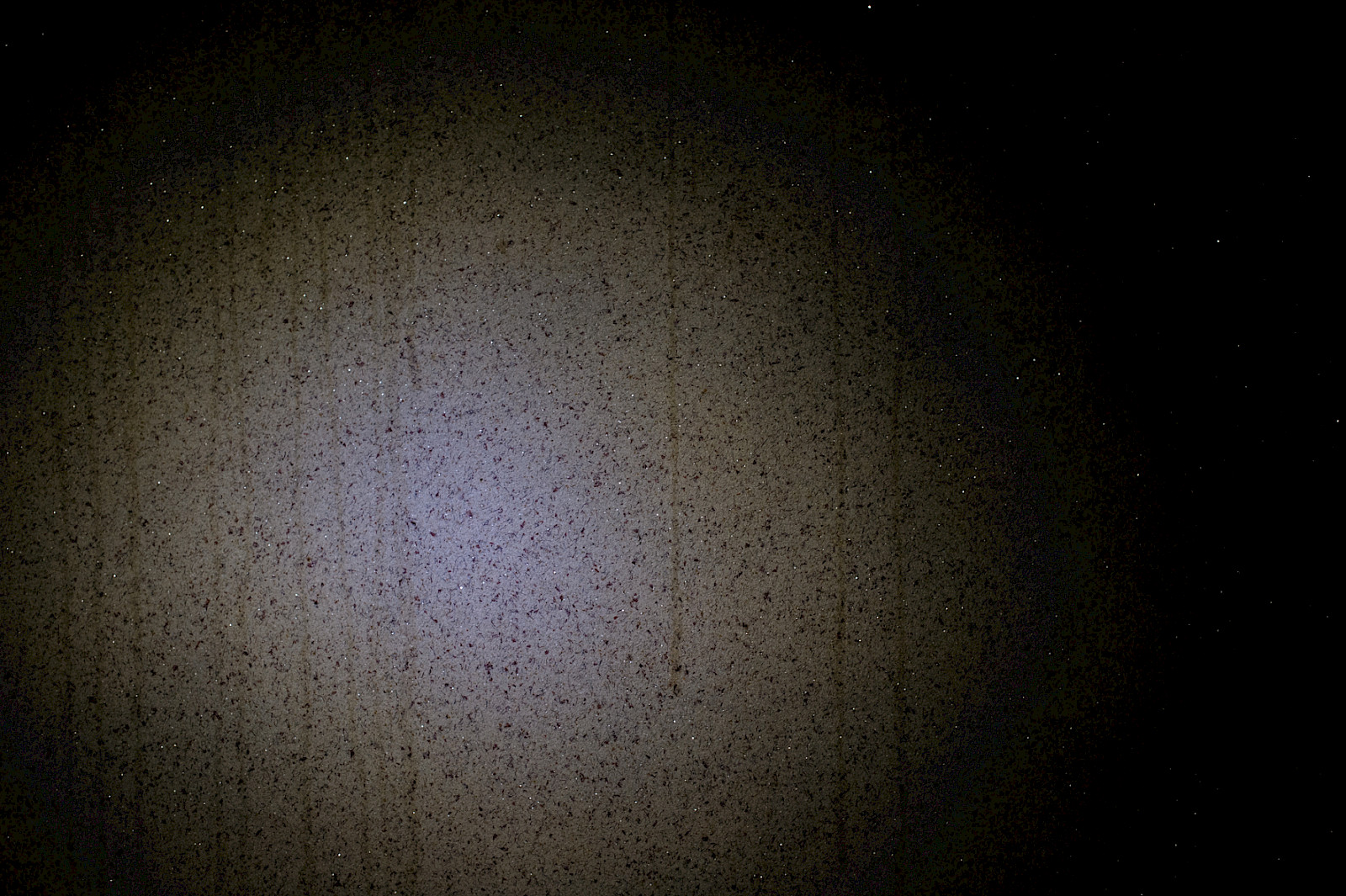
TOUT AUTRE CHOSE
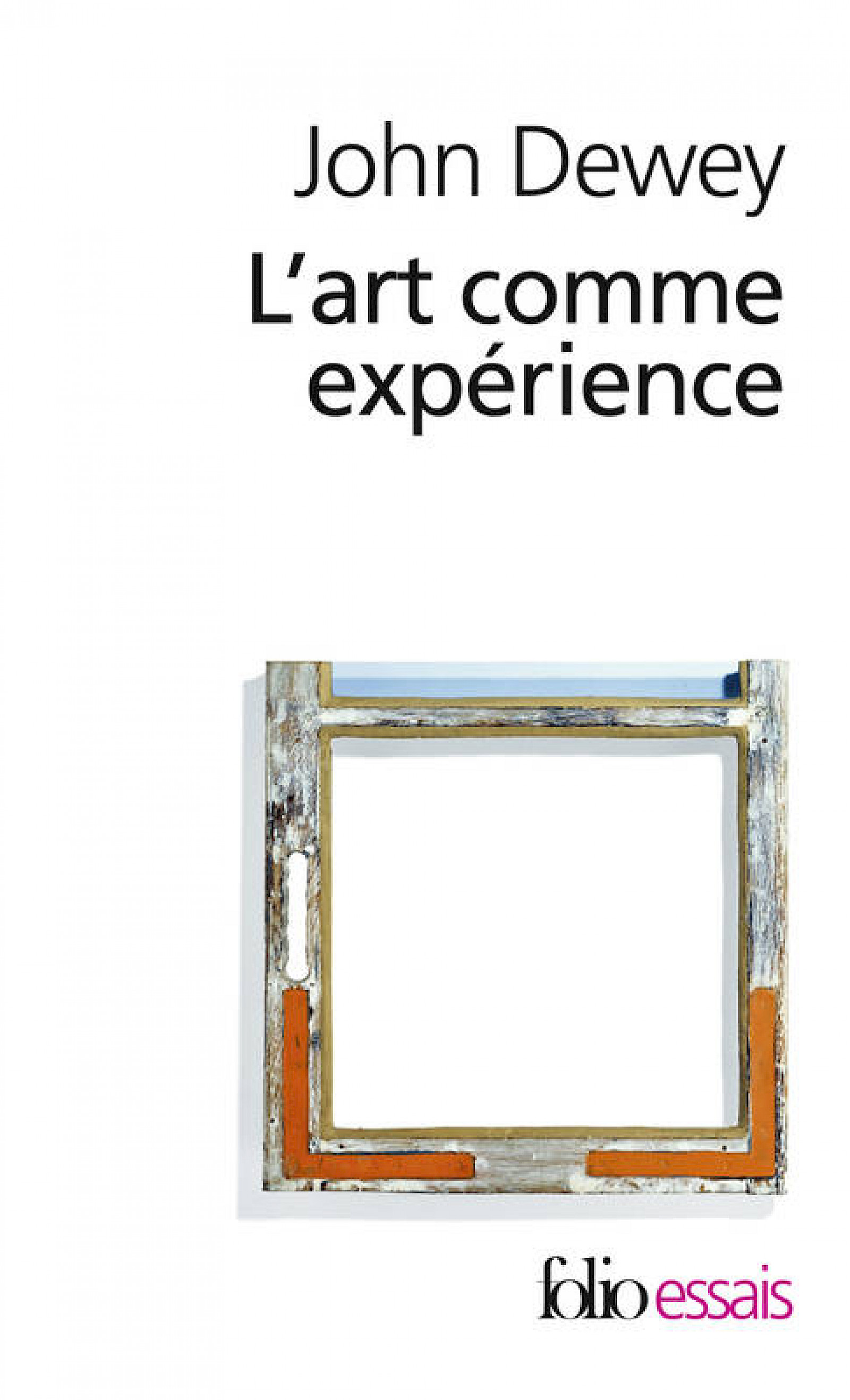
Un livre…
Celui qui m’a le plus influencé, c’est l’Art comme expérience de John Dewey. Ça m’a aidé à concevoir mon rapport aux œuvres et à l’audience. L’idée de ce livre est que l’expérience artistique est la quintessence de l’expérience quotidienne. L’art n’est pas quelque chose à part.
Du côté des romans, il y aurait Expiation de Ian McEwan. Si j’explique pourquoi j’ai pensé à ce livre par rapport à mon projet, je révèle la fin…
Un film…
Mr. Nobody de Jaco Van Dormael, avec cette question du choix dans une réalisation très réussie. Ou la Langue de ma mère de Hilde Van Mieghem, ou encore Hiroshima mon amour …