Brussels Art Film Festival 2021

Le BAFF, qui s’est déroulé du 10 au 14 novembre 2021, a permis de se plonger dans les rêves concrétisés ou non de nombreux artistes par le biais de réalisations le plus souvent belges. Cédant à l’onirisme qui si souvent m’a emporté, non content d’en rapporter les événements majeurs, j’en conte une histoire.
Il y a des jours sans. Les paupières s’ouvrent doucement, mais un grain de poussière roule aussitôt sous la paupière et irrite et opacifie le monde comme seule la fumée de cent cigarettes le peut. La pièce apparait maladroitement, comme si elle venait de s’éveiller en même temps. Elle est ébouriffée, elle sent encore la transpiration, ses traits sont flous et le sol tarde à accueillir le moindre pas. Elle n’est pas prête. Les sens ne le sont pas non plus. Ensemble il faut pourtant arriver à s’ajuster, pour que la main s’appuie sur le lit, pour que le corps s’en extirpe une bonne fois pour toute. Pour que… Mais l’objectif manque. L’être éveillé sort d’une insomnie pénible qui a un gout pâteux de pas assez. Ses yeux se sont lovés sous les paupières, mais pour mirer leurs envers. Sa tête alourdie roule jusqu’à la fenêtre pour absorber un peu de lumière et des lambeaux de paysages derrière la buée matinale. La pièce les lui refuse et l’être se retrouve en train de prendre son petit déjeuner, en train de monter des marches dans un complexe administratif tentaculaire, en train de tomber à la renverse et de passer à travers un trampoline au lieu de rebondir dessus. Il tente quelques paroles, jetées dans les vagues en espérant l’océan : « il me faut gagner le beau ». Elles reviennent, sans atteindre la vitre perlée de rosée, sans s’être baignées dans la plénitude solaire. Les paroles reviennent sèches et terreuses marquées par les absences qui ont émaillé leur périple.
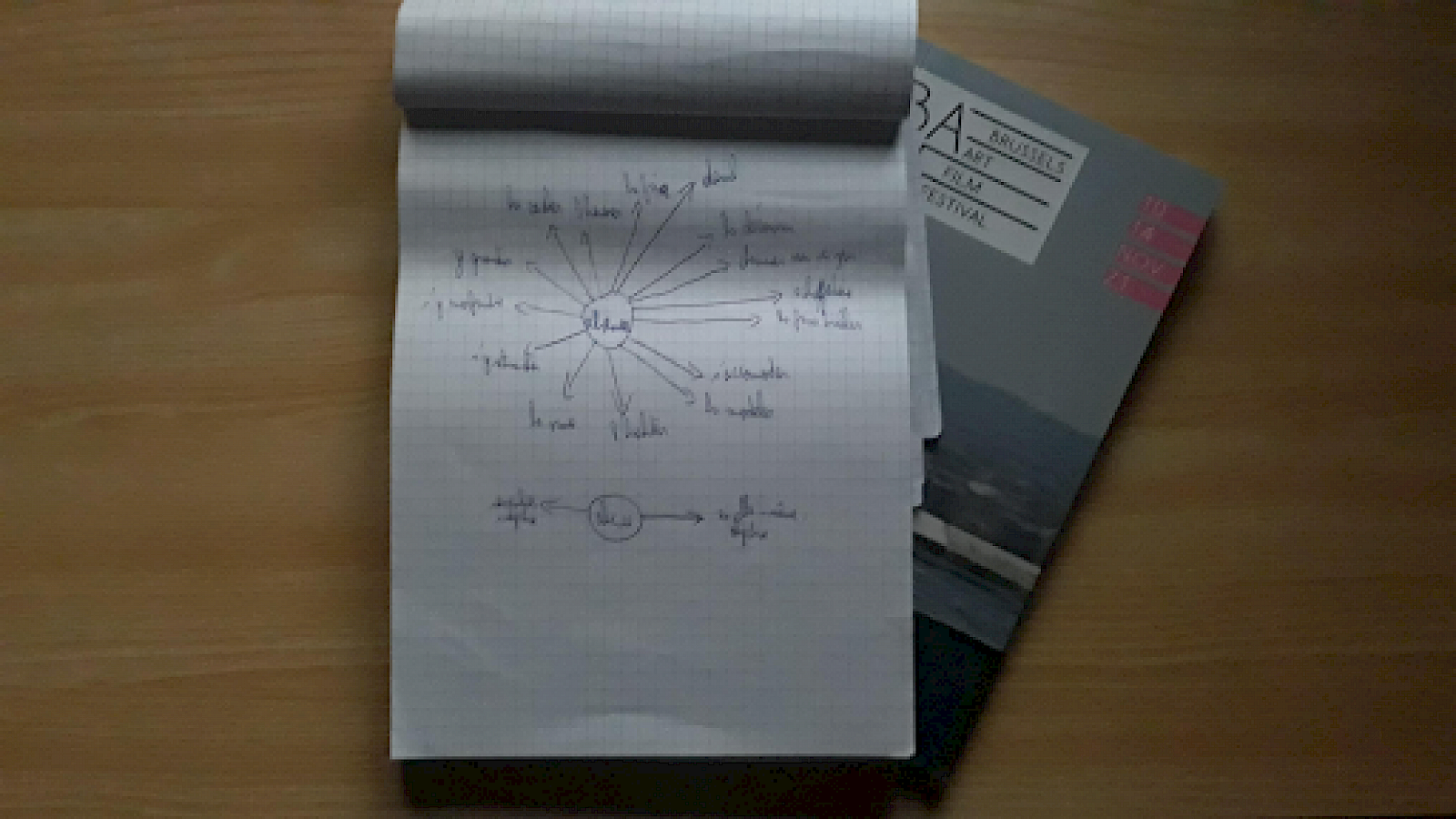
La première d’entre elle s’épanouit dans le champ tandis que le hors-champ sature des murmures des dernières traces d’un marais originel désormais effacé ( Murmur de Jan Locus et Stijn Demeulenaere). Des trains filent et des silhouettes se faufilent. Cependant, ils disparaissent aussitôt pour laisser s’épaissir le silence des images fixes qui ne contemplent que leurs propres squelettes décharnés. Les sons circulent autour des images, à moins que ce ne soient les images qui circulent en quête de bruissements par lesquels se vêtir.
Les corps en tout cas frémissent. Eux qui ont été si longtemps acclimatés aux mouvements métronomiques des machines se voient abandonnés à eux-mêmes ( Opus de Pauline Pastry). Ils s’étalent à la surface du monde. Ils brassent les airs, la chaîne de production jamais vraiment arrêtée. Dans un frisson, ces corps se rident de plis d’humanité depuis leur surface jusqu’aux chairs les plus intérieures. Ils aménagent l’absence comme on aménagerait une maison, accumulant les caisses jusque-là entreposées dans la cave pour un souffle de vie. Ils se transmutent et leurs gestes mécaniques d’éoliennes désarticulées deviennent une danse. « Je te donne le beau après m’être retrouvé », soupirent-ils par demi-mots un peu mâchés sur les bords mais à la limpidité d’une eau claire.

À peine les paroles se décident-elles à se replier dans le mutisme qu’elles aperçoivent un homme affairé par les caisses abandonnées autour d’une absence désormais lumineuse ( Over the Top de Justine Cappelle). Il est un glitch dont les traits ne cessent de freezer au contact de la réalité. Son projet consiste à immortaliser une épitaphe de l’humanité dans une pyramide égyptienne afin de trouver dans ce geste artistique de quoi légitimer sa propre existence. En entassant des caisses dont la peau de carton contient jalousement des bouts de rien, il se prépare à un acte jeté dans le vide. Ses actions s’abîment dans la vanité tandis que seuls ses rêves conservent un minimum de consistance. Courant d’une vanité à l’autre, celle de sa popularité espérée se noie dans un puits insondable.
Il n’est d’ailleurs pas le seul à empiler des cartons vides et à se lancer dans des voyages qui n’aboutissent pas au résultat espéré. Non loin, une artiste et son amie se lancent dans un voyage bigarré où la fantaisie se noue de poésie pour entraîner les roues d’un véhicule de Montréal à Los Angeles dans le but de rencontrer Miranda July ( L.A Tea Time de Sophie Bédard Marcotte). C’est l’occasion de croiser un « redneck », selon les mots de l’intéressé, aussi inquiétant que chaleureux, de redécouvrir les vertus de la méditation, d’entendre Chantal Ackerman en déesse habitant des nuages roses réconfortants, tandis que le projet baigne dans une continuelle absence de certitude.
Sur le même continent mais des décennies plus tôt, une actrice ayant participé à un tournage avec cette dernière, mais alors encore simple mortelle, se décide à effectuer des recherches sur les correspondances entre Calamity Jane et sa fille afin de réaliser un film qui ne se fera d’ailleurs jamais. Le tout est suivi par une seconde réalisatrice faisant ainsi le compte-rendu d’un non-film et surtout d’une enfilade de tunnels de monologues dont on ressort souvent en hypoxie ( Calamity Jane et Delphine Seyrig, a Story de Babette Mangolte).

De l’autre côté de l’Atlantique, un passionné de Talk Talk se lance d’ailleurs dans une aventure où il ne peut utiliser ni les musiques du groupe, volonté du chanteur Mark Ollis, ni rencontrer les différentes personnes qui ont pris part à sa réussite ( In a Silent Way de Gwenaël Brees). Il aménage alors l’absence, tout comme les humains s’accommodaient de leur vie en dehors de leur enlacement avec les machines. Il se contente alors du fantôme de leur œuvre, rassemblant au hasard des musiciens pour qu’ils suivent une série de consignes sans jamais savoir qu’ils sont conduits à jouer à la manière du groupe. Ainsi résonne tout du long une musique étrange, improbable, jamais là où on l’attend, à l’image du modèle musical dont ils suivent le sillage. Ainsi aussi, le passionné de Talk Talk ne peut pas mieux retranscrire leur univers que par cette errance de trace en trace de leur passé en manquant à chaque fois leur présence. Rien n’est plus propre à Talk Talk que leur progression vers un style de plus en plus radical, ultimement en prise avec le hasard afin de franchir les dernières limites de la création. Le fait de nommer un album, « The Diceman » , en hommage au livre extraordinaire de Luke Rhinehart, est un signe qui ne trompe pas.
En même temps qu’il convoque le fantôme de leur œuvre pour les rendre un peu plus palpables, le passionné de Talk Talk court après l’invisible. Telle celle de Cézanne qui pour sa part s’attarde longuement entre les quatre murs de l’atelier de l’artiste devenu musée ( Cézanne de Sophie Bruneau). Ici aussi, les commentaires tournent autour du peintre depuis déjà longtemps disparu. Visiteurs et visiteuses de tous bords ainsi que guides et employées lui redonnent vie par un ballet continuel revenant sur des anecdotes, sur le sens de ses toiles ou encore en réarrangeant le décor afin de lui garantir un peu d’éclat. L’invisible ainsi s’entretient, s’honore et se pare de mots, s’époussette, se nettoie et se respecte. Comme un dieu d’un panthéon polythéiste, il réclame des rituels pour que ses temples se perpétuent dans le temps. Chaque objet prend une densité historique où leur propriétaire initial continue de transparaître en eux. Par cette légère sortie de piste, l’absence n’est plus seulement ce qui vient hanter. Elle peut devenir une nouvelle plénitude magnifiant l’incomplétude, au lieu d’une douleur et d’un sentiment profond d’injustice.

Douleur et injustice, comme cela a pu l’être lorsque le mouvement punk s’est insurgé au Royaume-Uni contre la montée de l’extrême-droite et le racisme en faisant preuve d’un extraordinaire sens de l’humanité dépourvu de frontières ( White Riot de Rubika Shah). Comme cela a pu l’être lorsqu’une troupe de théâtre s’est débattue pour maintenir ses répétitions malgré les conditions très difficiles des mois de confinement ( Phèdre ou l’explosion des corps confinés de Méryl Fortunat-Rossi). Elle a fini par être représentée en septembre 2021, ayant droit sur Karoo à un article qui met en lumière le résultat d’un travail qui aurait pu sombrer dans un univers où le futur de la culture ne tient plus qu’à un fil. Comme ça a pu l’être et est encore, lors du mai 68 sénégalais. Le militant maoïste Omar Blondin Diop, que la France a pu découvrir dans La Chinoise de Godard, tâtonne pour s’aiguiller sur le marché des courants politiques du XXe siècle ( Juste un mouvement de Vincent Meessen). Alors que le continent africain doit trouver sa propre voie au-delà d’une béance identitaire. Comme cela ne l’est plus lorsque, dans un geste magnifique, la peintre Barbora Kysilkova accueille son voleur de tableau pour en faire son modèle et parvenir à transmuer son propre vide intérieur en apaisement, en même temps que lui apprend à ne plus dévaler de la pente comme un vulgaire caillou soumis à la gravité universelle ( The Painter and the Thief de Benjamin Ree). Comme cela ne l’est plus tout à fait pour l’orchestre de rumba congolaise de feu Wendo Kolosoy, qui continue à accomplir son rêve avec Bakolo Music International ( Bakolo Music International de Tom Vantorre et Benjamin Viré). Ce malgré la vieillesse grandissante de ses membres et les tracas que cela entraîne.
L’absence peut devenir un jeu dans lequel se plaît et complait la créatrice ou le créateur, dans lequel il s’enveloppe, au lieu de chercher à se hisser au-dessus de l’absence, au-dessus de sa montagne de cartons vides. Pour Martin Margiela, artiste de la mode belge parmi les plus réputés au monde, s’effacer est une opportunité de se consacrer à son œuvre et de maintenir un équilibre que l’exposition aux médias de tous vents n’aurait pas permise ( Martin Margiela in His Own Words de Reiner Holzemer). Ce souci va jusqu’à marquer ses défilés par ses célèbres mannequins masqués et expliquer son retrait soudain du monde de la mode à la fin des années 2000. Pour Yuki Okumura, ne jamais mentionner le nom de l’artiste évoqué par les nombreux témoins présentés de dos permet de ne pas trahir son univers singulier ( L’homme qui de Yuki Okumura). Comme disait B. Traven : « La biographie d’un créateur n’a absolument aucune importance. Si l’auteur ne peut être identifié par son œuvre, c’est que celle-ci, comme lui-même, ne valent rien. Un créateur ne saurait avoir d’autre biographie que son œuvre. ». Même plus, les paroles se font plus intenses et l’imagination plus fébrile à mesure que les pièces viennent s’accoler au ballon de baudruche. Tantôt la vérité se pare de fable, tantôt la fable se pare de vérité. Ces astres jumeaux tourbillonnent jusqu’à emporter dans le vertige d’un doux rêve où l’on se plaît à se noyer dans les anecdotes, sans spécialement vouloir faire la part de la fiction et du réel. Pour Jérôme Bel, il s’agit pour lui de se glisser dans les anfractuosités laissées par les normes établies ( Être Jérôme Bel de Sima Khatami et Aldo Lee). Ses chorégraphies se veulent ainsi expérimentales jusqu’à l’extrême, remettant en question les formatages esthétiques pour proposer des choses aussi étonnantes que drôles. Non pas au sens d’un rire moqueur, qui serait uniquement destructeur, mais comme un rire plein qui sous-entendrait un « il a osé aller jusque-là » témoignant d’une audace artistique (frôlant parfois une escroquerie artistique qui touche au génie, il faut l’admettre) hors du commun. Thierry Smits, également chorégraphe, suit une voie semblable lorsqu’il déshabille ses danseurs pour exposer la masculinité dans sa nudité , ce autant au sens naturel que culturel ( Bare d’Aleksandr Vinogradov). Déshabiller quelqu’un ne le déshabille pas complètement. Exposer ainsi des corps entraîne des réactions qui montrent que le corps n’est jamais entièrement nu, mais habillé culturellement . Ce qu’on y voit dépend des tabous auxquels on a été éduqués, de la manière dont le corps est symbolisé, représenté, mis en histoire. Donc, quand il est ainsi exposé, le chorégraphe n’échappe pas à la nécessité de jouer avec cet arrière-fond, pour le bousculer et faire ressortir le corps tel qu’il est hors de cette gangue. Dans la beauté de ce qui est ordinairement absent et qui maintenant ressort de la fracturation des représentations. Enfin, pour le dissident tchèque Jan Jedlička, dont la fibre artistique s’emplit de sa sensibilité envers les silences et les absences, il y a ce souci permanent pour les transformations et le mouvement ( Traces of a Landscape de Petr Zaruba). Loin de toute planification, de toute programmation qui lui rappellerait son passé sous le joug communiste, il se fie surtout à son intuition que ce soit dans ses peintures ou ses photographies. Il ne souhaite pas un paysage clos, mais sans cesse ouvert sur son dehors. Quand il peint, il puise ses pigments dans les paysages qu’il a foulé de ses pieds afin de les répartir sur ses toiles et retrouver avec exactitude les couleurs rencontrées. Ses toiles débordent en s’épaississant de l’intérieur. En s’y penchant, on pourrait ainsi peut-être entendre le murmure de la côte toscane, si là aussi l’image ne circulait pas autour afin de s’en revêtir.

Enfin, l’absence peut également être celle d’un festival qui ne s’est pas organisé d’une année à l’autre et qui se dédouble en portant en elle l’absence dont il a été frappé. En revenant sur mes pas, la chambre devient chambre de montage et démontage où les films se font autant qu’ils se défont au fil de leurs jours et de leurs nuits. En revenant sur mes pas, les absences scrutées depuis les formes évanescentes qui épousent les vitres de la pièce deviennent de nombreuses œuvres projetant loin de leur lit des torrents d’énergie créative. En suspendant mes pas, j’ouvre à nouveau mes yeux sur la salle de cinéma dans laquelle j’ai découvert les films du Brussels Art Film Festival , curieux ballet d’absences où je ne peux forcément que céder à un moment de distraction hors de moi-même. Les derniers noms au générique de fin disparaissent à leur tour et la salle s’illumine. J’ajuste encore difficilement mon corps à la pièce tandis qu’en fermant les paupières je vois encore son envers. De ma rangée, je glisse aussitôt aux rues de Kinshasa où les Bakolo s’apprêtent à partir pour l’Europe, puis de mot en mot de la conférence cagienne sur le rien de Jérôme Bel, puis de caisse en caisse pour au sommet m’assoupir dans une piscine à débordement californienne où non loin une dame me présente les écrits de Calamity Jane.