Parfois l’homme de Sébastien Bailly
« La vie n’a aucun sens, mais il faut de la litière pour le chat. »
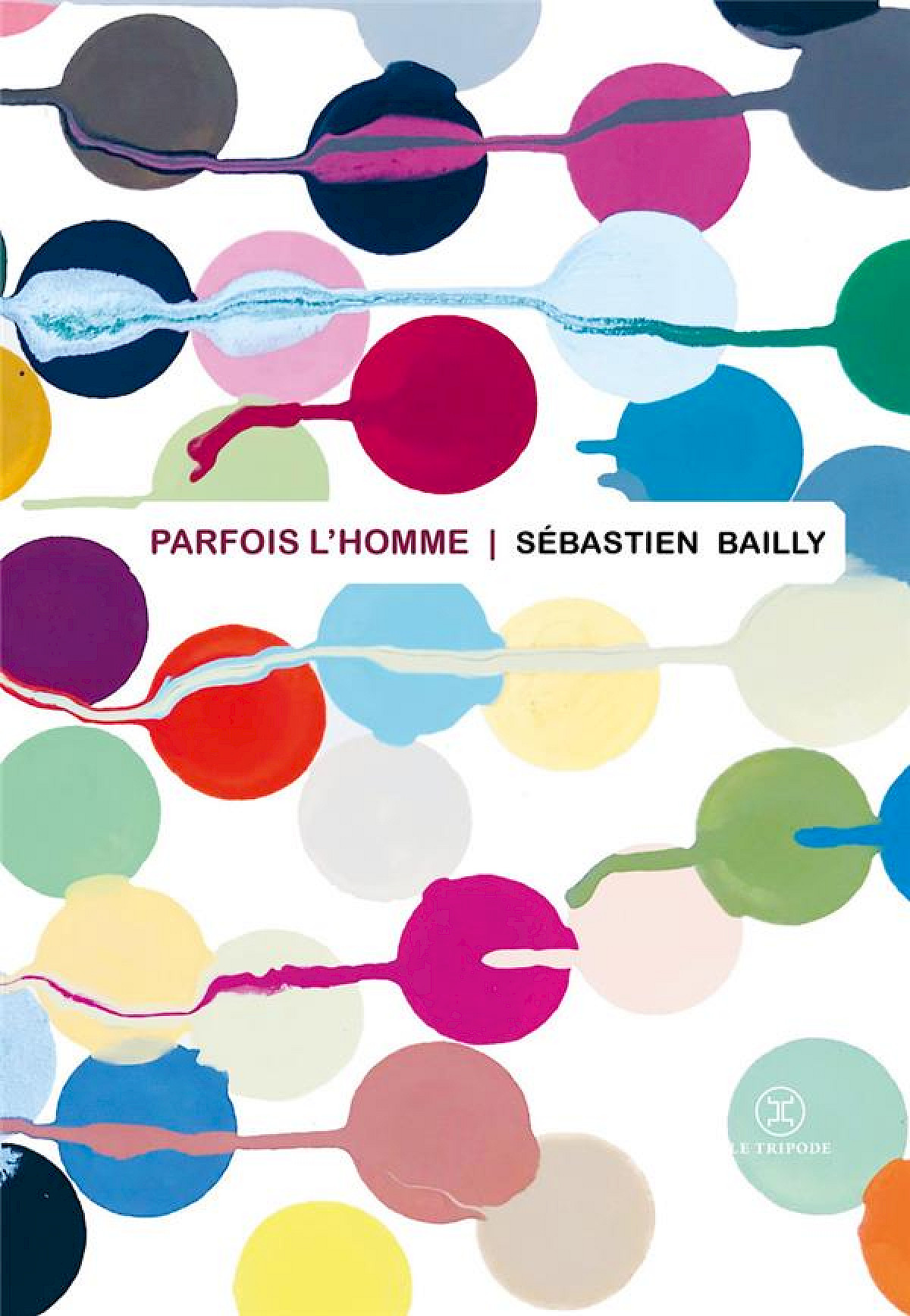
Premier roman pour Sébastien Bailly édité en ce début d’année au Tripode. En récit de vie, mode d’emploi ou étude de mœurs, Parfois l’homme manque peut-être juste de la femme. Malgré tout, ce livre émouvant a le mérite de réunir les grands mystères du quotidien.
Pour son premier roman, Sébastien Bailly nous fait le récit d’une vie, celle de l’homme. On comprend rapidement qu’il s’agit d’un stéréotype, d’une résultante de la moyenne de tous les chemins de vie possibles et imaginables. Le flux spontané des mots louvoie entre grands fils rouges et détails négligeables. Sur une page, l’auteur aborde le malaise ressenti à la majorité par les jeunes adultes nouvellement responsables, et sur une autre, il explique comment l’homme a appris à faire ses lacets.
« Le classement de la bibliothèque, pour peu qu’on veuille facilement remettre la main sur un auteur, demande des choix réfléchis. […] Le bazar est un préliminaire à sa créativité. Dans un univers aseptisé, il s’étiole. »
L’auteur raconte au tiers du roman les premiers émois de l’homme. C’est quand il parle du sentiment extatique d’être amoureux d’une fille pour la première fois que l’évidence m’a frappé : Parfois l’homme oublie la femme. Ce choix artistique, pour ne pas croire à un véritable oubli, pose toutefois question, surtout quand on le remarque un 8 mars.
En essayant de dégager les topos universels de l’expérience humaine, il est dommage de mettre de côté celle de la moitié des sujets. On pourrait supposer que l’homme est en réalité l’Homme, pourtant il se révèle vite devenir père et grand-père, mais ni mère ni grand-mère. Après ma lecture, j’ai découvert les premiers épisodes de Cœur sur la table, un podcast féministe publié depuis 2021. Le besoin de réinventer les codes de la fiction, que la réalisatrice Victoire Tuaillon a quelquefois évoqué, est ici encore une fois confirmé. Espérons pouvoir attendre un prochain Parfois la femme.
« Un conseiller d’orientation est quelqu’un qui, lorsqu’il est allé voir un conseiller d’orientation, a choisi le métier de conseiller d’orientation. C’est fascinant : il est entré dans le bureau, il a vu le conseiller d’orientation et il a dit : je veux faire ça. »
Quand arrive le temps pour l’homme de choisir sa voie, m’est directement revenue la punchline de Nekfeu dans son morceau « Humanoïde » : « Qui a conseillé la conseillère d’orientation ? » L’entreprise d’Orelsan aussi dans « Notes pour plus tard », en feat. avec Ibeyi, résume la réflexion : montrer que le « moment de ta vie où tu peux devenir ce que tu veux [est] le même moment où c’est le plus dur de savoir ce que tu veux ». Pour de nombreux proches de ma génération, à dix-neuf ans, ces paroles résonnent et raisonnent.
Le choix de ses études, de son métier, de son couple, et tous ceux qui s’ensuivent ne sont pas sans rappeler les thèses d’Heidegger à propos de l’inauthenticité. La vie avec un petit v, c’est-à-dire le quotidien dans son acception pratique, ne serait qu’une couverture pour échapper à l’angoisse insoluble causée par une mort inéluctable. Les choix qu’on fait sont alors censés être les moins risqués, les plus « logiques », les plus inauthentiques en somme. Mais les choix sont obligatoires : c’est là où le malaise survient.
Et cet exemple de l’orientation professionnelle n’est pas le seul qui participe au malaise : l’inquiétude de ne pas avoir de centre d’intérêt saillant, la timidité rattrapée par la nécessité d’être sociable, le n’importe-quoi que paraît être le monde, etc. J’ai été très ému par la première moitié du roman. Et, tout compte fait, par la seconde, après la vingtaine, aussi. Bien qu’elle explore des thématiques et problématiques qui touchent les plus âgés que moi, elle m’a insufflé une étonnante nostalgie du futur, une terrifiante impression que la vie devant soi est déjà vécue.
« L’homme, souvent, écrit un poème […] Il ne vise pas l’originalité, car tout a déjà été dit, et si bien, mais revendique une sincérité qui peut toucher au cœur. […] Il trouve la poésie très compliquée. Les gens ne se rendent pas compte de l’effort que ça demande, de la technique mise en œuvre, du nombre de questions à résoudre pour placer diaphane à la fin d’un octosyllabe. »
Plus généralement, je me suis reconnu à travers de nombreux aspects du roman. Déjà parce que je suis un garçon de classe moyenne qui, jusqu’ici, a eu une vie plutôt banale. Mais aussi grâce à plusieurs passages précis. Notamment celui où l’homme écrit de la poésie, ou celui où il remarque que certains noms communs sont à l’origine des noms de marque, et vice-versa. Cette figure rhétorique, appelée antonomase, j’en avais encore parlé en cours la semaine précédente.
Enfin, il y a les questions plus profondes, plus philosophiques. Pourquoi naît-on ? Pourquoi la vieillesse est-elle un vœu de souffrance incurable ? Pourquoi en vient-on à vouloir ce qu’on redoute, la mort ? Elles ont ravivé des tentatives de réponse toujours échouées. Elles ont aussi rappelé Rocky, dernier rivage de Thomas Gunzig, dans l’aspect faussement optimiste. Et malgré sa carence en représentativité féminine, pour moi, elles ont rapproché Parfois l’homme du livre que tout lecteur recherche, le livre qui inspire dans son intégralité, comme la synthèse de ce qu’on est.
« L’homme a appris un jour ce qu’était l’absurdité ontologique et cela lui a fait du bien de mettre des syllabes un peu pompeuses sur le sentiment profond que rien n’avait vraiment de sens et qu’il devrait pour toujours composer avec ça. […] la vie n’a aucun sens, mais il faut de la litière pour le chat. »