Amours féroces, amours libres

À l’occasion du centenaire
À l’occasion du centenaire
de sa mort,
retour sur un roman méconnu
de Jack London,
écrivain américain
du début du XX
esiècle,
la Petite Dame dans la grande maison
.
On reconnaît instinctivement en Jack London l’auteur fasciné par la puissance de la nature. Ses premiers succès,
l’Appel de la forêtet
Croc-blancont pour héros des animaux obligé de se battre pour survivre face à la double hostilité du
wild(la face sauvage de la nature) et de l’être humain. George Orwell, dans un essai consacré à l’auteur, notait d’ailleurs que la férocité et la rage constituaient le pilier véritable de son œuvre et qu’on leur devait sa teinte, son originalité.
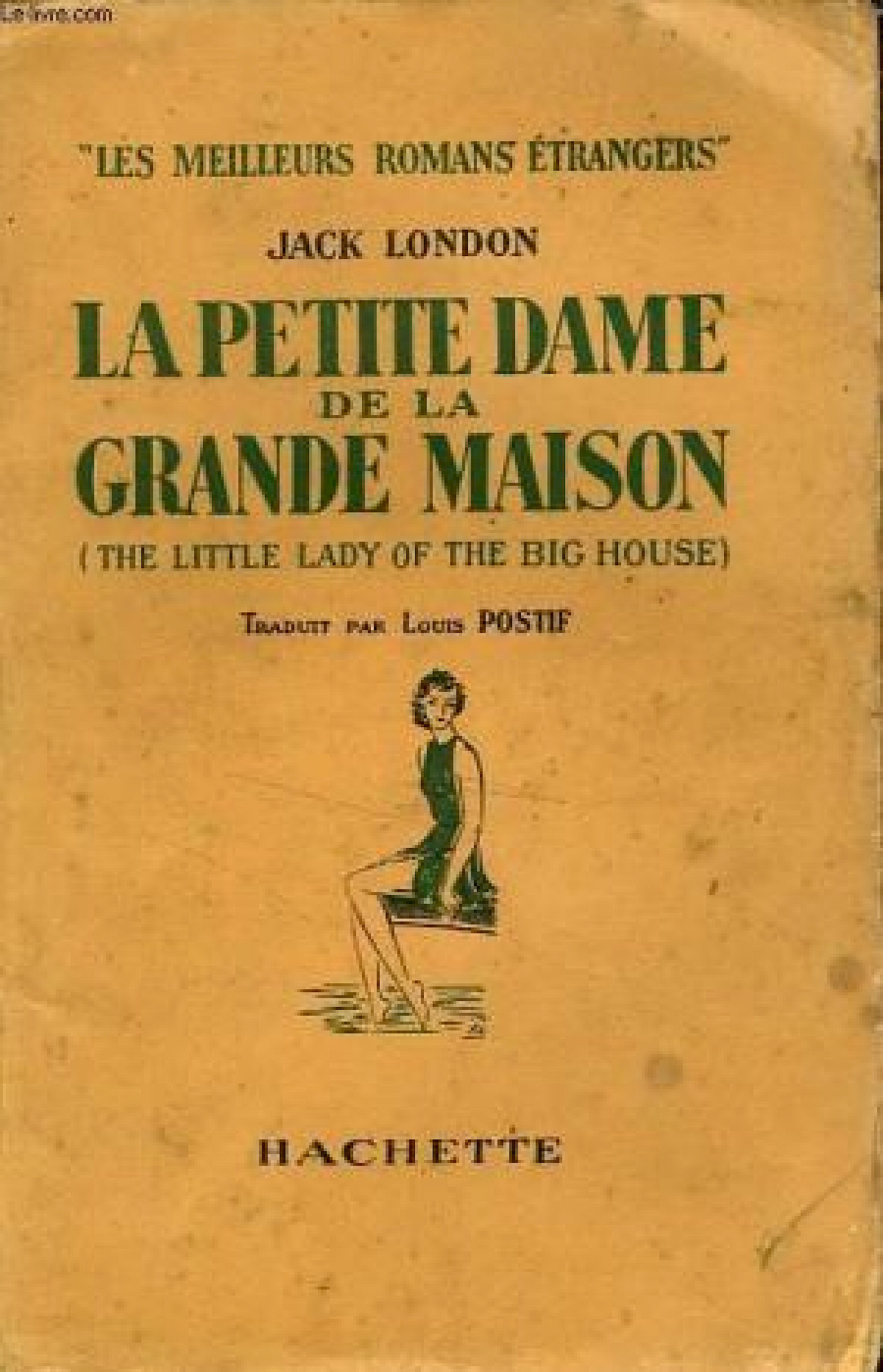
C’est pour cette raison que la Petite Dame dans la grande maison demeure une curiosité dans la bibliographie de London. Publié en 1916, c’est l’un de ses derniers textes importants et on le classe généralement dans la catégorie des romans polémiques. Son personnage central, Dick Forrest, est un riche héritier, brillant sans être un génie, qui administre avec beaucoup de succès des terres en Californie – il vit avec sa femme Paula, personnage d’une incroyable vitalité, battante et peu soucieuse des codes de l’épouse bourgeoise modèle.
London décrit l’exploitation de Forrest comme un petit pays, avec ses artisans et ses paysans, dirigés par un seigneur juste et compréhensif. Mais ce qui fait la réussite de Dick, ce sont surtout ses connaissances scientifiques et sa capacité d’inventer de nouvelles techniques agricoles ou de croiser de nouvelles races de chevaux. Le monde décrit par l’auteur est celui de la civilisation victorieuse, de la mainmise de l’être humain sur la nature.
L’histoire de la Petite Dame… commence vraiment quand débarque dans le petit monde des Forrest un ami de Dick, Graham. Il a joué comme lui aux aventuriers dans sa jeunesse et ses expériences tiennent presque du conte et de la légende – il s’est marié avec la reine d’une île du Pacifique après avoir miraculeusement survécu avec elle au naufrage d’un navire en pleine mer. Paula et lui tombent amoureux dans une atmosphère profondément ambiguë. Entre d’un côté la liberté de choix qui semble régner au sein du couple et, d’un autre côté, Dick qui dépérit et projette même de se suicider.
En son temps, le roman de London a été vu comme un manifeste féministe, parce qu’il présente une histoire d’amour extraconjugal et une femme particulièrement forte et libre dans la société américaine pudibonde du tout début du XX e siècle. Mais il résonne aujourd’hui de manière bien différente.
D’abord parce que la fascination de London pour la force l’amène irrémédiablement à défendre une vision virile de la société, où la femme se libère en devenant elle-même un symbole de virilité, de cette puissance à la fois physique et esthétique. Les multiples discours misogynes, présentés clairement au lecteur avec une ironie dramatique, n’empêchent pas les personnages de vouer un mépris à la faiblesse, notamment conçue comme un trait « féminin ».
Ensuite et surtout, parce que le récit de la Petite Dame… est une allégorie presque biblique des limites du contrôle qu’un homme, aussi intelligent soit-il, peut exercer sur la nature et les autres êtres humains. Dick se comporte certes de manière compréhensive avec « ses » travailleurs mais n’a aucun scrupule à envoyer à la mort des mineurs mexicains si cela peut sauver les mines qui ont fait la richesse de sa famille au départ. Il incarne une version progressiste de la déité – roi, inventeur, créateur de vie – qui est rendue possible par sa fortune.
Derrière sa philosophie de l’émancipation individuelle, philosophie qu’on peut même qualifier d’individualiste, basée encore une fois sur une conception virile et forte de la condition humaine, se cache un cynisme prédateur sans limites. Et, au fond, l’histoire du livre est celle de sa perte de contrôle sur l’amour de Paula, une chose qui lui paraissait tellement acquise qu’il ne pensait plus devoir se battre pour la défendre.
Son rêve de créer un monde nouveau, modelé avec la magie du progrès, s’effondre parce que, sans Paula, il n’a plus de but, de finalité ; rêver devient superflu. Et c’est peut-être à cause de cette ambivalence morale que l’ouvrage de London est en même temps un livre passionnant et un objet tellement ancré dans son époque qu’il peut difficilement participer à l’illumination de la nôtre. La liberté y est inscrite à l’opposé absolu de la politique, comme une confrontation violente de sentiments, hors du contrôle et du pouvoir des êtres humains. Rongée par la culpabilité d’aimer deux hommes à la fois, Paula portera seule, à la fin, les conséquences d’une histoire qu’elle n’avait pourtant ni désirée ni attendue, limitant considérablement la dimension subversive du livre.
C’est peut-être un des livres les plus nihilistes de Jack London (pourtant habitués aux fins sombres) : même cette férocité, ce culte de la force qui traverse tous ses écrits s’échoue ici sur l’impuissance de Dick, Paula et Graham. Ce n’est sans doute pas la meilleure porte pour entrer dans l’œuvre de London ( Martin Eden jouera parfaitement ce rôle) mais la Petite Dame dans la grande maison possède toutes les qualités de son auteur, le style, l’élan, la passion et tous les défauts de son époque – obsédée par le progrès, la puissance, la force.
On célébrait en novembre dernier les cent ans de la mort de Jack London et cet événement a été marqué, dans le monde francophone, par une effervescence éditoriale rare. Ses œuvres ont été éditées en Pléiade et un livre comme le Talon de fer a bénéficié de deux nouvelles éditions : la première Au temps des cerises , la seconde chez Libertalia dans une nouvelle traduction de Philippe Mortimer. Sinon, vous pouvez toujours vous tourner vers la maison « originelle » des amateurs de London, Phébus/Libretto , dont les ouvrages sont aussi très agréables à lire.