La littérature aux marges (1)

Karoo a le plaisir de présenter le premier épisode d’une chronique qui se veut une exploration mensuelle des marges de l’histoire littéraire. Un premier numéro consacré à Léon Werth, auteur de Clavel Soldat ou encore 33 jours .
L’écriture de l’histoire n’est pas neutre, elle est le produit d’une époque et des dominations qui règnent sur celle-ci. Il en va de même pour l’histoire de la littérature. Plus encore que le monde social, elle est soumise à des évaluations esthétiques difficilement objectivables et à des conflits de sensibilités aux frontières souvent mystérieuses. À la fin de ce processus sans véritable fin, au goutte à goutte du robinet de l’alambic, on recueille quelques noms, censés faire consensus et incarner leurs temps respectifs. Ainsi, pour les années qui nous intéressent, ceux de Proust, de Gide, de Breton, de Céline, et, plus tard, de Camus et de Sartre. Ces distinctions tamponnées ne sont, évidemment, pas dénuées de tout fondement ; mais elles donnent surtout l’impression que l’histoire de la littérature est un Olympe sur lequel seules quelques étoiles méritent de surplomber les Lettres et d’être enseignées au plus grand nombre.
On pourrait dire, à l’inverse, que c’est sur la masse des écrivaines1 plus ou moins anonymes, amies ou non des Grandes, que reposent le passé et l’avenir de la littérature. Leurs travaux, leurs tâtonnements, leurs critiques, leurs relectures, leurs oppositions ne forment-elles pas le socle qui soutient tout l’ensemble ? Que serait Camus sans Jean Grenier , qu’on ne lit pourtant guère plus aujourd’hui ? Cela vaut pour toutes les écrivaines de renom qu’on expurge trop souvent de leur contexte. Et que serait tous ces Noms sans leurs disciples fidèles et leurs exégètes infatigables ? Amatrices ou chercheuses, parfois les deux ensembles, ont plus à voir avec le succès posthume des œuvres qu’on ne veut bien l’admettre.
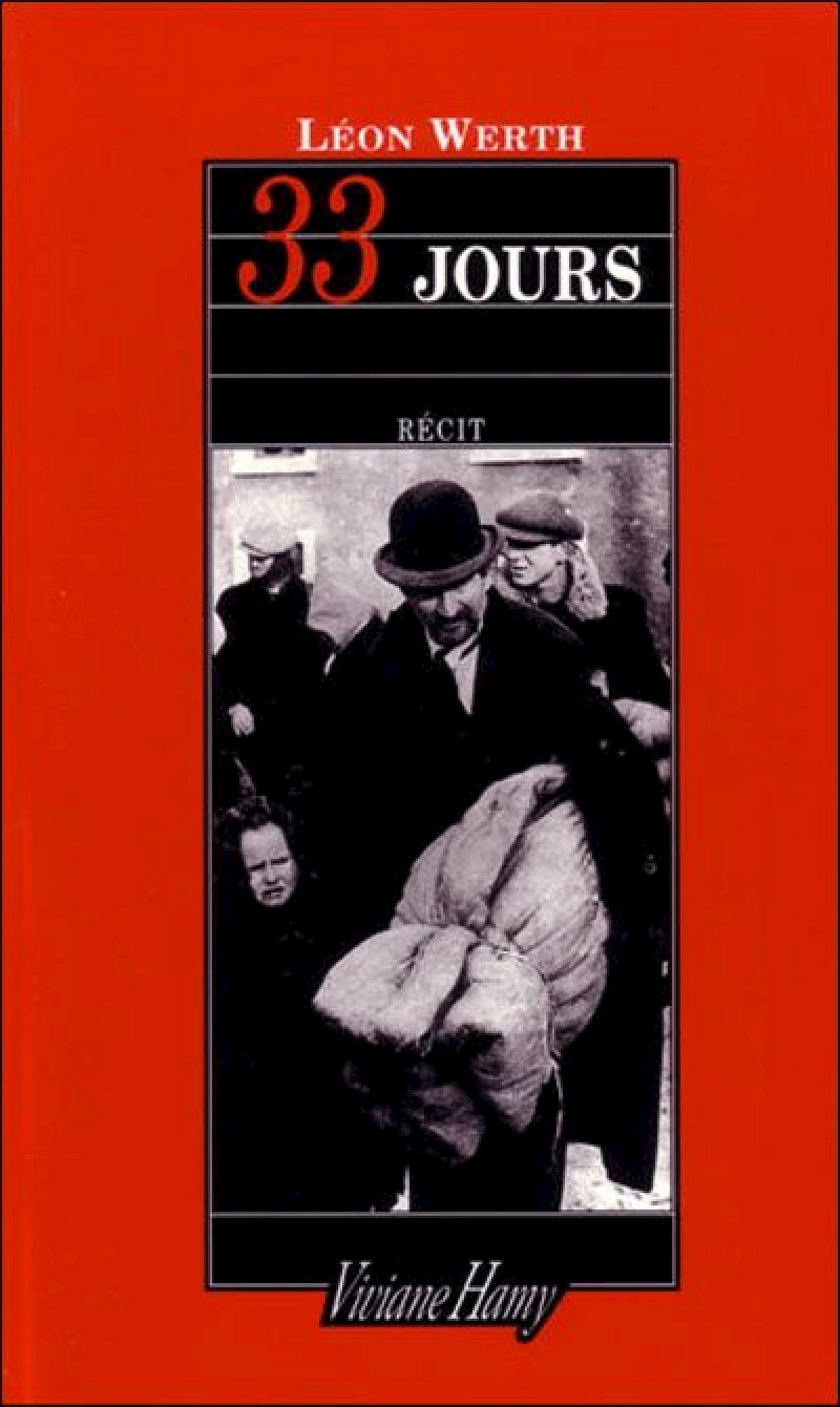
Il résulte de cette économie de la distinction littéraire toute une histoire des marges ou du grand fond de l’édition. Toutes les lectrices y puisent au moins un peu ; on ne peut pas vivre que de classiques, cela dessèche. Mais il n’empêche qu’à la culture des sommets et des sommités répond un autre culte, celui des perles rares, des trésors inconnus, des exceptionnelles oubliées – que chaque école critique ou chaque individue critique peut planter dans son jardin pour composer ses propres bouquets exotiques et un peu enlevés. À l’enseignement général et à l’inconscient collectif (cette chose étrange, façonnée par la somme de toutes les paroles publiques), on laisse l’Olympe-Épinal. À la culture populaire, on laisse la littérature populaire, les romances, les policiers, la science-fiction et puis quelques Balzac ou quelques Dumas, quand même, pour faire bonne mesure.
Voilà le plus grand paradoxe : la littérature des marges a toujours été nourrie par les marges de la société mais si peu lue par elles. Bon nombre de ces autrices étaient des ouvrières, des employées, des déclassées ou des bourgeoises en rupture. Certes, la vie de labeur offre de moins bonnes biographies que les études de château proustiennes, mais elle parle d’une expérience vécue bien plus représentative de leur époque. Aubervilliers de Léon Bonneff pouvait être compris, comme un partage et une reconnaissance d’expérience, par des millions de travailleuses (et bien plus si l’on compte ses lectrices à l’international) qui vivaient d’un labeur harassant ; alors qu’ À la recherche du temps perdu ne reflétait le quotidien que d’une haute bourgeoisie très restreinte. Pourtant, le premier a disparu dans les limbes avec toute la littérature prolétarienne alors que le second est entré au firmament.
Même les plus farouches esthètes « isolationnistes », partisanes de l’art pour l’art dans ses diverses modalités, reconnaissent à la littérature un devoir de pluralité, d’avoir à représenter le réel dans ses multitudes. La littérature des marges est précisément cet étalage de formes et de contours, cette vitrine réfléchissant trait pour trait la société, peu importe qu’elle la rende intacte ou déformée, réaliste ou idéelle, froidement ou romantiquement… Je voudrais, dans cette série d’articles, plonger dans ces marges et les offrir aux lectrices avides et curieuses. Insatisfaites, peut-être, du conformisme des histoires littéraires officielles et des classements artificiels des X meilleurs livres qui « font » la littérature. Et pour commencer dans cette entreprise, parlons de Léon Werth, écrivain de la première moitié du XX e siècle dont les combats littéraires sonnent encore aujourd’hui avec clarté.
Tumulte des débuts de siècles
Léon Werth (1878-1955) a connu la vie exemplaire des littérateurs de la fin du XIX e siècle. Né au sein d’une petite bourgeoise juive provinciale, il brille au lycée, monte sur Paris et abandonne pourtant ses études préparatoires pour se lancer dans le journalisme. Entre petits boulots et écriture, il fait son trou dans le monde artistique foisonnant de son époque, devient critique d’art et se rapproche des cercles socialistes et révolutionnaires. Son premier roman, La Maison blanche , manque le Goncourt de peu en 1913 (rappelons que le prix, à cette époque, est destiné à de jeunes écrivaines et a pour vocation explicite de leur permettre d’écrire en évitant la misère). Engagé lors de la Première Guerre mondiale, il survit aux tranchées et en revient anti-militariste fervent. De son expérience, il tire Clavel Soldat et assoit sa position dans le monde littéraire.
Suivront une grosse dizaine d’ouvrages, dont Cochinchine, charge violente contre le colonialisme français. Dans l’entre-deux-guerres, il participe à plusieurs projets journalistiques et politiques. Il s’engage notamment dans le groupe communiste « Clarté » d’ Henri Barbusse mais claque rapidement la porte quand ses opinions divergent trop de celles de la ligne des orthodoxes. Un scénario qui se reproduira pendant son passage à la revue communiste Monde quand il prendra la défense du communiste anti-stalinien Victor Serge condamné pour « trotskisme » en URSS. Grand ami d’ Octave Mirbeau qui le parraine au début de sa carrière puis d’Antoine de Saint-Exupéry qui lui dédicace Le Petit Prince , Werth termine sa vie après la Seconde Guerre mondiale et sombre peu à peu dans l’oubli.
Comme souvent, il en est sorti grâce au travail acharné et colossal d’une éditrice, Viviane Hamy, qui débute dans les années 1990 une réédition de ses œuvres connues mais aussi de plusieurs inédits. Cette redécouverte permet de rendre à Werth sa place dans le paysage intellectuel de son époque : celle d’un écrivain intransigeant, parfois rageur, et d’un incroyable portraitiste dressant des événements des tableaux lucides et sans concession. Exécrant les chapelles, il n’a pas bénéficié du culte mémoriel d’un Barbusse ou d’un Aragon que le mouvement communiste n’oublie pas et continue d’éditer. Celles qui lisent Werth aujourd’hui le découvre presque toujours sous la couverture rouge et caractéristique de Viviane Hamy, une couleur de circonstance.
En effet, Werth est sans doute l’un des derniers auteurs socialistes portant cette épithète avec toute l’ambiguïté et la largeur qu’elle pouvait avoir à la fin du XIX e siècle. Il pouvait ainsi se décrire lui-même comme « anar », écrire dans la revue anarcho-syndicaliste Révolution prolétarienne , prendre parti pour les politiques socialistes plus modérées d’avant-guerre, défendre et devenir l’ami du « trotskiste » Victor Serge ou encore dériver dans la galaxie des compagnonnes de route du Parti communiste français. Si la révolution sociale et la fondation d’une société socialiste le guideront toute sa vie (à l’exception peut-être des toutes dernières années lors de son rapprochement avec le gaullisme), il ne fixera jamais ses idées dans une doctrine. Werth fait peut-être partie de cette espèce dont on parle beaucoup sans presque jamais la voir, celle des libres penseurs.
Le portraitiste au couteau
Comment décrire le style de Werth ? Bien que ses influences soient très majoritairement celles du XIX e , son écriture est typiquement moderne. Elle cherche la clarté, ne s’embarrasse pas, tape sur la table. Ni sculpteur, ni élagueur de la langue, Werth écrivain est d’abord un portraitiste. Il croque la vie, les gens, les horreurs et les joies quotidiennes. Et parfois, il lui faut mordre. Son ironie non exempte de noirceur n’est pas sans rappeler celle de son ami et inspirateur, Mirbeau – mais elle est moins théâtrale, moins appuyée et plus fine dans le trait. Cela donne à tous ses personnages une vie surprenante. Leur figure, belle ou laide, trouve ses formes sous les yeux de la lectrice et l’acide est réservé aux puissants, souvent médiocres, ou aux égoïstes… mais même avec celles-là, Werth ne peut s’empêcher d’ajouter au vitriol une pointe de douceur, de toucher, même chez celles qu’il méprise, l’humanité et donc la reconnaissance.
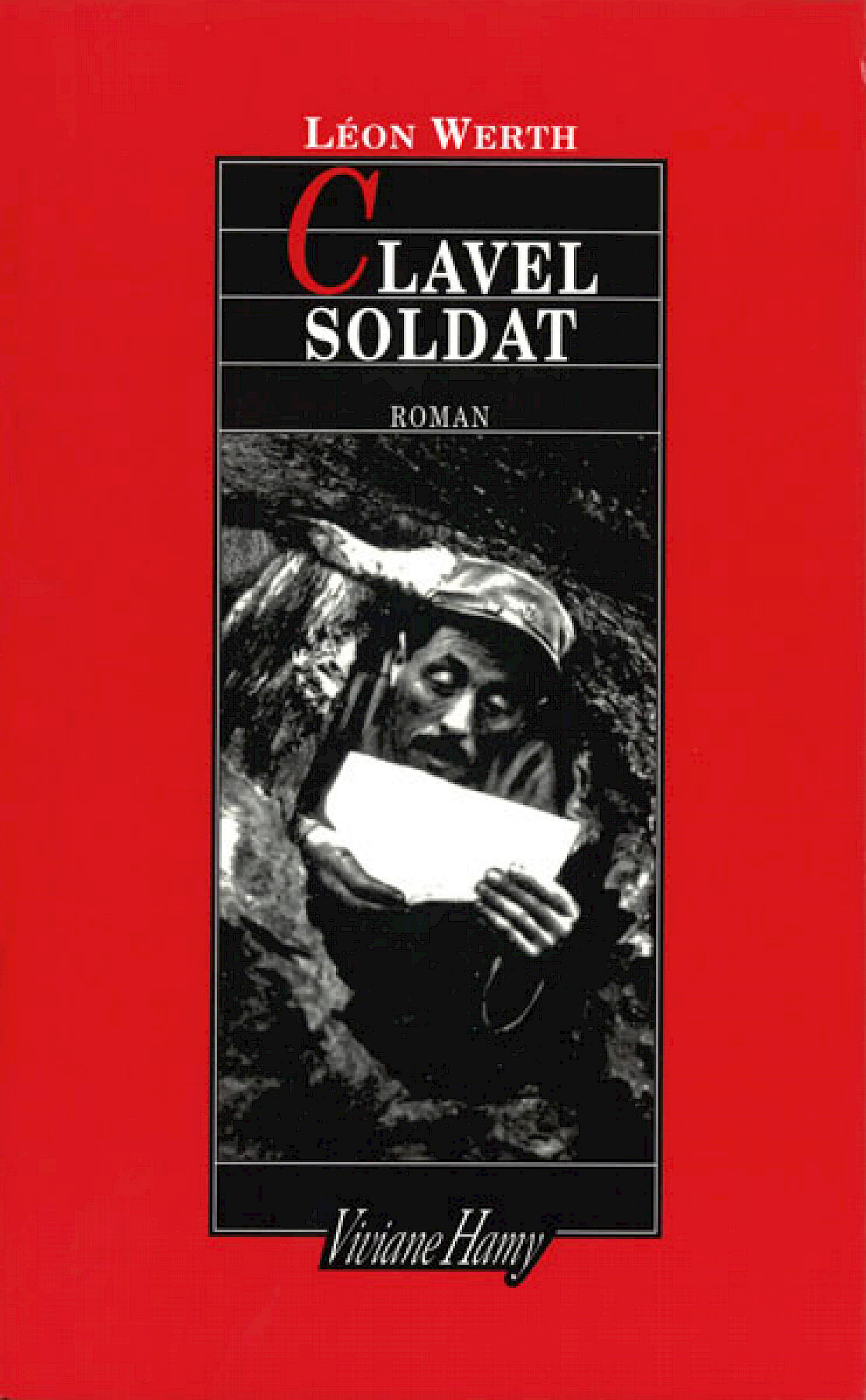
Werth est un romancier du récit. Il dit le monde, même quand il invente : il ne sait pas faire autre chose. Sa plume, toujours, revient au sillon de la réalité. Il ne prétend pas à un pur réalisme et se permet de donner des évènements une vision déformée par l’appréhension intérieure. On ne trouve pas chez lui d’aventure ou de palpitant, malgré le son des cœurs battants qu’il décrit au fond des tranchées. C’est peut-être l’un des éléments qui l’ont condamné, dans les années 1960, alors que l’écriture se devait tout à coup de se déconstruire et de devenir aérienne, à l’errance dans le désert des autrices perdues. Sa prose est accrochée au sol comme la mauvaise herbe, et même, elle pique ! Comme j’envie ses contemporaines ! D’avoir eu cet homme de lettres qui peint en écrivant et qui tranche pour peindre… De Mirbeau, Werth conservera le besoin presque maladif d’indépendance, de pouvoir se dédire et surtout dédire le récit général de la réalité, celui servi par les ministères et les tenants de la chaire.
Subversive, l’écriture de Werth l’est encore de nos jours. Qui peut écrire des livres anti-militaristes à succès et recevoir la couverture journalistique qu’elle mérite ? Qui peut élever un débat sur le néo-colonialisme et les impensés coloniaux de nos sociétés sans recevoir une volée de bois vert de la part des très importants, des honnêtes gens crachant sur les plateaux de télévision à longueur de journée ? L’art de Werth, qui n’est pas loin de la littérature prolétarienne sans en être tout à fait, qui fait penser dans ses éclats de sincérité parfois glacée aux essais de George Orwell, est un art indéboulonnable de sa dimension critique. C’est parce qu’il est une charge qu’il vit, qu’il crée son mouvement. Arrêtez la charge, parez-là des oripeaux du roman à thèse, et vous lui ôtez l’existence.
Si la littérature n’a pas pour vocation première ou unique à témoigner de son époque, c’est tout de même une exigence que les générations suivantes peuvent attendre d’elle. Les œuvres de Werth forment une immense fresque, en plusieurs morceaux, peintes sur plusieurs murs, pleines de détours et d’échos, décrivant la France du début du XX e et notamment tous les hauts faits que les hérauts de l’histoire nationale aiment oublier ou, pire, glorifier : la guerre de masse, le colonialisme, les ravages du capitalisme marchand, la culture de l’égoïsme et du chacune pour soi. Bretteur ironique, Werth ne claironne pour aucune école mais donne à l’égalité et à la liberté de belles phrases et de beaux mots. Parce que ces valeurs nous sont encore chères ‒ et surtout chères à défendre ! ‒ ces mots nous parlent. Ils chargent encore.