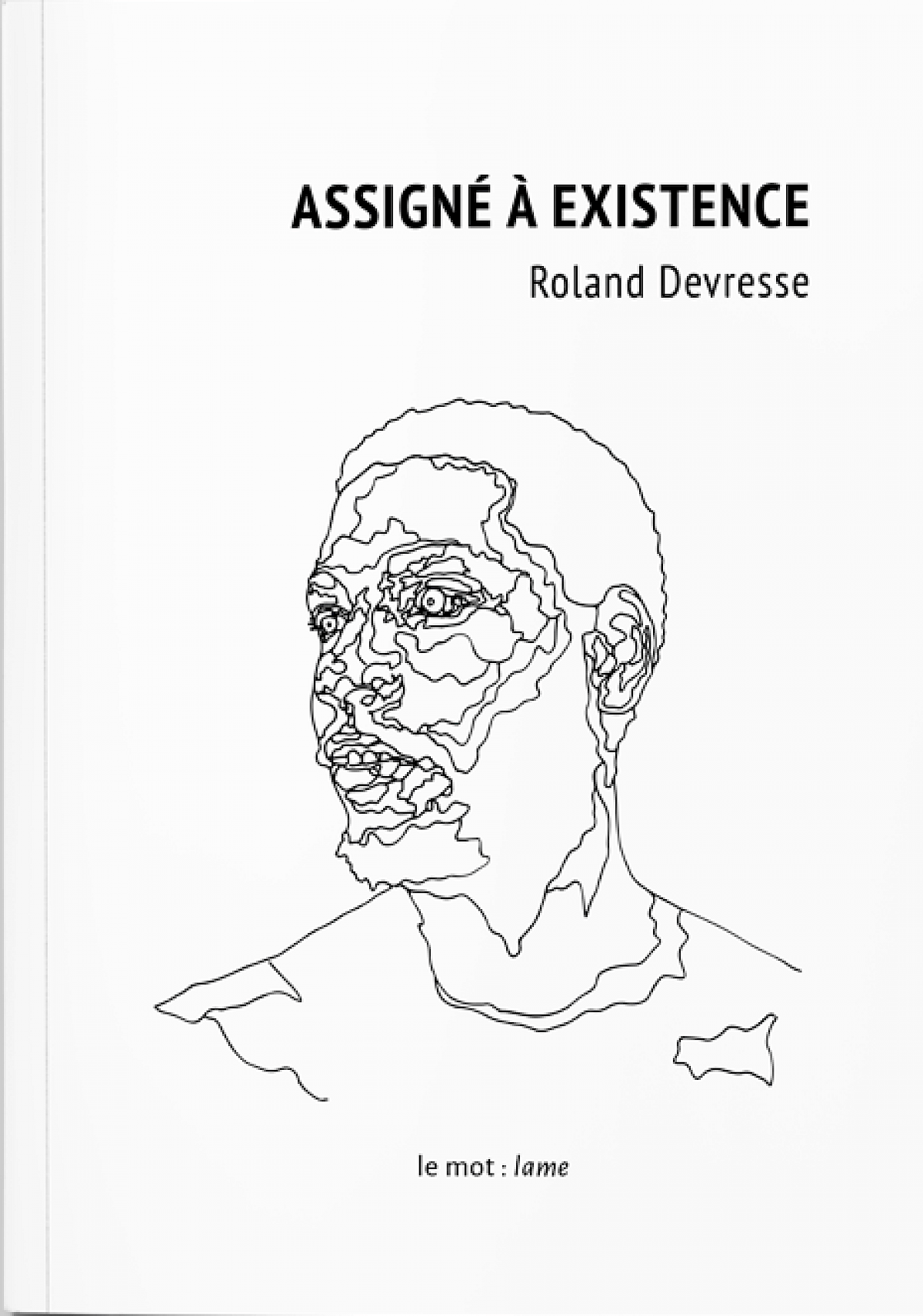
Karoo s’intéresse aujourd’hui au jeune poète Roland Devresse. Travaillé par la colère, face à une époque agressant ses sens, l’auteur nous livre une poésie ardente et à contre-courant des productions contemporaines.
La naissance d’un poète n’est jamais une mince affaire. Qu’elle se produise avec pertes et fracas ou dans le silence feutré des salons éditoriaux, elle annonce une nouvelle voix, une nouvelle manière de dire le monde et donc de le faire.
Roland Devresse signe son premier recueil, Assigné à existence , chez l’éditeur et collectif Le Mot : Lame 1 . Je dois vous prévenir : je connais Roland. J’ai frayé dans les mêmes milieux étudiants, vécu les mêmes soirées arrosées aux noirs des nuits citadines, assisté aux mêmes occupations squatteuses et libératrices. J’ai connu l’université-négatif, l’école des gauchistes et des révoltés, des individuels et des insurrectionnels, l’apprentissage par le fait et l’ ex cathedra en horreur.
Ses mots m’arrivent comme déjà connus ; ou plutôt, ils m’arrivent comme de vieilles connaissances. Je ne prétends pas les juger le cœur sec. Je ne saurais, d’ailleurs, pas comment faire. Sa poésie est bouillante. On ne peut pas rester indifférent face à elle. Elle écœurera, plaira, enragera, sera méprisée, adorée ou haïe – mais elle transpercera toujours l’indifférence du lecteur.
La première partie d’ Assigné à existence , suite de poèmes mêlant dénonciation du présent (« Bruxelles ») et référence à l’histoire (« L’historien ivre »), pose les bases : le poète est animé par une nostalgie féroce. Il assume clairement une forme de néoromantisme, mais son astre est noir comme l’encre et avide comme un égout. Ses images sont éculées, comme de vieilles bouteilles sans fond, ébréchées, qu’on aime et qu’on admire précisément du fait de leur l’usure ; conséquences du désamour qui les a condamnés au rebut.
Cette moitié est inégale et parfois maladroite. Elle a la puissance d’un certain vécu et son étrange classicisme, son ton déclamatoire, ses vers rimés, oscillant parfois autour du mètre, tranchent tellement avec la poésie contemporaine qu’ils en deviennent réjouissants. Elle parvient à n’être jamais surannée malgré son passéisme volontaire ; elle tient trop des souffrances du présent. Mais ses formes diverses (vers strophés, vers libres, proses, expérimentations) et ses répétitions symboliques affaiblissent parfois la force évocatrice des poèmes.
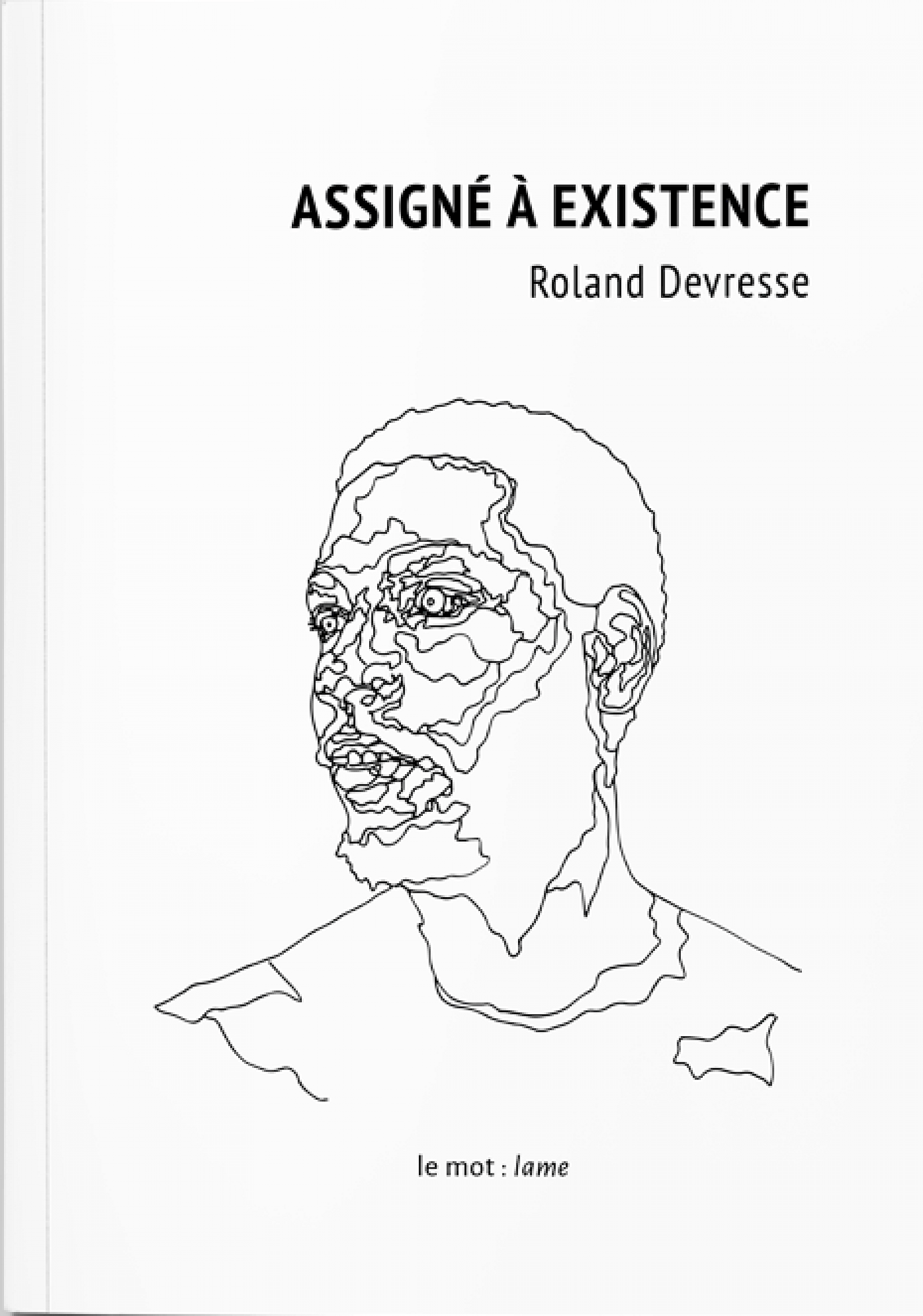
C’est dans la seconde partie que le recueil trouve sa cohérence et son rythme. Dans une longue poésie, « Je parle », le poète cesse de compartimenter ; il n’organise plus son verbe autour d’une idée ou d’une bulle mais dénonce, d’un seul trait, son temps et, pire, ceux qui le laissent vivre impunément. Roland Devresse n’invoque ni la justice ni la conscience. Il déboulonne la statue de la première et ébranle les fondations de la seconde.
Il interpelle directement le lecteur, coupable forcément. Il incite à la révolte comme peu osent le faire aujourd’hui – se mettant, comme il l’indique lui-même, en marge de la légalité. La réalité est si oppressante, si toxique qu’elle ne changera jamais grâce à la raison ou au compromis. Pour le poète, seules la poésie – pensée, germe, acte – et la révolte, dressées sur une barricade commune, pourront ébranler le monde et le renverser.
Cette poésie tranchante, ingrate, ne s’inscrit clairement pas dans les standards d’aujourd’hui. Ni aérienne ni aérée, elle est tellurique, volcanique, charbonneuse. Elle ne joue pas à cache-cache avec le sens, elle le proclame, le symbolise, le contextualise. A fortiori, elle n’est pas nichée entre les plis de la psychologie d’un individu particulier, elle veut parler de l’Histoire qui se fait, du social, du capitalisme, de la révolution. Elle assume entièrement sa dimension politique. Et, jusqu’aux limites offertes par la langue, elle embrase.
Je lisais récemment dans une chronique judiciaire, que les policiers jugeaient encore pertinent d’employer de nos jours le qualificatif « interlope » pour désigner leurs « clients ». Roland Devresse est un poète interlope et il en est fier. Non qu’il s’amuse seulement à défier l’autorité en écrivant, mais qu’il ne peut exister dans un monde inégalitaire, insatisfaisant, aliénant. Ceux qui vivent sous notre monde, ou à côté de lui, ou contre lui, ou dans les recoins cachés de la bruyère, ceux-là ont besoin de voix comme celle de Roland. Et nous avons besoin d’elles pour nous rappeler l’écart absolu qui sépare notre réalité de toutes les autres réalités possibles.