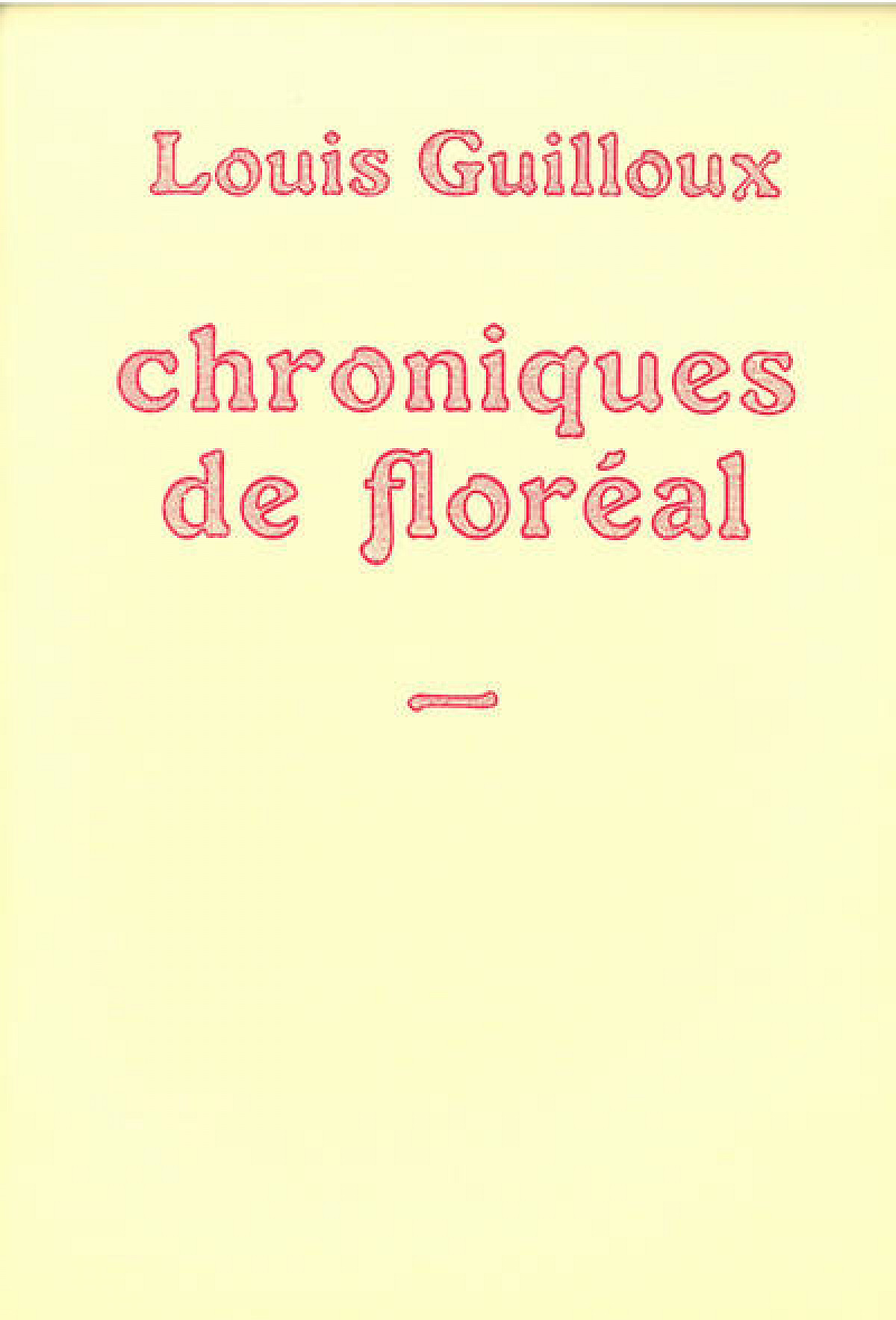
Au milieu du flot de livres publiés chaque année, il y a des perles de discrétion ; de petits trésors qu’il faut savoir dénicher… Les Chroniques de Floréal 1922-1923 de Louis Guilloux, récemment réédité par Héros-Limite, font partie de cette catégorie.
Rien n’est plus extraordinaire que le quotidien. C’est une leçon qu’ont professé de nombreux écrivains, condamnés à remplir leur assiette en écrivant pour les journaux des brèves, des chroniques, des articles traitant la banalité comme un objet littéraire. Le genre du récit quotidien, du « récit du temps », a été au cœur du travail journalistique des XIX e et XX e siècles ; sa tombée en désuétude est en fait toute récente. Elle nous prive d’ailleurs d’un regard unique sur la vie de tous les jours, sur les gestes accomplis mille fois ou les habitudes si ancrées dans nos routines qu’elles en deviennent insensibles.

À l’heure de la circulation circulaire de l’information et de la copie industrielle des dépêches d’agences de presse, c’est un plaisir de plonger dans le travail du tout jeune auteur Louis Guilloux. Sa carrière débute à peine ; il publie des nouvelles, des récits et des contes pour les journaux, traduit des écrivains anglophones comme Steinbeck ou Forester. Il entre dans la rédaction de Floréal en 1922, revue baptisée en l’honneur du mois de floréal, le deuxième du printemps dans le calendrier des révolutionnaires français. Le bien sous-titré Hebdomadaire illustré du monde du travail a pour vocation de transmettre aux classes laborieuses une information culturelle généraliste.
Guilloux y évoque un panel de sujets aussi disparates que curieux, des foires populaires aux théories d’Einstein en passant par les progrès du cinéma. Si ses observations n’ont pas le charme des déambulations poétiques de Léon-Paul Fargue ni l’attrait des ironies râpeuses d’Henri Calet, la force de Guilloux est sa verve, volontiers farceuse. Même s’il s’attache à réaliser le programme du journal – une culture accessible aux travailleurs, loin du canon élitiste de la grande presse –, il adopte souvent un ton informel, amusé et amusant. Cette ruse qu’on sent poindre entre les lignes vient comme prouver que l’activité alimentaire est détournée pour servir de terrain de jeu à l’écrivain. Certains articles ont forcément souffert du passage du temps mais d’autres se révèlent riches en plaisir et en pépites, parfois anecdotiques, parfois interpellantes.
Comme cette tentative de produire des films en relief, datant de 1922, relatée par Guilloux. Ne disposant pas de caméras capables de capturer des images en relief, c’est à la projection que l’ingéniosité de l’époque s’attelle. Sur une scène de théâtre, on dispose, à l’avant, un drap en étamine presque transparent sur lequel l’image vient prendre forme. Derrière, on construit des décors en disposant ces éléments sur plusieurs lignes dans l’espace. Vu depuis la salle, le spectateur a alors l’impression que les personnages, filmés sur un fond uni, se meuvent en trois dimensions. Des métrages entiers ont été pensés pour fonctionner avec cette illusion d’optique – il fallait en effet soumettre le scénario, la réalisation et les acteurs aux contraintes d’une projection dans un décor physique unique. Dans le même article, Guilloux parle également de l’évolution de la synchronisation entre le son et l’image – à l’aide d’appareils aux noms folkloriques, comme le ciné-pupitre et le bruisseur – et anticipe le cinéma parlant qui n’allait émerger que quelques années plus tard.
On apprendra aussi, dans ses Chroniques , que les coureurs du Tour de France se permettaient, à l’époque, de prendre un verre avec les spectateurs au milieu d’une épreuve… avant de repartir à toute allure ! Ou encore qu’un jeu prisé dans les foires des années 1920 était de faire tomber un œuf en « lévitation » sur un jet d’eau pour gagner des points ou des prix. Et même qu’il se trouvait à Paris, il y a fort longtemps, un bottier farceur, nommé Nique, qui inscrivit sur son enseigne : « Aux amateurs de bottes à Nique ». Les mauvaises blagues n’ont pas d’âge ! Guilloux, comme beaucoup d’autres socialistes de son époque, est aussi traversé par une fascination pour la modernité technique, en particulier les évolutions en aéronautique. Ses articles sur les aérodromes et autres temples du progrès semblent aujourd’hui bien trop optimistes sur la capacité de l’innovation à révolutionner positivement la vie humaine.
Le travail des éditions Héros-Limite est comme toujours de premier ordre. La sobriété de la couverture – on ne parle pas assez des couvertures – met d’autant plus en valeur la qualité de la typographie. Surtout, l’éditeur suisse rend un grand service en faisant vivre les écrits d’un écrivain français éclipsé, comme beaucoup d’autres, par les « astres » du XX e siècle. Derrière Camus, Sartre, Gide, Malraux et quelques autres, se cachent des dizaines d’auteurs mésestimés. Louis Guilloux fait partie de ceux là. Il faut relire la Maison du Peuple , le Sang noir et donc les Chroniques de Floréal . Cette littérature n’a des confins que le nom ; elle est la moelle de son époque.