Deux récits de Joseph Andras
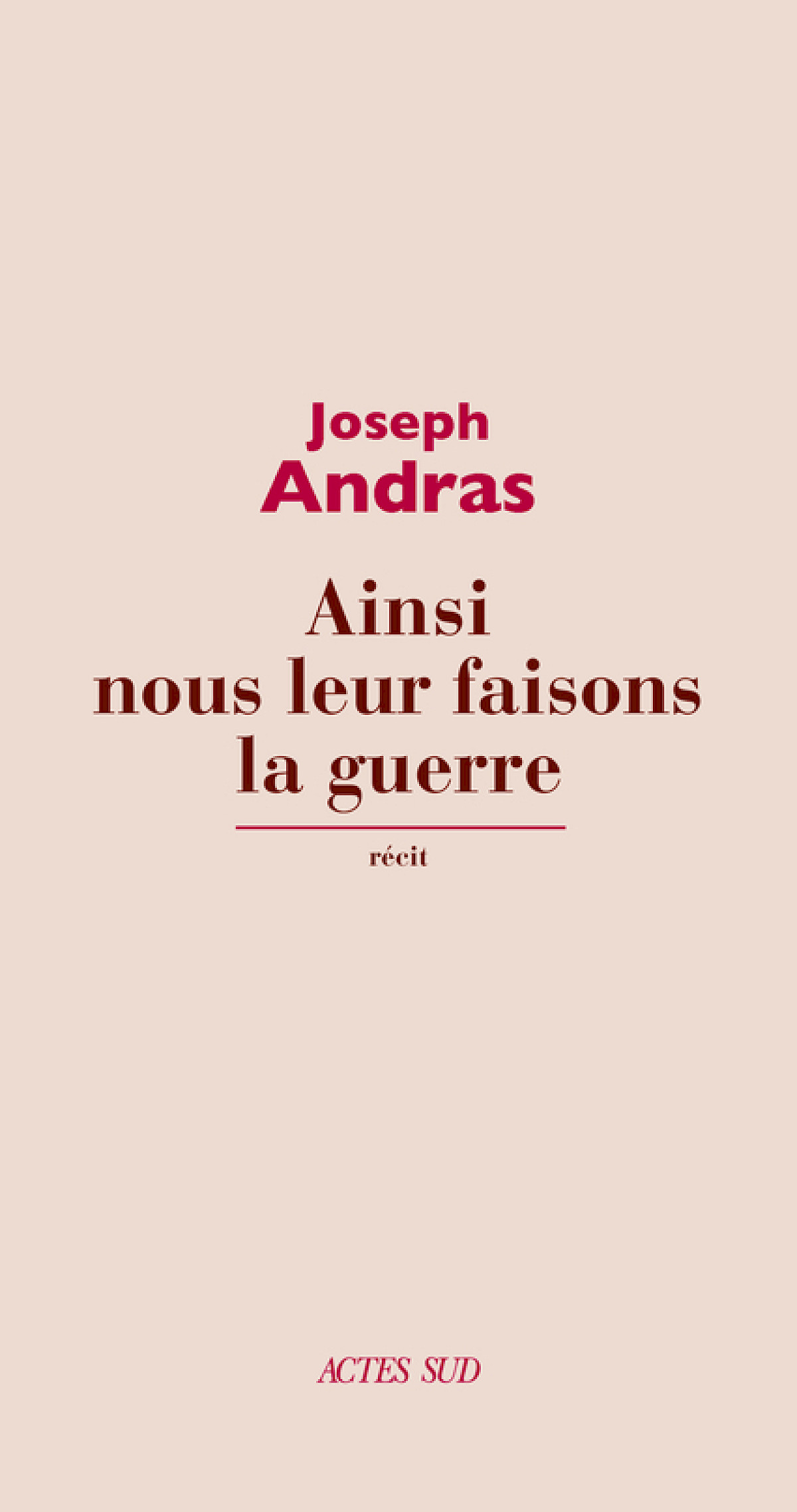
Karoo revient sur la publication de deux récits de l’écrivain Joseph Andras, Au loin le ciel du Sud et Ainsi nous leur faisons la guerre , tous les deux parus l’an dernier chez Actes Sud.
« Il n’y a que dans les dictionnaires que les termes soient intacts. À l’air libre, ils ont tous du noir sous les ongles. » Voilà qui peut résumer l’approche de Joseph Andras : une littérature à l’air libre, au service d’une égalité à conquérir, quitte à en avoir les mains sales. Il la pratique à travers ses sujets, l’histoire ouvrière, révolutionnaire, celle des révoltées* souvent écrasées, jusque dans leur mémoire, sous la botte d’une histoire officielle et dominante. Il la déroule dans ses formes, toujours sur le fil de la poésie en prose, mais une poésie hérissée, polémique… profondément politique. De là à dire que Joseph Andras est un écrivain révolutionnaire, il n’y a qu’un pas, qu’on franchira gaîment ! Autrefois, on aurait pu dire engagé mais ce titre est devenu un label, une médaille accrochée à trop de poitrines triomphantes et aux ordres de la raison du monde.
Entre quelques chroniques dans L’Humanité , Andras nous a offert l’an dernier deux récits, publiés chez Actes Sud, et qui n’ont pas autant bouleversé l’intelligentsia littéraire que ses ouvrages précédents, De nos frères blessés et Kanaky . Ces deux petits livres sont pourtant d’une folle richesse, cherchant dans des directions opposées à mettre au jour les fondations de la souffrance et du combat incessant qui veut la faire cesser. Souffrance de la colonisation et de la domination de l’humain sur l’humain pour Au loin le ciel du Sud ; souffrance de la condition animale et notre domination sur le non-humain pour Ainsi nous leur faisons la guerre . Il tisse ainsi l’histoire des luttes, non la grande Histoire qui simplifie tout, qui mollit dans sa cohérence forcée, mais celle des ponts qu’on jette éperdue et des culs-de-sac libérateurs.
Au loin le ciel du Sud ou le dédale de la mémoire
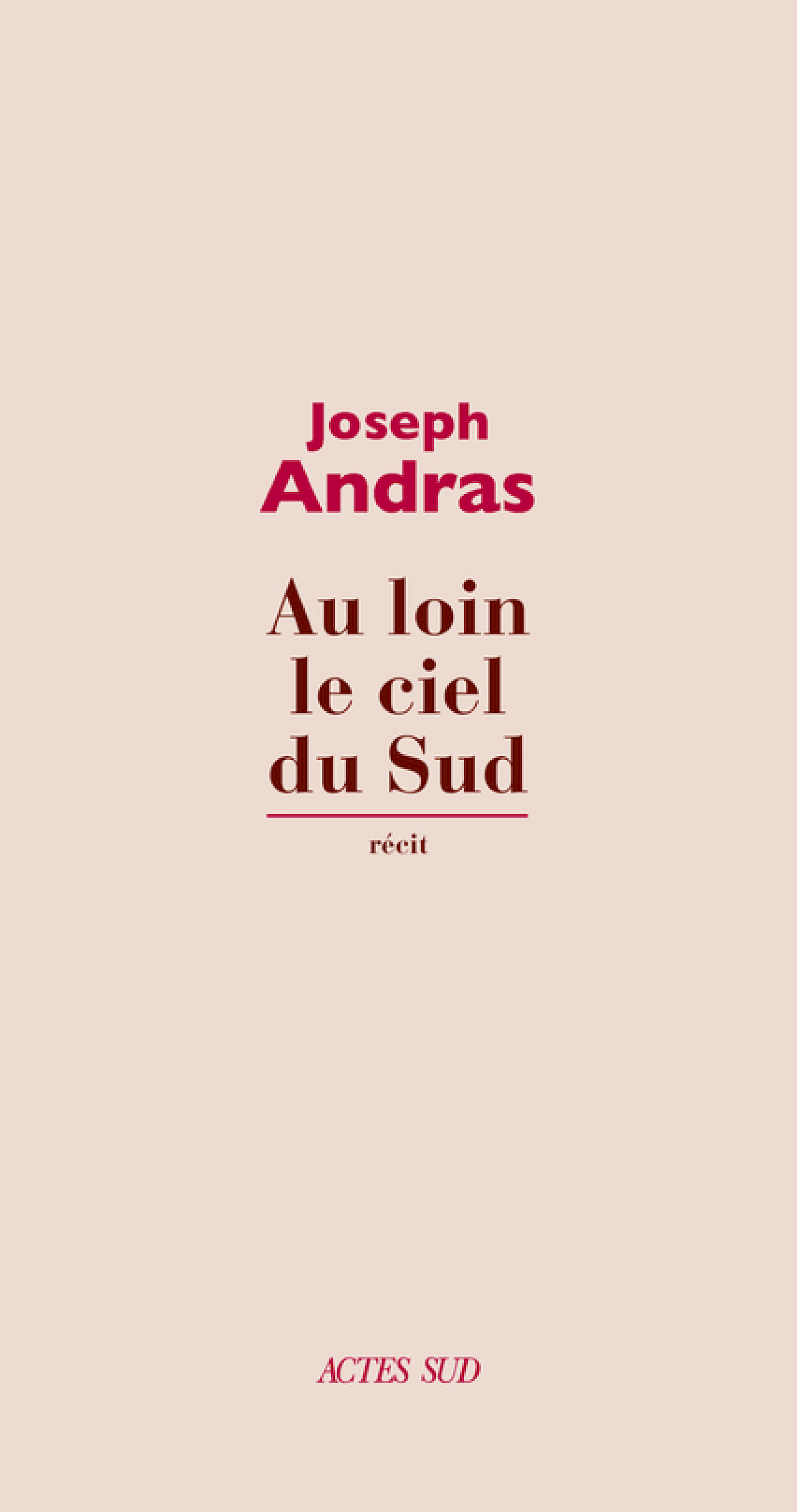
C’est sur les traces d’Hô Chi Minh que se lance Andras, traces parfois minuscules, certaines diraient anecdotiques, à côté la lourdeur écrasante de « l’icône » de la guerre du Viêt Nam et du Parti communiste vietnamien. Non, l’écrivain s’intéresse bien au début, quand la suite était encore incertaine, non-écrite. Hô Chi Minh donc, qui a d’abord été Nguyên Tât Thanh, s’installe à Paris à la fin de la Première Guerre mondiale. Comme beaucoup d’autres, il espère que des occasions vont s’ouvrir et que les peuples colonisés vont pouvoir se libérer du joug des puissances européennes en profitant des bouleversements mondiaux. Les espoirs seront vite douchés, mais pas les luttes qui fleuriront.
Andras suit la trajectoire de ce jeune homme, dans les milieux anti-colonialistes français et étranger, de ses contacts avec les communistes et autres révolutionnaires, de sa radicalisation – forcément quand le fusil répond aux pétitions ! Parfois, il perd sa piste, imagine, propose. Seulement, c’est surtout le fond du tableau qui importe : comment la révolution se pense, se vit alors ; et maintenant, comment ces traces, ces mémoires de pierre ou de papier font terreau, inspirent ou s’enfoncent dans la poussière. Le narrateur suit à un siècle de distance un itinéraire, à la fois géographique et politique, et scrute la réalité en se demandant : quelle usure ces va-et-vient nous ont-ils laissés ?
Rien, dans le sac des siècles que tu traînes avec toi, ne te désole plus que l'échafaud de Desmoulins ratifié par celui-là même qui fut témoin à son mariage, que la Commune se déchirant entre comité et minorité lorsque Versailles orchestrait le blocus de la capitale, que Barcelone comptant en mai les cadavres de ses fils insurgés quand le fascisme gueulait haut à ses portes, que Jeanson donnant du "belle âme" à Camus et ce dernier du "Monsieur le directeur" à l'ami de Sartre. "Un rebelle est un rebelle", disait à raison le poète – pour mieux l'oublier avec Nizan. Tu sais, bien sûr, que les clairs obscures ne font pas corps, que l'ennemi n'a jamais suffi à serrer les rangs, que sourire aux slogans reste un art de coquet. Tu n'en crois pas moins qu'il convient d'écouter l'allié jusqu'à l'aube sitôt que l'ogre appointe ses crocs ; que la désunion est un luxe auquel la Terre n'a pas encore droit ; qu'il faut chercher dans le jour ce que la nuit nous dit et dans la nuit ce que le jour dévoile.
Un prétexte, l’histoire d’Hô Chi Minh ? Oui et non. Andras questionne la fidélité de son héritage, celui du communisme ; lourd héritage, avec trop de recoins sombres. Sa curiosité imprègne ses lignes sincèrement, sans fascination ou dogmatisme. Pourquoi une étoile plutôt qu’une autre ? Peu importe, s’il peut parler de toute la constellation. Et c’est bien ce qui fonde le socle de son récit : comment s’articule-t-elle cette étrange figure de la révolte ? Celle qu’on découvre dans les vieux livres, qu’on se raconte dans les familles, celle dont on rêve, qu’on envie, qu’on enterre joyeusement ou qu’on ignore ? Pas de réponse facile, mais une évidence, une force : la révolte pour que « gueule au cœur du prisonnier tout l’arbitraire de l’ici-bas ».
Ainsi nous leur faisons la guerre ou l’humanité qui s’anéantit
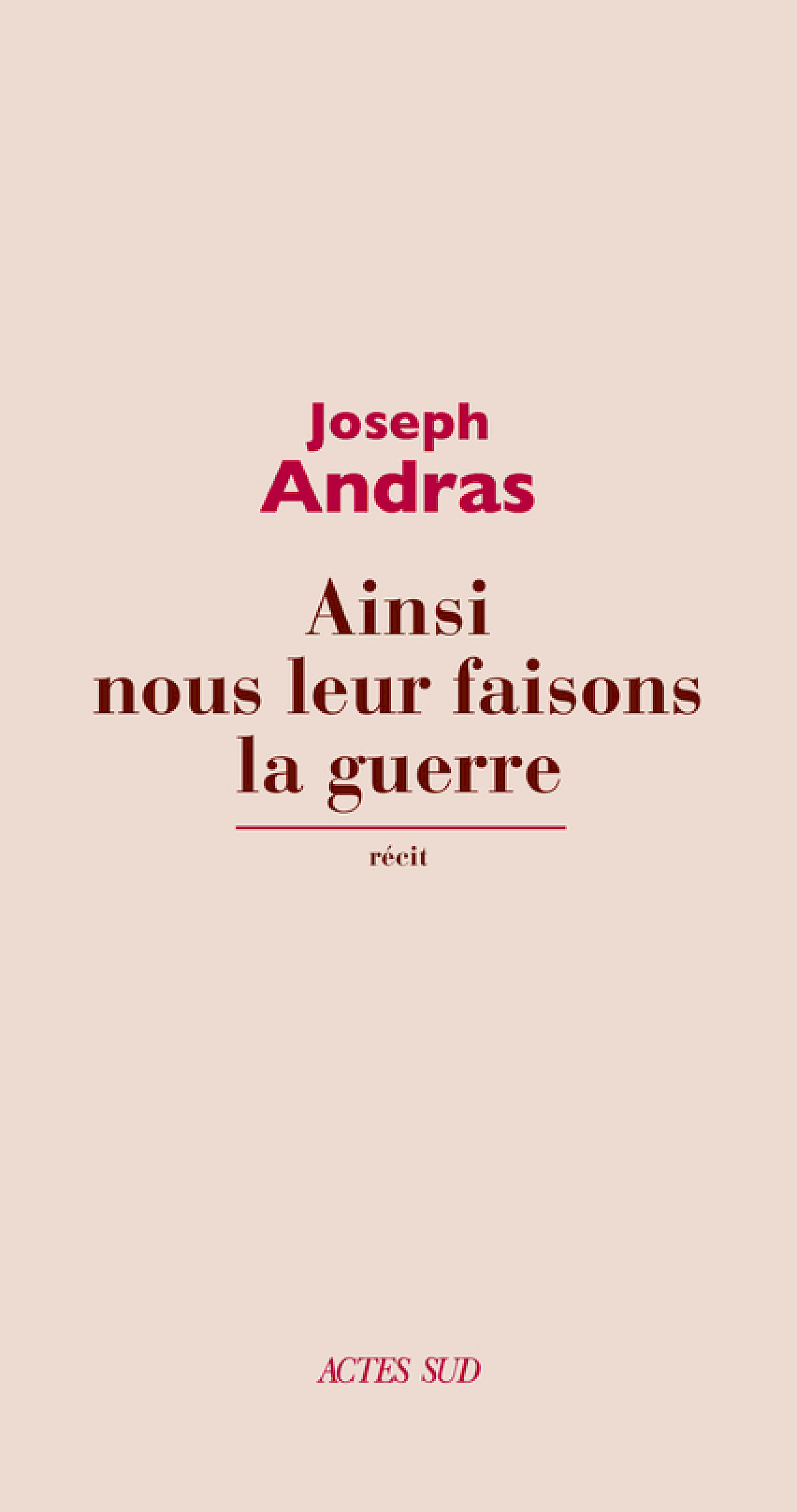
Un récit en trois parties édifiantes : celle de la vivisection d’un chien à Londres en 1903, d’une opération de sauvetage d’animaux-cobayes aux États-Unis en 1985 et l’évasion d’une vache, en France, qui est exécutée par un peloton de policiers en 2014. Une leçon : la souffrance que nous infligeons aux êtres sentientes (douées de sensation, d’une certaine conscience de soi) est une souffrance que nous nous infligeons aussi à nous-mêmes ; c’est une école de la violence, un apprentissage de la hiérarchie et des inégalités. Ici Andras se place à la suite de nombreuses autrices révolutionnaires, comme Louise Michel et Élisée Reclus, qui chacune à leur manière dénonçait cette guerre que nous menons au vivant et ses liens avec l’exploitation. Très tôt, elles seront nombreuses à faire le lien entre un militantisme végétarien ou végétalien et la pratique révolutionnaire.
Dans l’histoire inaugurale, le destin d’un chien devient celle des prolétaires et des femmes, parce qu’un « chien ce n’est certes pas un ouvrier, ce n’est certes pas la classe unie qui abattra la loi de l’or, mais un chien, ça ne se massacre pas ». À travers la mobilisation pour le chien, ce sont les origines du mouvement ouvrier, de sa diversité, de sa capacité d’empathie, qui sont narrées par l’auteur. Il montre comment la douleur fédère, même celles des autres – encore plus celles des autres ? Il dresse une contre-histoire, certes, mais plus fondamentalement, un contre-mythe anthropologique, sur l’origine de l’organisation sociale et de l’élan d’égalité qui renaît toujours, sous une forme ou une autre.
Il s'agit là d'une longue histoire. Le chien était un loup, et nul ne riait des loups. Il fallait en ce temps fortifier les liens et dresser les huttes, alors l'espèce articula son langage. Et puis il fallut cuire les aliments, tenir au loin les créatures féroces et étirer le jour, alors l'espèce dompta le feu. Il fallut faire entendre la loi, les hauts faits et les chiffres des cités florissantes, alors l'espèce trouva l'écriture. Il fallut percer la chair de l'ennemi avec plus de vigueur encore, alors l'espèce construisit le canon. Et quand l'espèce eut tout ça, les mots bien positionnés dans le larynx, le feu apprivoisé dans le foyer, les phrases soigneusement troussées sur les parchemins en peaux et les crânes importuns perforés au lointain, l'espèce ne cacha pas sa fierté. Pourtant, elle n'allait pas tarder à réaliser que quelque chose clochait : pourquoi le seigneur ne voit-il pas qu'il n'a que deux poumons, deux reins, deux yeux et deux oreilles tout ainsi que le serf ? Un peu partout sur la Terre, l'espèce tourna autour de la question. Alors, certains d'entre nous firent les cent pas, et puis ce fut un jour le dernier. Un pas peut-être plus important que le feu même. Ils dirent un mot, car il fallait bien en choisir un et qu'ils savaient les dire et les écrire depuis longtemps maintenant, les mots, et celui-là fut socialisme. Ils ne savaient pas que ce mot s'en irait sur tous les continents et soulèverait les humains tant et tant. Bien sûr, le mot serait discuté par ses partisans mêmes et les plus érudits d'entre eux feraient de nouveau les cent pas. Mais là n'était plus l'essentiel car l'espèce disposait enfin d'un mot capable de retourner le monde : tout le sang des siècles, celui des dieux, des guerres, des palais, des races, des drapeaux, des comptoirs, des usines, des mines et des maisons closes, c'est à jamais qu'il saurait l'endiguer.
Romantisme ? Héroïsation du socialisme, entendu comme le mouvement de l’égalité ? Peut-être. Mais la littérature n’héroïse-t-elle pas depuis toujours mille et une valeurs, mille et un sentiments ? En quoi l’amour serait-il moins grandiose quand il appelle à la table rase ? À une société des égales ? Andras écrit dans un temps où sa présence semble immédiatement suspecte, parce qu’il remet en cause les fondations de l’ordre, son histoire, sa représentation du monde, même et surtout, sa manière de faire des phrases et de couvrir sa réalité derrière des constructions imaginaires. Pour cette raison précise, son travail est essentiel. Comme à chaque fois, nous attendrons, patiemment mais avec une envie certaine, d’être hanté de nouveau par la mauvaise conscience des choses, que fait si bien parler Joseph Andras.