Et dans la jungle,

Pour Karoo, Thibault Scohier
Pour Karoo, Thibault Scohier
part à la découverte
de la sélection 2016-2017
du prix des Lycéens de littérature :
voici Et dans la jungle,
Dieu dansait d’Alain Lallemand.
Théo est un jeune anarchiste belge. L’Europe le désole et bride son envie de bâtir un monde neuf
— « du passé faisons table rase », comme disait Pottier. Il décide, après un petit attentat à la bombe qui jette la police à ses trousses, de traverser l’Atlantique pour se battre avec les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie). Sa route croise alors celle d’Angela, belle jeune femme, ancienne compagne d’un guérillero et rédactrice d’un blog radical soutenant la révolution. Le lecteur suivra, tout au long d’
Et dans la jungle, Dieu dansait, leur périple à travers le maquis colombien, leur rencontre avec les révolutionnaires, leurs combats et leurs défaites.
Parce qu’au-delà de son parti pris, de l’aventure dépaysante, il prétend porter un message politique sur la jeunesse européenne désillusionnée du XXI e siècle (cette volonté est explicitement revendiquée par l’auteur sur son site internet). Et c’est là que le bât blesse. L’ouvrage d’Alain Lallemand est confus, notamment sur son imagerie politique, et tellement didactique que toute la potentielle humanité de ses personnages disparaît derrière le mode d’expression artificiel de leurs sentiments. Prenons les choses dans l’ordre…
Théo, le personnage principal, est un anarchiste. Il connaît les milieux anarchistes belges et, au moins, berlinois. Il a lu de nombreux écrivains classiques (Malraux, Faulkner, etc.) et a une connaissance suffisante de l’histoire révolutionnaire, notamment de la révolution espagnole. Et pourtant, il part se battre avec les FARC, une guérilla marxiste-léniniste, qui n’a jamais fait rêver les libertaires européens. Chaque fois qu’ils l’ont pu, les communistes ont éradiqué les anarchistes et ces massacres — à Kronstadt et en Ukraine à la suite de la révolution russe, à Barcelone au milieu de la guerre d’Espagne — sont inscrits en lettres de sang dans la tradition libertaire. Aucun anarchiste, même dans l’optique de rejoindre une révolution armée, ne prendrait la décision de partir en Colombie plutôt qu’au Chiapas ou même en Palestine. Surtout, et c’est sans doute le plus incompréhensible, Et dans la jungle, Dieu dansait a été publié en janvier 2016. Admettons donc qu’il ait été écrit en 2015. Pourquoi, alors, Théo ne part-il pas se battre au Kurdistan ?
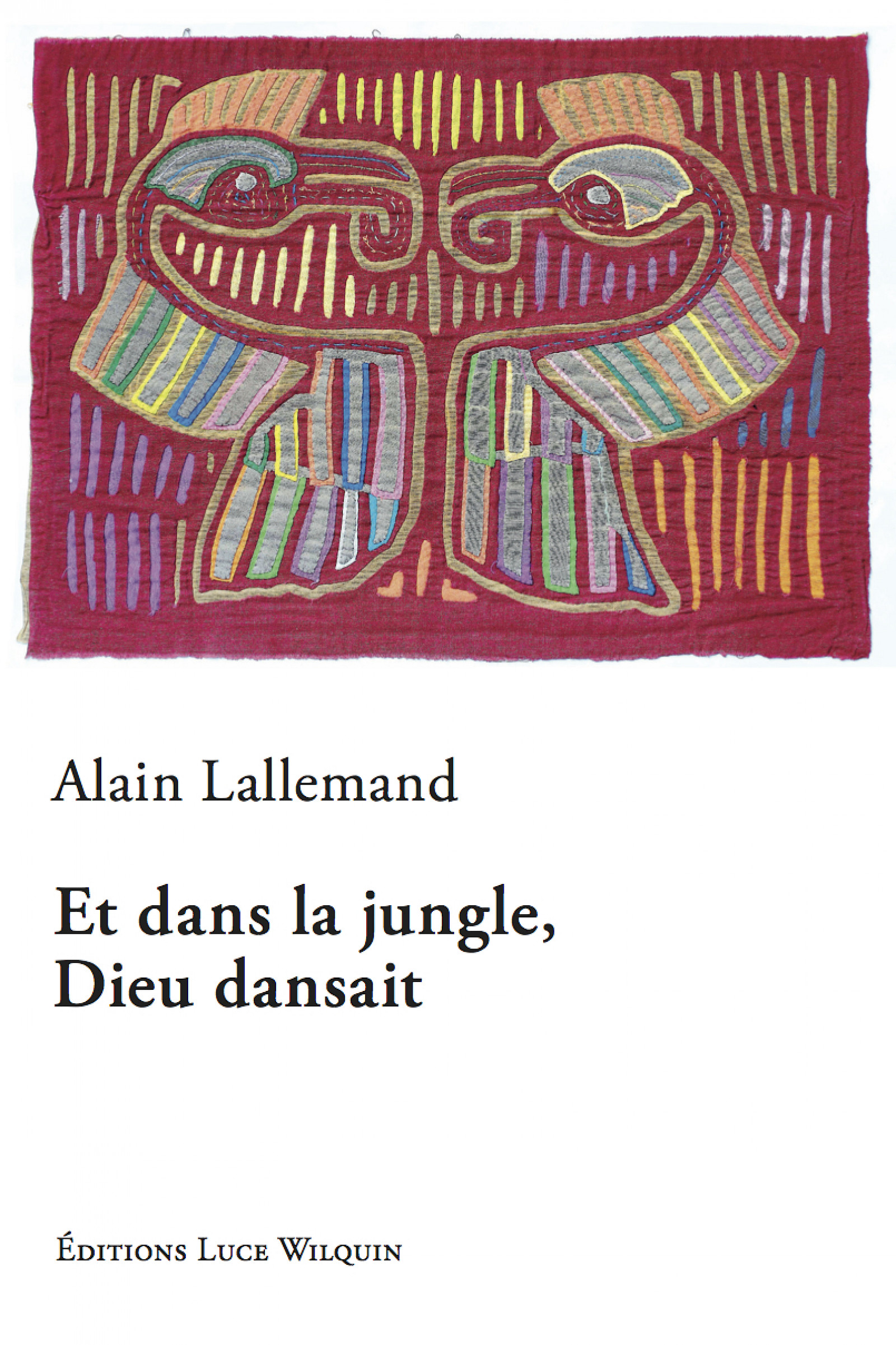
Depuis 2014, les organisations anarchistes européennes soutiennent ostensiblement le PYD (Parti de l’union démocratique), parti révolutionnaire des Kurdes syriens qui prétend instaurer une société autogestionnaire, égalitaire et libre dans le Rojava, le territoire des Kurdes de Syrie. Des dizaines de volontaires internationaux (leur nombre exact n’est pas connu) sont déjà partis se battre à leurs côtés contre Daesch ; le 19 septembre, le PYD annonçait que trois Américains étaient morts au combat dans ses rangs. Si Théo, ou n’importe quel anarchiste, avait voulu rejoindre une révolte armée, il se serait naturellement tourné vers le Kurdistan.
En plus de ce choix initial, qui déforce sensiblement la portée du livre, Théo fait souvent des « impairs » inexplicables. La couleur de l’anarchie est le noir et il le sait – quand lui remet son uniforme de guérillero, il note qu’au moins « le béret est noir ». Mais, quelques dizaines de page plus tôt, lorsqu’il aperçoit une étoile rouge au-dessus d’un Christ, il s’étonne ironiquement (je paraphrase) : « Je ne j’aurais jamais cru que le Christ était un anarchiste ! ». Sauf que l’étoile rouge, c’est l’étoile du marxisme ou du communisme. Une étoile noire (symbole rarissime à ma connaissance) serait plus correcte, une étoile rouge et noire (signifiant « communisme libertaire ») au minimum ! Autre incohérence, Théo est censé être un anticlérical convaincu – ce stéréotype est à l’inverse beaucoup plus crédible puisqu’il vient des milieux radicaux wallons – mais le narrateur lui fait penser son voyage en termes de : « foi et de croisade ».
Cet élément, le religieux, constitue sans doute l’un des ratés principaux du livre, parce qu’il n’est pas assumé jusqu’au bout par l’auteur. Ce qu’Alain Lallemand essaye de nous faire comprendre, c’est que Théo, lui l’athée, lui l’anarchiste, est tout aussi « croyant » que tous les autres personnages du livre et même, chose relativement absurde, qu’il incarne une allégorie de la figure christique souffrant du poids des fautes humaines. L’auteur nous le murmure en structurant son récit autour de citations de la Genèse et avec une scène de rêve où Théo, qui s’appelle d’ailleurs Toussaint, lévite, les bras en croix, en contemplant la création de Dieu, nommé explicitement dans sa psyché. La fin confirme également cette lecture : renonçant à la violence, il ira aider les pauvres dans les favelas brésiliennes.
Pourquoi cette ligne de force ne fonctionne pas ? Parce que Théo, a aucun moment, n’exprime un vrai dilemme existentiel, un vrai sentiment de foi ou même une interrogation sur l’existence de Dieu ou de règles extra-sociales qui, par exemple, sanctionneraient le meurtre. Certes, il a commis un attentat à la bombe ayant entraîné accidentellement la mort d’un ouvrier (un vrai, avec une salopette bleue, s’il vous plaît) et, bien sûr, cela le hante. Mais pourquoi l’avoir fait tuer un ouvrier, un représentant de cette classe prolétarienne pour laquelle il se bat, alors que le meurtre d’un patron ou d’un cadre, le hantant avec autant de force, aurait été l’occasion d’un vrai bouleversement existentiel : tuer, même une personne qui domine et asservit, est-ce justifié ? « Pourquoi est-ce que je ressens de la honte alors que j’ai délivré la terre d’un oppresseur ? » Cette question, il ne peut se la poser correctement avec les FARC parce que, comme lui dit (mais l’oublie très vite) Angela, ce n’est pas sa guerre.
Le déchirement de la Colombie ne se fait pas au nom d’un idéal de société universel, comme s’était plus le cas dans l’Espagne de 1936, mais bien pour des intérêts locaux, réels et parfois décevants pour un occidental. Ainsi le contrôle du territoire, des ressources et donc de la drogue, joue un rôle central dans le processus de la guerre civile colombienne. Et d’ailleurs, la présentation de la Colombie et de sa complexité forment sans doute les meilleures performances du livre – la description de la jungle, bruissante de vie, parvient effectivement à faire voyager le lecteur.
Si aucun des personnages de Lallemand ne montre jamais une vraie profondeur c’est aussi à cause des dialogues. Ceux-ci sont presque uniquement didactiques, c’est-à-dire construit dans l’optique de partager des informations brutes avec le lecteur. Au début, on pense qu’il s’agit d’artifice, très couramment utilisé d’ailleurs, pour nous faire pénétrer dans l’histoire. Mais jamais les personnages n’auront de vraie discussion, des discussions pour rien, pour se perdre, se trouver… Leur manière de parler ne sera jamais naturelle ; exemple après une scène très violente, une fuite éperdue dans la jungle et alors que Théo est blessé :
Une succession d’informations que le lecteur connaît déjà ; des points, aucune virgule, une cadence parfaite, régulière, pas du tout humaine et une multiplication des doubles interrogations et des effets de style « Pour récupérer un sac… » (accentuation de l’absurdité du drame) ou « Un à un, sans pitié. » (pour bien appuyer la cruauté de l’acte). Ce genre de dialogues, bâtis uniquement pour faciliter la compréhension du lecteur, n’est pas crédible une seule seconde mais, pire, sa froideur donne l’impression de suivre des poupées de chiffon et pas des individus de chair et de sang.
Cela donne, tout au long du livre, des scènes ahurissantes : un sous-commandant des FARC parle à Théo du nombre moyen de meurtres en Belgique et en Colombie, fait des comparaisons avec d’autres pays, parle comme s’il avait consulté Wikipédia une minute avant l’entretien. Et même si on occulte le problème de la source des informations, les gens ne parlent pas comme des machines ou des articles de journaux, ils ne débitent pas des chiffres généraux, des statistiques, pour convaincre ou décourager quelqu’un de rejoindre une milice armée.
Même les échanges entre Angela et Théo sonnent terriblement faux. Le jeune homme se montre très pudique avec elle dans la première moitié du livre – pourquoi ? Il a appris dans les squats de punks berlinois à fabriquer des bombes mais pas les rudiments de la libération des mœurs ? Et bien sûr, tous les deux finissent par coucher ensemble, sous les étoiles, dans un hamac, et Théo découvre la volupté des corps, etc., etc. Ils ne discuteront jamais pour comprendre des choses sur eux-mêmes, ne seront jamais des miroirs l’un pour l’autre mais échangeront des mots uniquement pour s’informer réciproquement, partageant à défaut d’intimité, un relevé administratif de leur état d’esprit. Ils ne sont définis par aucun trait de caractère particulier, aucune mentalité précise. Et finalement, la décision de Théo de rejeter la violence est avant tout une décision égoïste : il prend conscience qu’au moment où il a sauvé Angela de la mort (l’auteur respecte ici son quota de clichés) qu’il l’aimait profondément (pourquoi, sinon parce qu’elle est belle ?) et qu’il préfère vivre avec elle que de changer radicalement le monde.
Ce qui nous amène à la morale. Si au début, le héros part avec l’idée de participer à une révolution, et se rend donc dans le pire endroit possible pour vivre cela, il termine l’aventure en secourant des sans-papiers dans les favelas de Rio. Il ne veut plus détruire le capitalisme mais tenter de contrer ses effets, suivant le chemin classique et, encore une fois éculé, de la jeunesse soixante-huitarde passée du « col Mao au Rotary ». Si, bien sûr, il reste anarchiste – l’a-t-il jamais été ? – la révolution sociale, le changement de monde, tout cela est bel et bien enterré.
Si je disais au début que cette morale ménage la chèvre et le chou, c’est parce qu’elle donne raison au grand consensus occidental : si le capitalisme débridé est un mal, la violence est un mal encore pire. Le bon père de famille pourra se dire « ce jeune a appris qu’on ne pouvait transformer le monde sans devenir un monstre » et le jeune lycéen un peu révolté pourra se dire : « oui, mais il peut quand même défendre les exclus et les pauvres, et changer le monde petit à petit ! ».
Pour réaliser cet article, j’ai jeté un coup d’œil aux réactions suscitées dans les médias par Et dans la jungle, Dieu dansait . Et, j’ai été sidéré de découvrir une myriade de commentaires laudatifs, qui ne prenaient jamais le temps d’interroger les failles et les limites de l’ouvrage – cet unanimisme est toujours mauvais signe parce que les grands livres sont des livres qui ne peuvent pas plaire à tout le monde, qui doivent chambouler le lecteur au point de se faire détester, ou même haïr, autant qu’adorer et porter aux nues. Personne n’a noté que Théo fréquentait des « amis » partis se battre en Syrie, alors que les milieux anarchistes belges sont presque tous issus de la classe moyenne blanche et sont rarement en contact avec les milieux sociaux où se recrute les soldats de Daech ; personne n’a noté que l’ouvrage ne tente aucune recherche stylistique et que ses dialogues sont d’une terrible sécheresse ; et personne n’a noté, surtout, qu’une fois la dernière page tournée, on n’a absolument pas l’impression de mieux comprendre cette jeunesse « perdue ».
C’est je crois, parce qu’Alain Lallemand réfléchit comme un journaliste et un homme de sa génération ; de la même manière, il voit les anarchistes à travers un prisme médiatique et générationnel (jeune black block révolté poseur de bombe). À aucun moment cette question ne sera posée : pourquoi Théo est-il devenu ce qu’il est ? Le livre évoque rapidement des problèmes scolaires, une indignation naturelle face aux inégalités… Pour les candidats au djihad, il est encore plus expéditif et les présente comme des « caïds » en mal de souffre-douleurs.
Si notre génération est si perdue, si elle se sent si sacrifiée, si certain de ses membres finissent par rejoindre Daech ou par recourir à une violence, toute relative, dans nos rues, n’est-ce pas justement parce que les « honnêtes gens » sont incapables d’investiguer correctement cette question ? Et de se demander si ce n’est pas, avant tout, la perspective générale d’un futur sans histoire, sans récit, sans espoir, sans rêve, sans futur, qui retourne nos cœurs et instille en nous cette question des sociétés alternatives et des moyens d’y parvenir ? Chaque fois qu’il trouvera un lecteur, le livre d’Alain Lallemand, loin de prendre part à l’éclaircissement du problème, en deviendra au contraire l’une des multiples causes, sa morale participant à l’institution de la désespérance. Ce qu’il nous dit c’est que peu importe si on ressent le besoin de construire un autre monde, celui-ci est bel et bien impossible ou conduit au malheur, à la destruction et à la guerre – il nous dit, finalement, « arrêtez de rêver ».
