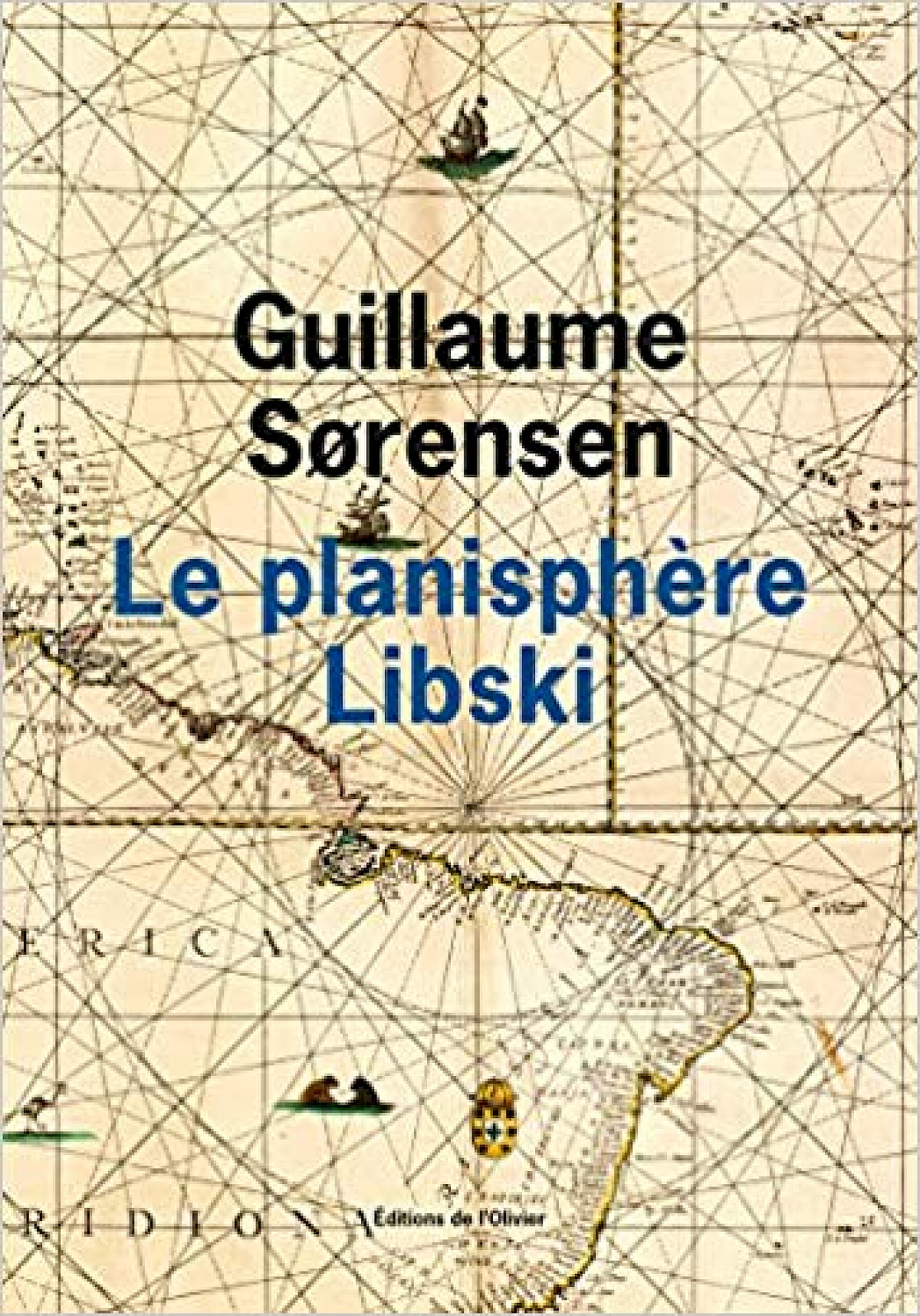
Karoo se penche sur le premier roman de Guillaume Sørensen, un concentré d’humour noir, parfois frappant, mais qui n’est pas exempt de défauts.
Avertissement de vigueur : Le planisphère Libski est un premier roman. Il serait injuste de juger un jeune romancier comme une vieille routarde1 de la littérature. On doit immédiatement reconnaître que Guillaume Sørensen, qui fut rédacteur chez Karoo , a abattu un sacré travail avec cet ouvrage de plus trois cents pages sur-rythmé et toujours tendu. Malheureusement, je ne peux pas dire qu’il m’ait touché ou qu’il ait même fait plus que me décrocher, deux-trois fois, un sourire. Le roman pourrait se résumer à cette réflexion de son personnage principal : « je m’étais habitué à regarder mon nombril à trois cents soixante degrés, de jour comme de nuit, à poil ou non, sobre ou bourré, dans toutes les nuances possibles des moutons de tissus trouvés à l’intérieur ».
Le planisphère Libski est comme la grotte de Platon, un univers fantasmagorique où la lectrice, attachée au sol, contemple le monde en suivant le théâtre des moutons de tissus nombrilaires d’un individu pas vraiment aimable2 . Certes, l’esprit de Théodore-James Libski est bondissant, toujours plein d’une douce folie, mais c’est aussi un genre de misanthrope égocentré, volontiers sexiste ou raciste, parfois franchement insupportable. Fils d’un très grand bourgeois belge, obsédé par la vanité de sa propre existence, il passe le livre à voyager avec une bande de scientifiques et d’artistes aussi fantasques et décalés que lui. Un roman d’aventure Le planisphère Libski ? Pas vraiment. Plutôt un trip décalé et décadent, une satire sans visée sociale ou politique mais qui joue sur l’avatar ridicule de l’individualiste globe-trotter contemporain.
Extrait d’une expérience libskienne :
« Si tuer au fusil de chasse un gnou sans défense possédait quelque dimension virile, se battre contre un végétalien norvégien, à poil dans une chambre d’hôtel sud-africaine, n’avait rien de mythologique, au contraire. Si je comprends bien la dimension viriliste de la bidoche, me battre à la loyale contre un bouffeur de pissenlits (et perdre) représentait une humiliation dont je ne me relèverais jamais. Autant fuir, ruser, on mettrait cette réaction sur le compte de la diplomatie ou de la surprise. L’honneur serait sauf. »
Ce qui fera, ou non, son succès auprès de la lectrice tient dans sa capacité à la faire rire. Sørensen a un sens de la formule indéniable et certains passages sont de véritables pépites sardoniques. Mais quand on utilise une sulfateuse, on manque forcément sa cible plus souvent qu’on ne la touche… C’est sans doute le principal reproche que je peux faire au livre : son côté bavard et sans retenue. Le même style, réduit, transformé pour une forme plus courte (roman, nouvelles ou même aphorismes) ou dans un médium oral (théâtre, performance), ferait sans doute mouche avec plus de régularité et mieux. De la même manière, il est logique de bâtir ses personnages autour de stéréotypes marqués quand on dresse une caricature ou un récit vaudevillesque ; mais il faut, d’une manière ou d’une autre, donner à la lectrice un point d’ancrage, un appui sur lequel elle peut prendre pied.
Libski semble être, tout au long de l’histoire, entouré par des fantômes : père patriarche concentré sur ses affaires, mère consumériste et superficielle, ami artiste mélancolique et pratiquant un post-modernisme morbide… Difficile de ressentir, au milieu de cette galerie de marionnettes, de l’empathie. À l’inverse, le style familier, parfois argotique, la mise en avant des origines sociales de Libski et la structure de l’intrigue souvent invraisemblable mais jamais tout-à-fait fantastique, arriment le roman dans une certaine réalité. Cette tension entre satire et réalisme me semble être une des autres limites de l’ouvrage. Ni dérive tout-à-fait psychédélique dans l’esprit de Libski, ni critique sociale acerbe et moqueuse à la Mirbeau, l’ouvrage de Sørensen demeure enfermé dans un nihilisme qui ne séduira que les plus désespérées ou les plus sceptiques.
Le planisphère Libski est quand même parvenu à m’intriguer sur deux points culinaires fondamentaux : peut-on réellement trouver, en Belgique, une « gaufre fourrée à la bolognaise industrielle » ? Et y a-t-il eu quelqu’une, sur terre, pour avoir l’idée de créer une gamme de « chips saveur saucisse de Francfort » ? Au-delà de ces questions haletantes, j’ai fermé le livre sur un espoir : relire Guillaume Sørensen dans un autre format ou entendre un de ses textes dans la bouche d’une actrice. Il est des autrices, et de grandes autrices, dont les premiers romans sont parfaitement oubliables. C’est même la règle et non l’exception. Puisse la plume aiguisée de Sørensen trouver sa voie, comme un poignard, dans la littérature contemporaine.