La poésie de Verhaeren aujourd’hui
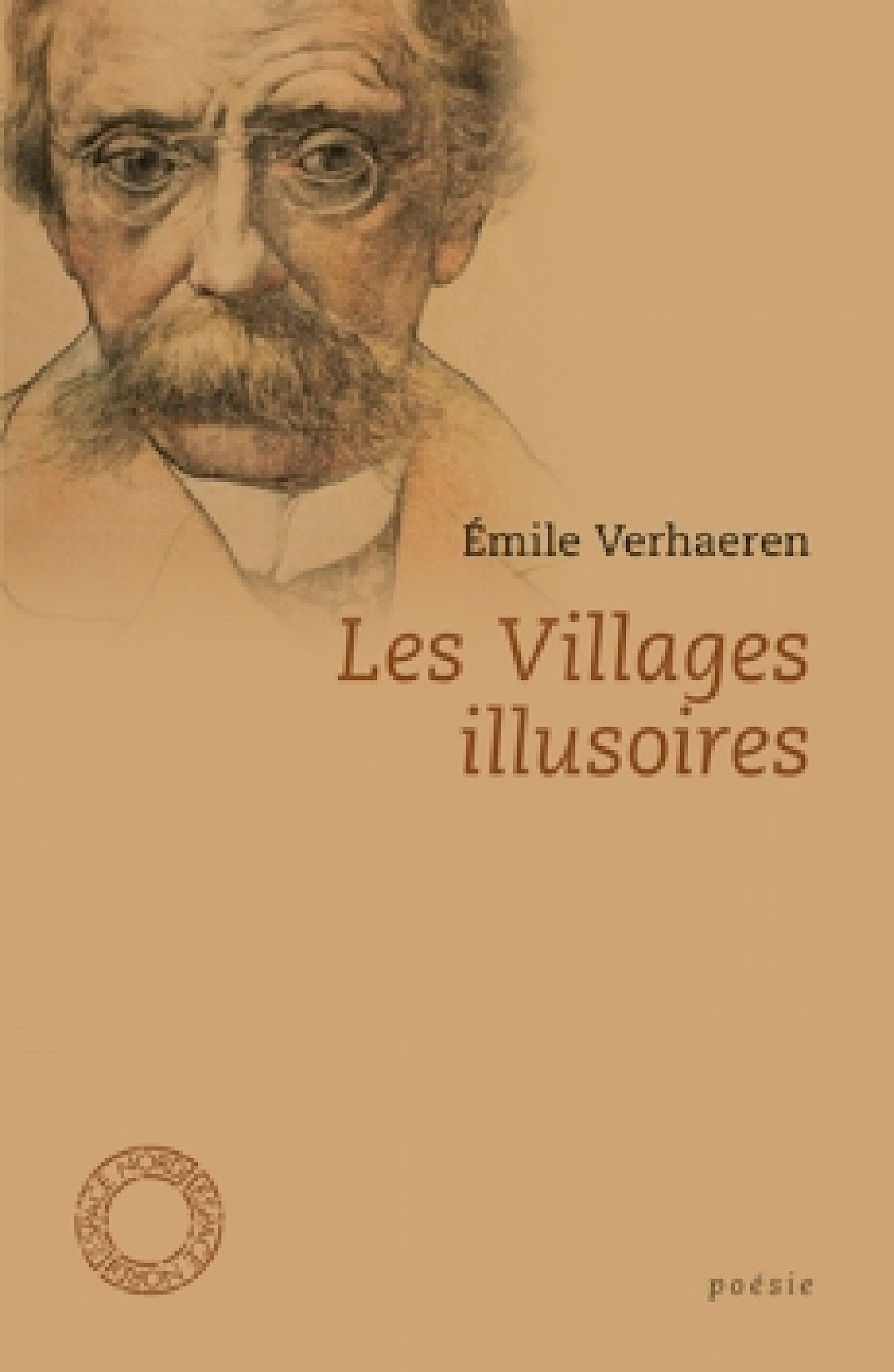
Voilà
Voilà
les Villages illusoiresd’Émile Verhaeren
réédités dans la collection
Espace Nord.
Où l’on se prend
à penser que
la poésie est vivante !
Quelle joie alors d’apprendre qu’Espace Nord s’est (enfin) décidé à publier un recueil du maître. Les Villages illusoires rejoignent ainsi les Campagnes hallucinées et les Villes tentaculaires disponibles, elles, dans la belle collection de poésie « blanche », en format poche, de Gallimard. Il suffit d’écarter les pages de l’ouvrage pour découvrir, ou redécouvrir, qu’une fois de plus la magie opère, comme si le siècle qui nous sépare de l’auteur et de ses écrits n’existait pas, comme si Verhaeren avait couché par écrit « le Passeur d’eau » il y a quelque temps seulement :
Le passeur d’eau, avec la rame survivante,
Se prit à travailler si fort
Que tout son corps craqua d’efforts
Et que son cœur trembla de fière et d’épouvante.
D’un coup brusque, le gouvernail cassa
Et le courent chassa
Ce haillon morne, vers la mer.
Les fenêtres, sur le rivage,
Comme des yeux grands et fiévreux
Et les cadrans des tours, ces veuves
Droites, de mille en mille, au bord des fleuves,
Fixaient, obstinément,
Cet homme fou, en son entêtement,
À prolonger son fol voyage.
Celle là-bas qui le hélait
Dans les brumes hurlait, hurlait
La tête effrayamment tendue
Vers l’inconnu de l’étendue. (page 128)
À lire Verhaeren, on se prend à penser que la poésie est vivante. Oui, « vivante » est bien le bon mot. Elle existe parce qu’elle parvient à vivre à travers son lecteur, à toucher son être et à faire évoluer son rapport à l’existence. La tension du « passeur d’eau », l’énergie monumentale qu’il déploie à ramer contre le fleuve, se projette et nous habite. De la trame narrative naît l’allégorie de lutte éternelle de l’humain contre lui-même et contre le monde. Et pourquoi pas de notre lutte, à nous, contre le monde ? Après tout, est-on si différents des individus que Verhaeren connaissait ou qu’il croisait simplement dans une rue ou sur un chemin ?

David Scheinert remarquait en 1964 dans ses Écrivains belges devant la réalité : « De Coster, Eekhoud, Lemonnier et Verhaeren étaient des hommes enracinés, inspirés par leur terre et leur peuple. Ils ne concevaient pas de littérature détachée de la réalité géographique et ethnique qui leur était familière. Ils n’étaient pas indifférents non plus à la réalité sociale. La vie quotidienne de leurs contemporains se reflétait dans leurs livres. […] Ils n’attribuaient point la beauté d’un poème ou d’un roman à l’indifférence de l’écrivain devant les travaux, les soucis, les combats et les espoirs de ses frères humains. Les rapports qu’ils entretenaient avec la réalité avaient la valeur d’un échange souvent harmonieux. » (page 10, La Renaissance du livre.)
Peut-être est-ce pour cela que cette poésie nous parle encore, parce qu’elle porte en elle un fragment de la vérité de son époque. On entend, en la lisant, l’écho des vies passées, de toutes les luttes, des conflits, des joies, des tristesses… On a presque le sentiment de vivre, le temps de quelques strophes, dans une autre réalité, mélange du passé et du présent. Mais si Verhaeren peut toucher viscéralement le lecteur contemporain, c’est avant tout parce qu’il parle à son être contemporain, aux problèmes existentiels, politiques ou artistiques contemporains.
La fonction de ses vers n’est pas de refaire poétiquement l’histoire, ni non plus d’exemplifier l’histoire littéraire ; ils existent pour être poésie, dans le sens plein du mot. Et c’est parce que Verhaeren avait cette acuité des écrivains de génie, ce qu’on a longtemps qualifié d’écriture « d’universaliste » et qu’on pourrait appeler aujourd’hui une volonté de dialoguer avec l’éternité et l’humain, qu’elle est toujours aussi brûlante, qu’elle enflamme toujours autant l’esprit et les sens ; que ses messages parviennent à survire à leurs contextes. Il suffit de jeter un œil à la fin du poème « le Forgeron » pour s’en convaincre :
Le forgeron dont l’espoir ne dévie
Vers les doutes ni les affres, jamais
Voit, devant lui, comme s’ils étaient,
Ces temps, où fixement les plus simples éthiques
Diront l’humanité paisible et harmonique :
L’homme ne sera plus, pour l’homme, un loup rôdant
Qui n’affirme son droit qu’à coup de dents ;
L’amour dont la puissance encore est inconnue,
Dans sa profondeur douce et sa charité nue,
Ira porter la joie égale aux résignés ;
Les sacs ventrus de l’or seront saignés,
Un soir d’ardente et large équité rouge ;
Disparaîtrons palais, banques, comptoirs et bouges ;
Tout sera simple et clair, quand l’orgueil sera mort,
Quand l’homme, au lieu de croire à l’égoïste effort,
Qui s’éternisait, en une âme immortelle,
Dispensera, vers tous, sa vie accidentelle ;
Des paroles, qu’aucun livre se fait prévoir,
Débrouilleront ce qui paraît complexe et noir ;
Le faible aura sa part dans l’existence entière,
Il aimera son sort – et la matière
Confessera peut-être, alors, ce qui fut Dieu. (page 182)
La puissance utopique de ce passage éclate sans qu’on ait besoin d’entrer dans une querelle idéologique. Ce qui est contenu dans ce poème, c’est la naissance d’un monde autre, c’est aussi l’aptitude à imaginer ce monde autre à partir de celui que nous connaissons. Cette poésie parle, raconte, narre et transmet une partie de son pouvoir de transformation de la réalité, d’abord dans les mots, ensuite dans l’esprit, enfin dans le monde.
Werner Lambersy a parfaitement raison, dans sa préface littéraire à l’ouvrage, quand il fait remarquer de Verhaeren qu’il « génère, qu’il est genèse, qu’il crée ». Oui, il fait de la poésie un vecteur d’espoir, du renouveau, du rêve ; elle devient précisément poésie ( poíêsis , action de créer, d’œuvrer), insufflant dans l’imaginaire du lecteur un mouvement, de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. Le rapport au temps, du passé au futur, dans l’optique de projet est même explicitement présent au sein du recueil, dans le poème « les Cordiers » :
Les horizons ? – ils sont là-bas :
Lueurs, éveils, espoirs, combats,
Les horizons qu’il voit se définir,
En espérance d’avenirs,
Par au-delà les plages
Que dessinent les soirs, dans les nuages. (page 176)
Ma lecture n’a bien sûr rien d’exclusif, le propre d’une poésie est aussi la réappropriation, la recréation à partir de la création. Sans aucun doute, Verhaeren peut aussi toucher spirituellement dans son rapport à l’infini, pour ses descriptions vertigineuses de la « pluie », la « neige », du « silence » et du « vent ». Il peut aussi toucher l’instinct littéraire, avec son jeu perpétuel avec les codes et les conventions. Christian Berg, dans sa postface, note qu’il torture la langue, on pourrait dire aussi qu’il lui forge de nouvelles armes. Les répétions, les néologismes ou encore la liberté des vers sont autant de traits caractéristiques de sa poésie qui ouvrent des portes aux versificateurs actuels et qui lui donnent son caractère si unique – je ne résiste pas au plaisir de partager ce dernier extrait d’« Inconscience », bonne exemple de répétitions « hérétiques » :
L’âme et le cœur si las des jours, si las des voix
Si las de rien, si las de tout, l’âme salie ;
Quand je suis seul, le soir, soudainement, parfois,
Je sens pleurer sur moi l’œil blanc de la folie.
Celui, si triste hélas ! qui s’en alla, là-bas,
– Pâle œil déchanté de la raison méchante –
Rêver à quelque chose, au loin, qu’on ne voit pas
À quelque chose au loin qui tremble et pleur et chante.
Morne crapaud blotti sous les roses, tout seul ! Si seul !
– morne crapaud pleureur de lune, appelle ! Appelle !
Et vous, petites fleurs, pour le linceul
De mon cerveau, l’ensevelisseuse vient-elle ? » (page 48)
Le style si spécifique de Verhaeren nous rappelle également que la poésie fonctionne sur le jeu du rythme, du sens et des images, et qu’elle ne peut pas demeurer figée dans le papier, sinon elle meurt et elle devient muette. Chacun de ses poèmes s’est réincarné, depuis le XIX e siècle, dans l’esprit de ses lecteurs, ils ont connu mille vies différentes, ils se sont reflétés mille fois dans des regards qui ne cherchaient pas les mêmes réponses. C’est aussi pour cela que la poésie est vivante, pour sa capacité à parler au lecteur, à engager avec lui une conversation, à lui donner en quelque sorte une nouvelle voix intérieure.
Que la poésie soit exigeante, qu’elle demande un véritable exercice aux jeunes esprits pour savoir la comprendre et l’apprécier, c’est une évidence ; mais cet exercice doit intégrer sa dimension vitale et chaude. S’il la tait, la poésie ne touchera que la raison froide de ses lecteurs, elle n’éveillera aucune passion, aucun sentiment fort et, pour finir, elle ne s’ancrera pas comme un besoin essentiel, au même titre que l’eau ou la nourriture. Simone Weil ne disait-elle pas que « le peuple à besoin de poésie comme de pain » ? Interprétée dans une démarche purement intellectuelle, laissée en partage à l’analyse, elle ne pourra pas bouleverser la conscience et participer à la construction d’un autre rapport au monde et à soi-même.
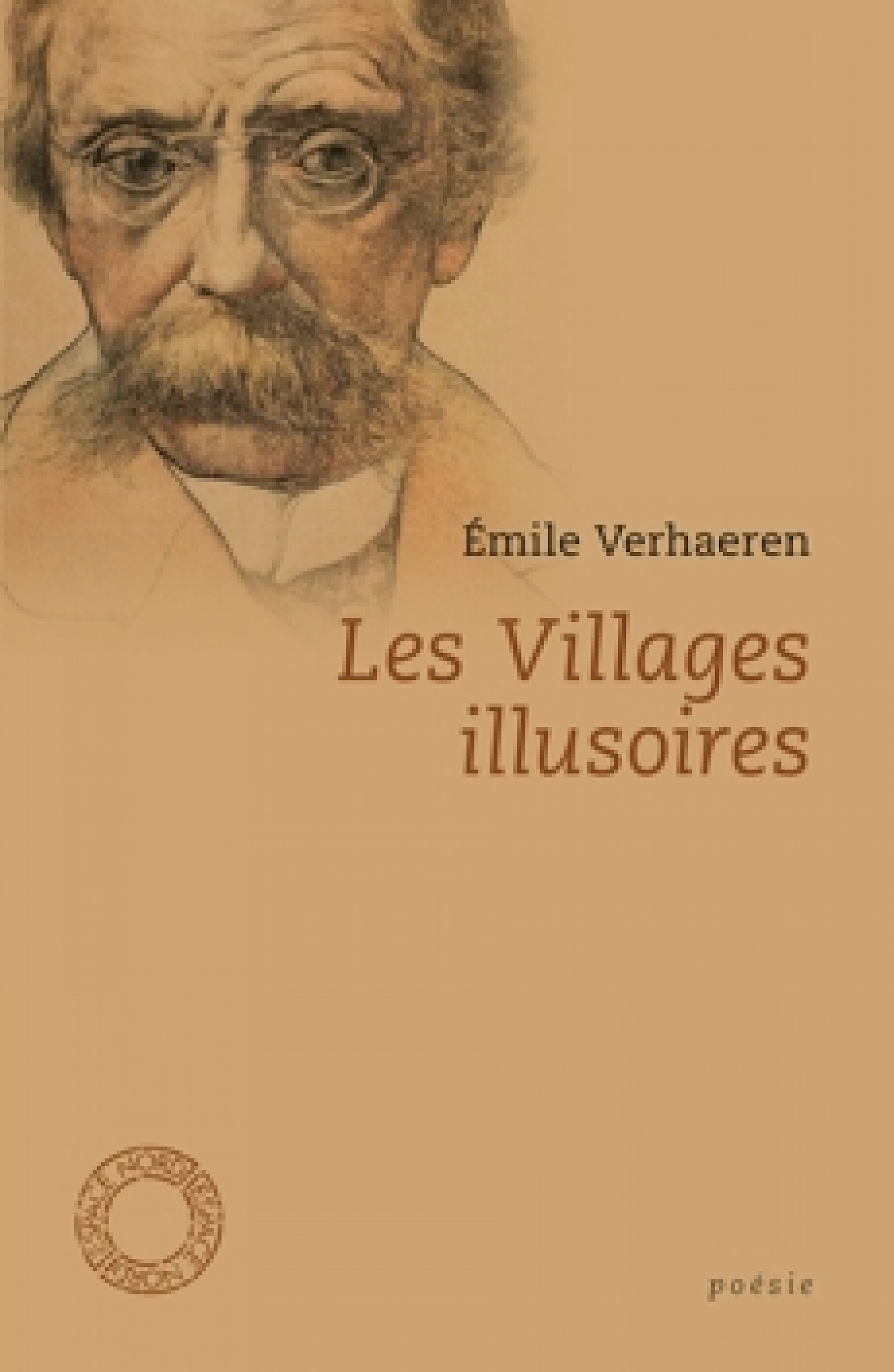
Et c’est peut-être une chose qu’on peut reprocher à cette édition des Villages . L’ouvrage contient en réalité, majoritairement, des poèmes extraits des trois recueils dits de la Trilogie noire ( les Soirs , les Débâcles et les Flambeaux noirs ), puis quelques poèmes en prose, et enfin les Villages en eux-mêmes. Ce choix prend tout son sens à la lecture de la postface critique de Christian Berg. Celle-ci s’attarde, là encore, plus sur la Trilogie que sur le recueil qui donne son nom au livre. On a la nette impression qu’il a été construit d’abord pour appuyer et illustrer cette lecture critique – qui n’en demeure pas moins passionnante – et seulement ensuite pour être lu comme une sorte d’anthologie, un peu éclatée et mélangée, de poésie. Son nom aurait d’ailleurs du être : « La Trilogie noire (extraits) suivi de Poèmes en prose (extraits) et des Villages illusoires ».
Si l’étude du professeur Berg tend à montrer, in fine , que les Villages sont le produit d’une maturation de la poésie de Verhaeren qui aurait commencé avec les Soirs et se serait poursuivie dans le reste de la Trilogie noire, pourquoi ne pas avoir, alors, publié entièrement cette fameuse Trilogie ? Pourquoi offrir des extraits certes présentés comme représentatifs des trois recueils mais qui empêchent le lecteur de jauger lui-même chacun d’eux dans leur unité, leur cohérence et leur projet ? Pourquoi donner cette impression à l’amateur de poésie qu’il se trouve face à un ouvrage d’auditoire, structuré précisément pour permettre à des étudiants ou à des savants d’analyser l’œuvre de Verhaeren, plutôt que pour procurer une vraie expérience poétique ?
Ces questions sont sous-tendues par une interrogation plus générale et plus philosophique : peut-on traiter la poésie comme une matière muséale et participer en même temps à sa diffusion et au partage de la culture belge classique ? Je ne le pense pas. Ce que cette édition illustre, c’est une manière de considérer la poésie, ici celle de Verhaeren, comme un objet d’étude plutôt que comme une création vivante de ses interactions avec le public. Or, la poésie ne peut pas être seulement un produit de distraction ou une pièce de collection, ou encore un fragment programmatique des études romanes. Qu’on ait à étudier la poésie, bien sûr, et comme je le disais, la postface de Christian Berg est passionnante, elle dévoile les mécanismes utilisés par Verhaeren, ainsi que leur évolution dans le temps, mais une édition de poésie doit-elle se mettre en priorité au service de l’analyse universitaire quand son auteur souffre, comme tant d’autres, d’un glissement progressif dans l’oubli ?
Il est à parier que si Verhaeren était français et non belge, toutes ces questions n’auraient pas lieu d’être. Des éditions de poche de ses œuvres, sinon complètes, en tout cas les plus importantes, seraient disponibles dans une double logique de promotion scolaire et d’accès au patrimoine littéraire. Certes, Espace Nord n’est pas responsable de la politique de financement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, certes la poésie se vend mal et a de plus en plus de difficulté à trouver son public, mais si les éditeurs et les universitaires participent à sa pétrification et donnent l’impression aux jeunes lecteurs que Verhaeren est avant tout un spécimen fossile qu’on aurait à disséquer, ce constat ne pourra aller qu’en s’aggravant.
Ne devrait-on chercher plutôt à replanter sa poésie dans notre sol, pour qu’elle se nourrisse d’une terre différente, qu’elle évolue avec le temps ? N’est-ce pas là aussi l’une des manières de renforcer, de revitaliser la poésie en général ? Là encore peut-être a-t-on perdu un certain rapport à nos traditions, non parce qu’elles sont des traditions et qu’elles vaudraient, par là, référence, mais parce que certains auteurs comme Verhaeren ont réussi, en écrivant pour leur époque, à parler aussi à la nôtre. En plus de son angle universitaire, cette édition des Villages nous murmure un triste pseudo-secret : Espace Nord ne publiera sans doute pas la Trilogie noire. Pourquoi, sinon, en offrirait-elle de si larges extraits dans une autre édition ?
Et ceux qui voudront lire les les Visages de la vie , les Forces tumultueuses , la Multiple Splendeur ou encore les trois Heures devront encore longtemps chercher dans des étagères poussiéreuses. C’est pour eux, je le crois, un plaisir ; cela fait même partie de leur identité de lecteur-chineur et de leur expérience de lecture. Mais cela ne participera pas à la diffusion de la poésie de Verhaeren qui continuera à vivre dans le cœur de quelques irréductibles et de quelques savants qui seuls profiteront de ses petites transcendances.