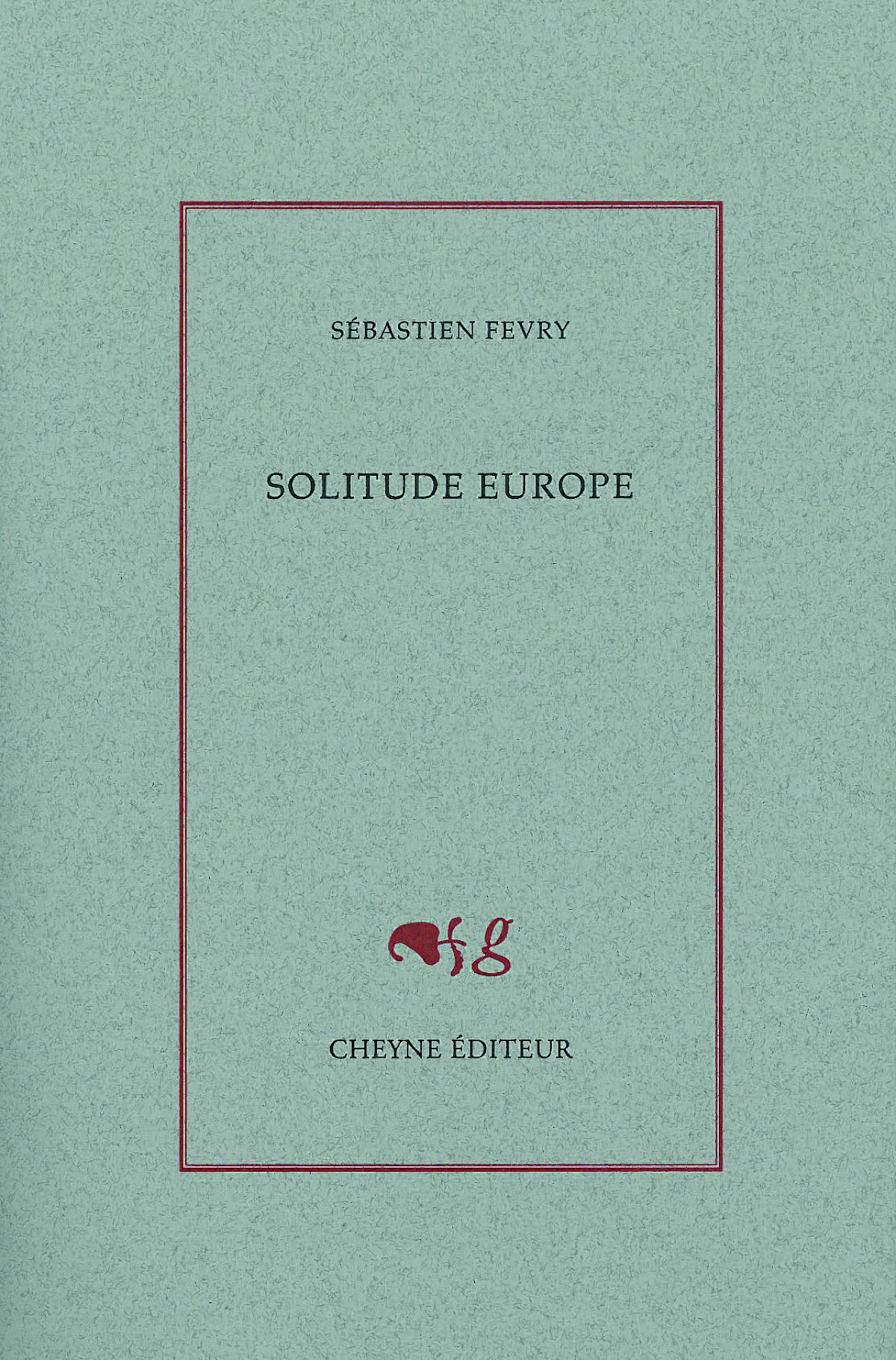
Karoo vous propose aujourd’hui une recension du premier recueil de poésie de Sébastien Févry, Solitude Europe , paru aux éditions du Cheyne.
C’est le paradoxe de la poésie : de plus en plus marginalisée dans le champ littéraire, elle ne manque pourtant de pas de nouvelles voix. Des poètes naissent toujours, publient des livres, déclament devant des auditoires… Le monde se décline en vers, parfois plein du lyrisme des romantiques d’autrefois, souvent à la recherche d’une transparence et d’une légèreté à la mode de nos jours. De tons et de couleurs, le lecteur ne manque pas. Comment expliquer alors cette impression d’incomplétude ?
Solitude Europe germe dans ce contexte ; premier livre, nouvelle voix. Il y est effectivement question des solitudes. Celle du voyageur aéroporté d’un coin à l’autre du continent. Celle de l’individu qui regarde son passé avec un mélange de nostalgie et d’ironie. Et puis, surtout, celle que la forme incarne : les vers fonctionnent comme des îlots, énonciateurs, définitifs.
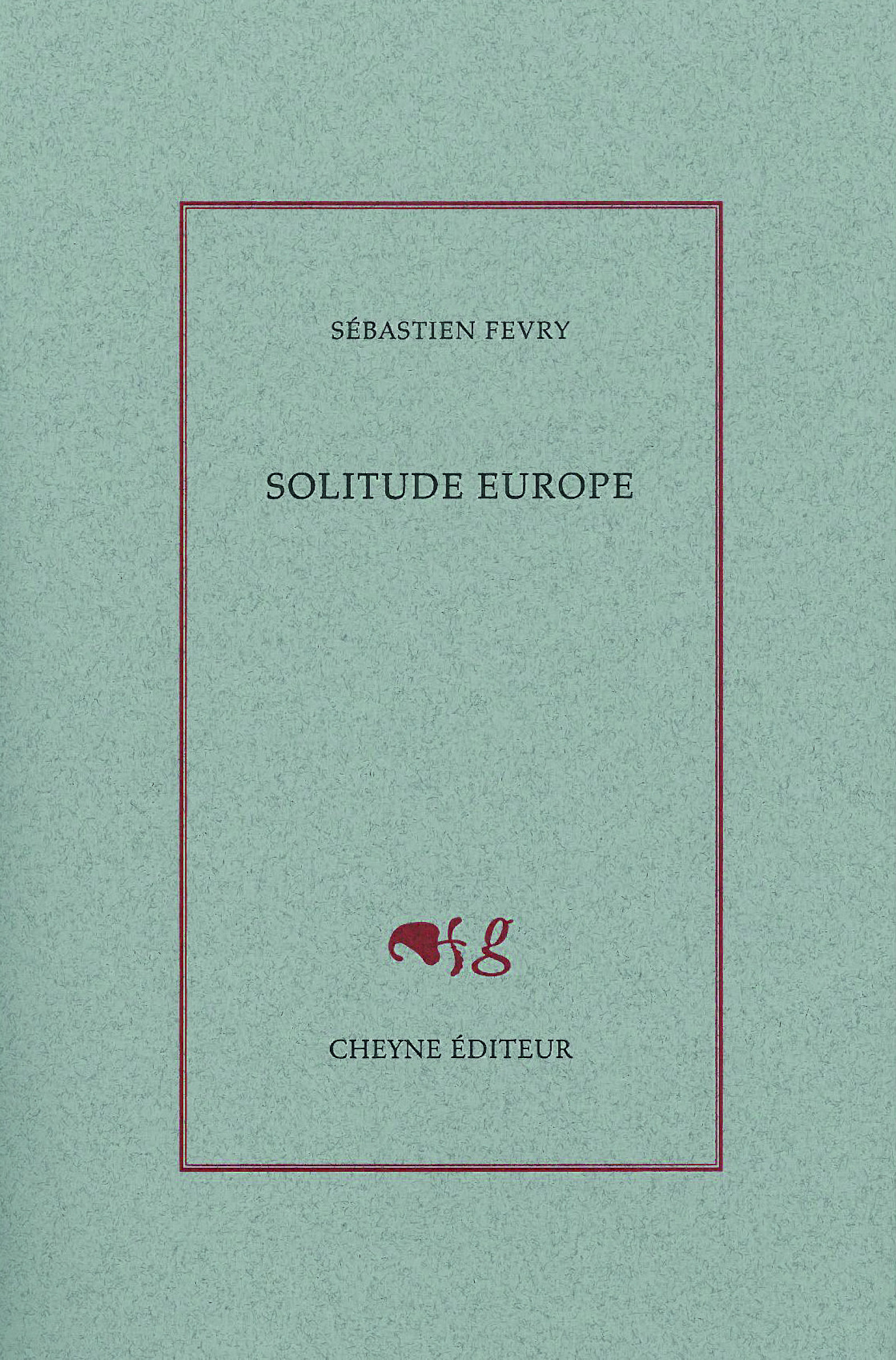
Sébastien Févry n’est pas un poète-chanteur, un rossignol de la langue. Il bâtit son rythme sur le va-et-vient du métronome ; charmant, s’il charme, grâce à une régularité qui tient presque de l’acharnement. On sent le travail dans ses lignes, le labeur d’une écriture. Les mots se permettent de temps à autre un accent soutenu mais le poète ne cherche ni à jongler, ni à briller avec eux. Il semble chercher l’image juste et précise, la bonne évocation d’un souvenir ou d’une vision.
Je dois reconnaître que Sébastien Févry m’a peu touché. Je veux dire : que mon échine n’a jamais frissonné pendant ma lecture et que je n’ai jamais su faire corps avec une poésie qui me paraissait par trop étrangère. J’ai eu l’impression de discuter, dans un salon feutré, avec un vieux globe-trotteur. Les poèmes les plus touchants sont les plus libérés, les plus pétillants. On les retrouve surtout dans la troisième partie du recueil avec « Filles maussades », « McGyver », « Caprice et Croquette » et surtout « Été », pour moi le plus réussi.
Ces poèmes, souvent charnels, évoquent la jeunesse, la nostalgie… Thèmes immémoriaux, sans doute clichés, mais néanmoins porteurs d’une vraie vibration dans la voix du poète. Ils sont aussi touchés par la grâce de l’ironie, d’un regard amusé sur la part vulgaire ou dérisoire d’un temps dépassé. S’y cache ce qui manque à mes yeux dans beaucoup d’autres : le secret d’un regard, d’une émotion, d’un rapport à l’amour et même au sexe, en filigrane.
À l’inverse, le moment de bravoure du recueil, le long poème de la deuxième partie, « Greenville, SC » manque du souffle vécu. Il contient même des passages descriptifs irritants. Le portrait d’une femme noire obèse et maquillée (éléments mis en avant) n’est ni assez empathique pour soutenir le sous-texte politique de l’auteur, ni assez tranchant et impressionniste pour éviter l’imposition d’un stigmate. C’est d’ailleurs un symptôme qu’on retrouve dans plusieurs autres vers, toujours à propos des femmes.
Le travail de l’éditeur est irréprochable. La maquette de Cheyne est en elle-même un appel à la lecture, elle offre aux poèmes un espace et un grain idéaux pour se déployer. La page retrouve sa fonction primordiale : le noir s’épanche, se colorise, se métamorphose sur le la surface du blanc qui devient toile. Tenir l’ouvrage, même sans adhérer pleinement à son contenu, a quelque chose du plaisir.
L’incomplétude… c’est peut-être ce manque d’absolu, cette sécularisation de la poésie dans une matérialité niant la transcendance esthétique. Il ne s’agit pas de défendre un code de règles strictes ou à l’inverse un refus avant-gardiste de tout règlement… mais d’espérer qu’une poésie viscérale puisse voir le jour et s’assurer une reconnaissance. Qu’elle sache faire sonner son sens et résonner ses sons. Qu’elle cherche à illuminer ce monde d’un instant de beauté ou, qu’au moins, elle l’assassine.