La liberté esclave
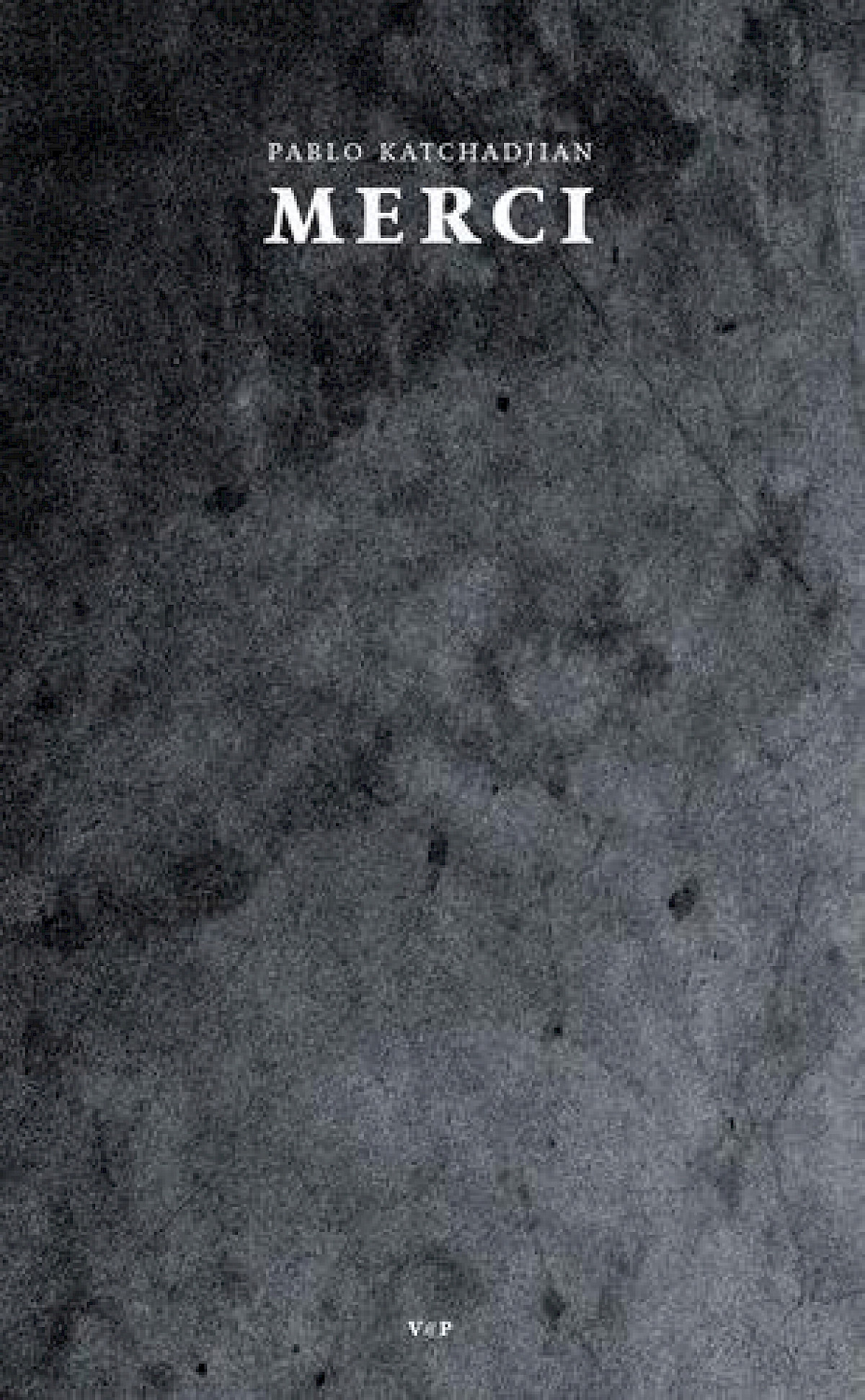
Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce qu’être libre ? Voilà une question aussi vieille que l’humanité à laquelle s’attaque Merci , le dernier livre de l’auteur argentin Pablo Katchadjian, publié chez Vies parallèles. Entre illusion et désillusion, il nous fait traverser avec brio le cheminement d’une libération qui n’est jamais acquise pour toujours.
L’histoire : celle d’un esclave qui arrive sur une île sans nom. Il est acheté par Hannibal, un maître qui paraît d’abord humain mais se révèle rapidement tyrannique et cruel. L’esclave doit travailler à une
besogneimmonde, qui ne sera jamais explicitée mais qui constitue la ligne rouge du récit : après avoir tué Hannibal et avoir été proclamé roi par les esclaves libérés, il détruira par le feu cette
besogne– on imagine des corps en putréfaction, quelque chose d’organique, de mourant et de mortifère. Pourtant cette chose terrible et innommée ne sera pas détruite, des flammes de son bûcher sortira la désolation.
Si le style est simple et le récit court, Merci offre de nombreux niveaux de lectures et une puissante recherche littéraire. L’univers décrit est clairement fantastique, il contient un bestiaire, notamment des racines étranges dont la consommation provoque des effets psychotiques : colère, dédoublement de personnalité, etc. Le décalage entre réalisme et onirisme est permanent – alors que la désolation s’empare de l’île sous la forme d’une éruption de cendres, celles-ci prennent vie et se transforment en vers assassins. Le temps est aussi soumis à ce grand mélange, on retrouve le genre de mixage (élément moderne dans un contexte pré-moderne) qu’affectionnait Anouilh dans son théâtre.

Les interprétations sont nombreuses, la fable qui paraît simple cache un labyrinthe de sens contradictoires. Un thème transversal se détache tout de même : celui de la liberté trahie, déchaînée dans le pire sens du terme. Quand l’esclave tue le maître, il est fait maître par les autres esclaves. Si ce roi de fortune agit de manière très humaine – il incarne cette figure de la candeur idiote dont Dostoïevski a si bien usé –, les autres esclaves libérés sont prêts à toutes les bassesses. Le roi essaie d’agir comme un régulateur moral mais rien ne fonctionne. L’île devient peu à peu inhabitable parce qu’il a tenté de détruire sa besogne (et donc le symbole de son esclavage) ; ses compagnons se changent en une armée de conquête qui s’empare des châteaux esclavagistes, et s’assimilent, de château en château, aux tyrans qu’ils renversent. Encore une figure classique : celle des cochons d’Orwell qui semblent, à la fin, des hommes.
Au risque d’utiliser la traduction contre le texte original, on a envie de lire son titre, Merci , dans le sens de « grâce ». Le conte halluciné ressemble à une histoire sans fin, à une boucle : l’esclave arrive sur l’île (le pays), il se libère, libère ses compagnons, devient roi, renverse l’ancien pouvoir, établit le sien, mais la dictature l’emporte à nouveau et l’île (le pays) est finalement détruite. Cela ressemble presque à un récit biblique, à une expérience divine qui consisterait à tester les hommes et à les punir en voyant l’instinct hiérarchique l’emporter sur l’instinct égalitaire.

Au final, seul le roi parvient à s’enfuir, parce qu’il avait, semble-t-il, le cœur vierge de ce désir de pouvoir – autre preuve que lui, qui est aussi le narrateur, échappe à cette essence du maître : il ne sera jamais aussi heureux que quand il se perdra dans la nature et apprendra à y survivre.
Contre une lecture qui verrait dans Merci l’impossibilité même de la liberté, je préfère celle du combat éternel entre des pulsions humaines, libérer-dominer, antagonistes. Le narrateur me donne de l’espoir, même dans ses faiblesses. Concluons en remerciant les éditions Vies parallèles pour ce beau livre, beau dans son thème, beau dans sa maquette. L’édition belge ne connaissant pas ses meilleurs jours, ce genre de livre fait croire au renouveau.