Interview des membres
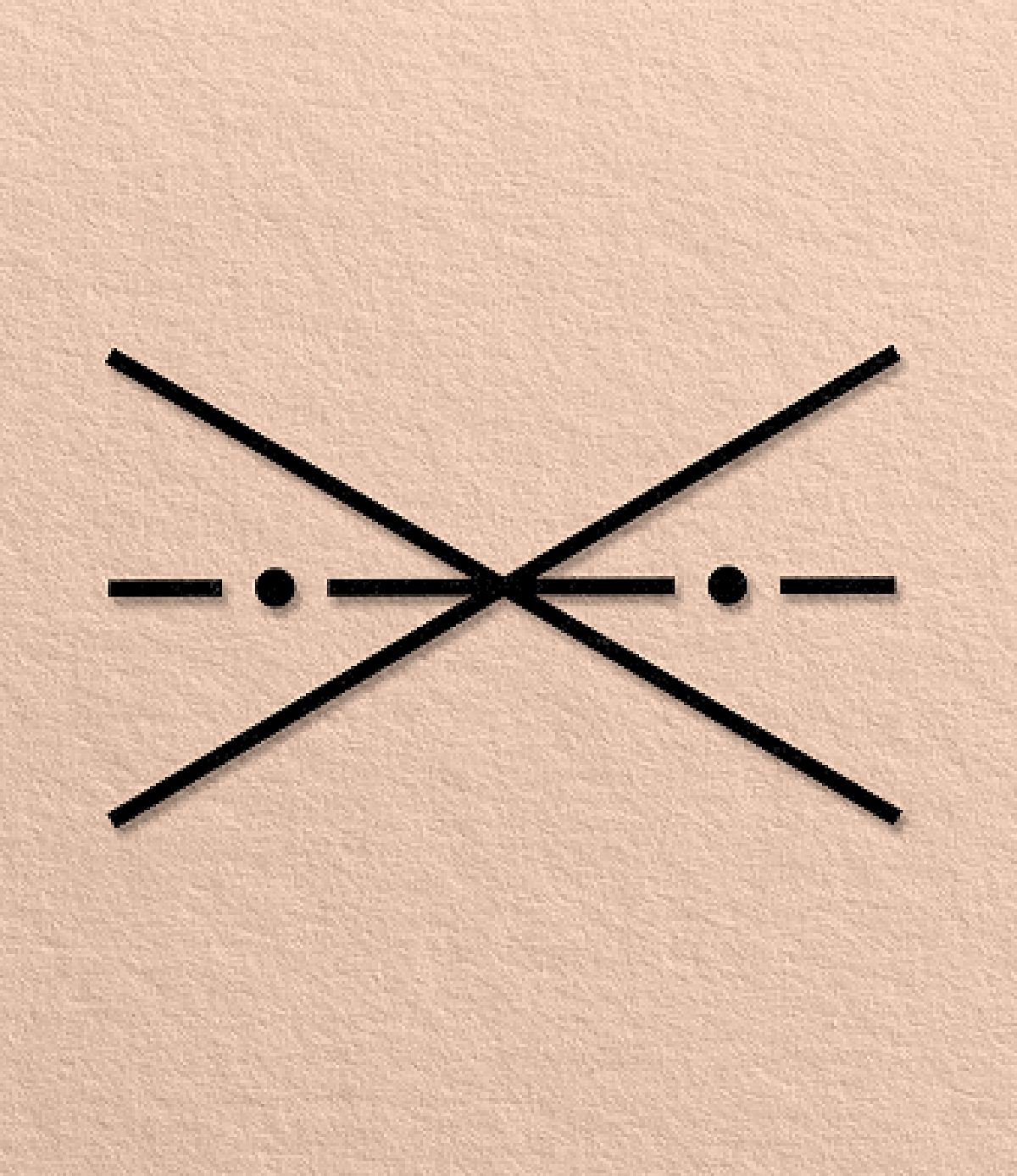
Après avoir recensé le premier recueil de poèmes de Roland Devresse, Assigné à existence , Karoo s’intéresse au collectif éditorial du Mot : Lame. Comment fonctionne un éditeur en autogestion ? Et quelle philosophie anime ce projet ambitieux ?
Le Mot : Lame n’est pas un éditeur comme les autres . Non seulement ses textes sont relevés, profonds, violents parfois, mais il refuse le cadre hiérarchique des comités éditoriaux. Il s’agit d’un collectif, d’un ensemble d’individus marchant de concert mais n’ayant pas toujours la même vision de leur projet commun. Cette interview est donc le reflet de cette diversité et tente de transmettre une vision du monde bouillonnante, multiforme et originale.
Karoo – « Le Mot : Lame », la référence à la Liberté ou l’Amour de Desnos est-elle fortuite ou volontaire ?
Jean C. Zelig & Roland Devresse : Pas lu !
Nathaniel Molamba : je n’ai pas lu ce livre non plus. Le Mot : Lame n’a peut-être aucune signification et personne ne sait concrètement ce que ce mot veut dire. Le jour où on le saura ce qu’est le Mot : Lame et qu’on l’aura réalisé, le Mot : Lame n’aura plus de raison d’exister et ça sera terminé. Récemment, il m’est venu à l’idée de penser qu’il pourrait s’agir d’une référence au poème les Dernières Paroles du poète de Réné Daumal. L’histoire d’un poète condamné à pendaison à qui l’on autorise de dire un dernier mot à la foule avant de mourir. S’il prononce le mot lame , il coupe la corde. Ce n’est qu’une interprétation parmi d’autres. Il y aussi de cette idée de venir trancher dans le voile du réel avec les mots comme on ferait une petite déchirure derrière le rideau avec une lame, et pour voir quoi ? Pour voir l’Éternité, naturellement.
Le Mot : Lame est une maison d’édition, mais c’est surtout une plateforme coopérative qui fait disparaître la frontière entre auteurs et éditeurs. Pourquoi avoir choisi cette forme d’organisation ?
Nathaniel : L’organisation d’un réseau coopératif d’auteurs s’est mise en place naturellement. Cela pour une raison évidente : elle est l’effet d’une rupture entre les auteurs qui font la littérature et les institutions culturelles ou médiatiques qui les représentent. Quand l’envie de publier s’est fait ressentir, on ne s’est pas posé la question d’aller voir des éditeurs ou des professionnels, il fallait apprendre à le faire et le faire proprement.
Rétablir le lien entre les auteurs et la structure d’édition, rendre les auteurs responsables de la structure d’édition, c’est aussi fragiliser la frontière entre littérature et lectorat. Cette frontière, comme toutes celles qui participent à la séparation entre masses cultivantes et masses cultivées doit tomber. Le public doit redevenir acteur de sa propre culture. Il n’est plus question de laisser des institutions culturelles ou médiatiques édifier des schémas d’existences. Il n’est plus question de laisser les avant-garde créer de nouveaux modèles de consommation. Tout doit exploser ou périr.
Alice Emery : Cette forme d’organisation permet aux auteurs d’être actifs dans la réalisation d’un livre. Mais cela permet aussi d’être tous décisionnaires au sein de la maison d’édition. Que ce soit en matière de textes, de thème, ou encore dans la manière de lancer un livre. Les choses sont du coup beaucoup plus linéaires et on enlève l’aspect pyramidal.
Roland : Il faut croire qu’au cœur de la totalité mercantile, le livre est devenu une marchandise comme une autre. Comme toute marchandise culturelle, elle se donne un supplément d’âme en s’aliénant l’aura du créateur, de l’artiste, ou de l’écrivain. Et s’aliénant la fiction de l’artiste, c’est moins le livre en lui-même qu’on met en valeur que la forme de vie qui est en la cause. On dira artistes, poètes pour neutraliser toute forme de rencontre entre deux être à travers l’art. Toute une imagerie dandyesque ou maudite sera alors mobilisée. On fera de l’auteur un phénotype propre à correspondre à la légende spectaculaire qui plaît tant à un lectorat avide d’images éculées, assoiffé de déjà-vu. Les grands éditeurs sont les agents même de cet ordre marchand, de la transformation de l’auteur en une attitude générale de production et de consommation.